|
SA
VISION
Fidèle en
amitié
Libéré du service militaire en
octobre 1935, je venais de débarquer à Paris. Un
soir, sur le boulevard Saint-Germain éclairé par
les vitrines, mon compagnon de vadrouille me
retint par le bras... " Regarde ! Ce
type-là... C'est Brasillach... "
Pour nous, Thierry Maulnier, Robert Brasillach, Vinneuil, c'était
l'équipe du jeudi de notre journal L'Action
française, de jeunes insolents auxquels
notre vieux maître Charles Maurras avait trouvé
naturel de confier sa page littéraire... De
Thierry Maulnier et de Robert Brasillach, on
disait que, brillants normaliens, ils avaient
poussé l'incongruité anti-républicaine jusqu'à
louper l'agreg' en sortant de l'école, ce que
nous ressentions comme une preuve d'indépendance
intellectuelle, une négligence délibérée de se
soumettre à une contrainte administrative tout à
fait à leur portée...
Robert Brasillach était là,
immobile, les mains dans les poches de son
imper, très intéressé par les bouquins dans la
vitrine. Nous ne le connaissions pas encore,
nous n'avons pas osé l'aborder. Je regardais ce
visage sérieux, ce crâne volumineux, ce front
haut et clair, ces traits doux et arrondis. En
m'éloignant, je croisai son regard. C'est peu et
c'est banal de dire qu'il en émanait un éclat
d'intelligence. Avec autre chose qui m'intrigua
et dont je compris la nature plus tard, un jour
qu'il avait cessé de parler pendant quelques
secondes au cours d'une conversation. Je vis
alors dans ces yeux noirs de Catalan une lueur
de rêve et de nostalgie comme on en rencontre
dans les yeux bleus de ceux de l'Ouest, ce qui
donnait du charme à ses propos ironiques
répandus à travers un sourire à peine esquissé.
Nous avons souvent bavardé
pendant ces années 36, 37, 38... etc. Nous nous
sommes querellés, aussi. Quand, entré en "
dissidence ", comme on disait, j'avais entrepris
avec quelques camarades de donner à notre
mouvement une impulsion plus progressiste
(l'histoire de L'Action française est
jalonnée de tentatives de cette sorte).
Nous avions créé l'hebdomadaire L'Insurgé, auquel Robert
Brasillach ne collabora jamais malgré son amitié
pour Thierry et Maxence et quoi qu'en ait dit
l'acte d'accusation. Il y eut une empoignade
sérieuse à la terrasse du " Capoulade ".
Brasillach et Rebatet me reprochaient mon
évolution et les tendances prétendument
fascistes de notre entreprise. Tous deux étaient
encore très attachés à l'orthodoxie
maurassienne. Ces heurts n'avaient aucune prise
sur l'amitié qui nous regroupait dans ce qu'on
appellerait aujourd'hui une même sensibilité
politique. Robert Brasillach venait nous voir au
siège de L'Insurgé où il bavardait avec
Thierry Maulnier, Jean-Pierre Maxence, Maurice
Blanchot. Je l'écoutais et je l'admirais. Grâce
à lui, j'ai eu la révélation de l'art de
Jouhandeau, à travers un livre récemment paru,
Le Saladier. Un autre jour, il nous
raconta en riant qu'il avait reçu un premier
livre d'un jeune auteur nommé Kléber Haedens : "
Il y traîne ses parents dans la boue... Il a du
talent, je l'ai envoyé chez Corréa...
Ça va marcher...
"
Il a conforté et aiguillé
de nombreux jeunes écrivains, à leurs débuts,
des jeunes à peine moins jeunes que lui, dont
les écrits reflétaient alors ses propres
passions... Claudel, Alain-Fournier,
Supervielle, Giraudoux et les animateurs de
théâtre, Jouvet, Dullin, les Pitoëff... Et
Gérard de Nerval vers lequel il orienta Kléber
Haedens, lui fournissant ainsi le thème de son
deuxième livre (...)
Notre dernière rencontre ?
Un après-midi du mois d'août 1943, place de la
Sorbonne, devant la librairie " Rive Gauche ".
Nous sommes restés ensemble un long moment. Nous
avons parlé de ce qui fut dans sa vie un
évènement d'importance daté de la veille, sa
rupture avec l'équipe de Je suis partout
où je gardais moi-même encore un vieux copain,
Ralph Soupault. Robert Brasillach m'a dit,
simplement, sans hargne, ce qu'il devait répéter
jusqu'à la fin de son procès... " On ne peut
se figer dans une politique de sectarisme
irréaliste... la vie des hommes vaut plus que
toutes les idéologies... Je ne renie rien et je
continue... ". Et toutes ces phrases étaient
ponctuées de : " Lesca est un con ".
Je ne l'ai jamais revu. Je suis de ceux qui ne pardonneront jamais.
Je n'accepterai jamais que cette vie ait été
cassé par un grandiose qui déshonora
l'abjection.
Pierre MONNIER
(Cahiers des Amis de
Robert Brasillach, automne 1980)

***
Le plaisir d'écrire
C'est sur le
tard, après avoir entamé ma retraite, à près de
soixante-dix ans que j'ai tenté de m'exprimer
avec une plume et de gagner des éditeurs. Le
problème était posé de savoir comment utiliser
le temps libre avec un maximum d'astuces et de
bonheur.
Avant de plonger dans un travail de salarié d'entreprise, au cours de
vingt-deux années d'une raisonnable activité, ma
vie fut meublée d'avatars et de petits boulots :
la peinture qui nourrit ma jeune famille au
cours de trois années, le dessin de presse (je
me suis nommé " Chambri " pendant quatre ans),
l'édition (j'ai traîné deux ans de galère sous
le nom de " Frédéric Chambriand "), sans compter
les expédients classiques, un peu manœuvre,
un peu tireur de sonnettes, un peu figurant de
théâtre et de cinéma...
Je me trouvai donc
maintenant libre et débarrassé de l'immédiat
souci de rentabiliser mes efforts. Entre le
dessin, la peinture et l'écriture, il me fallait
faire un choix si je ne voulais pas être encore
une fois pris par ce style touche-à-tout qui fut
pendant longtemps mon " image de marque " aux
yeux des gens réputés sérieux.
C'est pour l'écriture que j'ai opté. Des trois opportunités c'est, à coup
sûr, celle qui comportait le moins d'exigence
matérielle. Une plume et quelques rames de
papier font l'affaire. Pas d'installation
technique, pas d'implantation ; de l'air, de la
liberté... Je ferai donc l'écrivaillon.
J'avais encore une autre
raison. Pas moins sérieuse. Une habitude, un
besoin sporadique certes mais récurrent, de
remplir, depuis mon jeune âge, des carnets que
je portais dans mes poches. Ils sont plusieurs
centaines, empilés chez moi, mêlés à des tas de
dessins, prêts à servir la rédaction de textes
et de mémoires. Il faut aussi dire que cette
manie, ce besoin d'écrire et de noter sont le
reflet de souvenirs très anciens, liés à mon
émerveillement quand j'étais atteint pour la
première fois par une onde de choc à la vue d'un
simple et rigoureux accord de lignes et de
couleurs ou en lisant deux vers d'une
sensibilité accomplie.
Je me souviens. C'était en 1925. J'étais en troisième, au lycée de
Bordeaux. Le jeune professeur, Paul Avisseau,
que j'admirais (il avait réussi à me faire
travailler), prononçait son discours de
distribution des prix en fin d'année scolaire.
Il avait truffé son texte de citations
originales et déconcertantes... " La poésie,
affirmait-il, est partout !... Ecoutez
plutôt... Et il citait : " La somme des
angles d'un triangle, chère âme, est égale à
deux droites... "... Vous aimez le mariage des
mots ? Et ceci : " L'Armand-Behrie, des
messageries maritimes, file quatorze nœuds
sur l'Océan indien... " Ce jour-là, j'ai
découvert et chéri pour toujours les " cartes
postales " de Henry Jean-Marie Levet. (...)
Quand on est tellement touché par l'écriture des
autres on sent qu'écrire soi-même est comme une
fonction naturelle.
On s'imprègne aussi de
l'amour des mots sans risquer d'être desséché
par la dictature des concepts et des idées. Les
courageux qui me font l'honneur de me lire
savent que j'ai dessiné les portraits des miens
et que, s'ils sont les miens, c'est parce qu'ils
sont riches de ce qui m'a toujours fasciné :
l'intelligence et l'art de se faire entendre à
travers les élans de l'amitié. (...) J'ai aussi
rédigé des chroniques : A l'ombre des grandes
têtes molles et Les Pendules à l'heure.
Le troisième
 tome de cet ensemble, auquel je
donne pour titre général Rue du Temps passé,
m'amène à l'heure présente. J'y ai pris le parti
de ne pas m'isoler du contexte et de
l'évènement, sans pourtant me livrer jamais à la
moindre introspection. Je n'ai d'autre souci que
de dire, de raconter, de donner à voir et à
comprendre. tome de cet ensemble, auquel je
donne pour titre général Rue du Temps passé,
m'amène à l'heure présente. J'y ai pris le parti
de ne pas m'isoler du contexte et de
l'évènement, sans pourtant me livrer jamais à la
moindre introspection. Je n'ai d'autre souci que
de dire, de raconter, de donner à voir et à
comprendre.
Un copain qui fait un peu dans la psychanalyse me disait : " Te
rends-tu compte que tu te trahis sans cesse et
que tes obsessions se révèlent à chacune des
pages ? Il est deux de tes mots dont la présence
est éclatante : " Regard " et " Visage ". Il
a raison. Je ne m'en défends pas. Cette passion
du regard et de la découverte des visages était
déjà la même à l'heure où je transcrivais
maladroitement mes premières notes dans mes
premiers carnets. (...) Et puis, il y avait nos
chefs de file qui, dans leur style
irrespectueux, manquaient un peu de modération,
Thierry Maulnier, Maurice Blanchot, Brasillach,
Haedens, Rebatet, Maxence...
Et le talent !
Ceux-là aussi, vous auriez pu les interroger sur
ce qui les poussait à écrire, et vous auriez
obtenu de pertinentes réparties. Parmi nos
raisons d'intervenir il en était qui procédaient
de réflexes offensifs dont la maîtrise nous
échappait parfois. Nous n'étions mus par aucune
haine, aucune rancœur,
aucune conscience de classe, mais nous avions un
tel appétit de liberté que la pire des bassesses
était, selon nous, l'impuissance à porter un
jugement privé de toute considération préconçue.
Il y a là un paralogisme agressif dont
l'archétype est le discours de l'intellectuel de
gauche, cette grande tête molle appuyée sur deux
préceptes fondamentaux : " mépriser ce que l'on
ne comprend pas " et " dans tout conflit
opposant le réel à l'idéologie, donner toujours
tort à la réalité ". Nous, on réglait les
comptes en souriant.
Fils de cette terre
nantaise où mes pays chantent " Catholique et
français toujours ! ", je veux affirmer ma joie
et mon orgueil d'être, en tenant une plume, le
très humble, le très petit, le très pauvre, le
minuscule frangin de ceux-là, les Français dont
les écrits les plus simples ont le pouvoir de me
bouleverser bien plus que les concepts les plus
élaborés... C'est Louise Labé qui murmure
: " Bien je mourrais, plus que vivante,
heureuse. " Et Charles d'Orléans : " Ce
qu'il lui plut de m'accorder quand me donna le
nom d'ami. " Villon : " Je suis pêcheur,
je le sais bien, pourtant ne veut pas Dieu ma
mort... " Et Guillaume Apollinaire : "
Mon beau navire, ô ma mémoire... " Et
Brassens : " ... Mais la belle était si
petite qu'une seule feuille a suffi... " Et
tous les autres, et ceux de la chansonnette :
" On dirait que le vent s'est pris dans une
harpe ! " ... Et celui qui chante : "
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer... "
Oh ! je sais, je ne
suis pas le seul à vouloir écrire. Et nous avons
tous de bonnes raisons. Il n'est pas d'art
mineur comme certains le croient. Et ne vous
dites pas non plus que mon amour de la France me
rend aveugle aux mérites des grands d'ailleurs.
J'en connais aussi un petit bout sur les Dostoïevski, les Heine, les Poë,
les Pirandello et le grand Bill, ce Shakespeare
monumental et susceptible, à qui la Jeannette,
notre bonne Lorraine faisait faire des bulles...
Mais c'est avec les miens que je m'enrichis le
plus. Maurras m'incite à réfléchir, comprendre
et ne pas me laisser entamer, Céline à regarder,
discerner jusqu'au plus secret tout en éclatant
de rire, Léautaud à simplifier l'écriture.
Ceux-là me soufflent les réponses à vos questions. Ils exigent aussi que
je m'engage à mon tour. Ils me veulent, moi
aussi, soumis à la délicieuse angoisse de la
phrase élaborée lentement avant d'être effacée
pour renaître et subir de nouvelles ratures.
" Vingt fois sur le métier ", comme dit
l'autre. La facilité, c'est tellement rare. Ne
pas se duper soi-même en dupant les autres.
Pourquoi écrire ?... Il y a bien aussi quelques
raisons sérieuses. Tenez, voici le point de la
question, en vitesse. Je pense qu'il faut dire
leur fait à ceux qui nous bernent depuis deux
cents ans. Leur Démocratie n'est qu'un leurre.
" Demos, Kratos, pouvoir du peuple, baliverne
! "
Le peuple avec ses
bulletins de vote est toujours couillonné. Le
vrai pouvoir est exercé sous le paravent des
constitutions par des associations occultes et
toutes puissantes, groupes de pression, lobbies,
etc., les vrais, les seuls maîtres, ceux qui
déclenchent les guerres dans lesquelles vous
mourrez.
Ça dure depuis deux cents ans.
Ça prend aujourd'hui des proportions
monstrueuses, avec leur entreprise au double
visage d'un gouvernement mondialiste et la
destruction des patries auxquelles ils
prétendent substituer de petites entités faciles
à dresser les unes contre les autres.
On en prévoit deux cent trente environ pour la seule Europe. Alors voilà
! J'écris parce que je ne veux pas de leur "
Plouto-tribalisme " abrité derrière le mensonge
de leur Démocratie. Je ne vous fais pas de
dessin.
Et puis un mot encore.
Parce qu'il faut aussi le dire... J'écris pour
cette raison impérative que vous avez à coup sûr
discernée, l'amour de l'écriture, et puis cette
valeur, des valeurs... Pourquoi écrivez-vous
?... Ben ! Pour le plaisir... Pardi !
Pierre
Monnier
(Présent, 5 février 1997)
Présent 1997 : Extraits de la
rubrique " La page de l'invité du mercredi ". Il
s'agissait pour chaque personnalité invitée, de
répondre à la question : " Où, quand, comment et
pourquoi écrivez-vous ? "
(Bulletin célinien
n°275, mai 2006)

Pierre Monnier, Antoine Blondin et Denis
Tillinac
***
(...) " Il sait que la
résistance à la destruction des valeurs morales
ne peut s'organiser ailleurs que dans le peuple,
chez les ouvriers, dans les classes dites
moyennes, la petite bourgeoisie. Il sait bien
que les agents de destruction et de mort
trouveront leurs meilleurs alliés chez les
grands, attachés à leur privilège et aux idées
dites " avancées " et parmi ceux que Lautréamont
appelait " les grandes têtes molles
", la classe intellectuelle toujours effarée
à l'idée de ne pas être du dernier bateau.
Le petit bourgeois est poussé par un instinct de survie bien supérieur à
celui du grand possédant auquel il est aisé de
donner mauvaise conscience. Il résiste parce que
la vie lui a été dure. Le peu qu'il possède, il
l'a gagné en peinant. L'enfant qu'il élève, il
veut le protéger, lui donner des forces,
l'armer, et il sait bien que les forces morales
sont la condition de la résistance au malheur. "
*
" L'écrivain le plus proche de Céline, par
l'inspiration, la forme et le contenu émotif est
à mon avis Georges Brassens, qui a le même
public. Même amour de la vie dans ses
manifestations les plus humbles, les plus "
quotidiennes ", même scepticisme à l'égard des
idées, des idéologies, des " grands problèmes ",
même sensibilité, même sympathie pour les
petites gens, même admiration pour l'héroïsme
discret, secret, de ceux qui ne " paraissent "
jamais, même sens de la dignité cachée, de la
vraie grandeur enfouie... même enracinement au
sol natal, même fierté aristocratique et
populaire, même scepticisme affiché, même
indulgence camouflée, même indifférence à
certaines valeurs surfaites et même attachement
à d'autres plus simples, les sabots d'Hélène et
la tendresse de Molly...
Enfin le style, les archaïsmes, les idiotismes français, quelquefois la
langue verte... Qu'il s'agisse de la prose de
Céline ou des vers de Brassens, on assiste à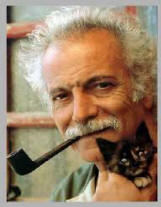 l'éclosion d'un vocabulaire d'essence
traditionnelle, populaire, riche en sève et très
souvent à la limite de la désuétude. L'un et
l'autre éternisent des mots que l'on jugerait
démodés ou incongrus sans le raffinement et
l'habileté avec lesquels ils sont imbriqués dans
la phrase...
l'éclosion d'un vocabulaire d'essence
traditionnelle, populaire, riche en sève et très
souvent à la limite de la désuétude. L'un et
l'autre éternisent des mots que l'on jugerait
démodés ou incongrus sans le raffinement et
l'habileté avec lesquels ils sont imbriqués dans
la phrase...
Voici que Céline nous montre un quartier pauvre de Londres... " Au
premier sourire du soleil, tout s'esclaffe et
tourbillonne... gambade ! Sarabande !... C'est
la kermesse des lutins d'un bout à l'autre de
Wapping !... de perrons en porches, ça culbute à
la course ! A la sauvette ! Fillettes et garçons
! à qui perd gagne !... A qui mieux mieux ! A
cent jeux espiègles et pimpants !... Les tout
petits au beau milieu... main dans la main,
dansant en ronde !... mignons marmots du
brouillard !... Tellement réjouis d'un jour sans
pluie !... Mieux jouants allègres, divins et
prestes qu'angelots de rêve... Et puis tout
autour barbouillés, bandits pour rire
tourmentent les filles... malmènent passants,
les piaillants monstres... "
... " Moi mes amours d'antan c'était de la grisette... alors toutes tes
fredaines, guilledous et prétentaines... j'lâche
la bride à mon émoi... la jambe légère et l'œil
polisson... et la bouche pleine de joyeux
ramages... courons guillerets, guillerettes...
faisons mille et une gambades ./. au premier
ostrogoh venu... dans le guignon toujours
présente... qui brode, divine cousette... tous
sont restés du parti des myosotis... " dit
Georges Brassens.
Céline et Brassens ne se sont jamais rencontrés. On peut
supposer qu'ils auraient eu des goûts et des
dégoûts communs. A coup sûr une même passion
pour la langue française, dans sa branche "
mâle et débridée " comme l'avait dit Léon
Daudet à la parution de " Voyage ".
*
" Il y a aussi la question de l'interprétation... Le personnage de
Ferdinand Bardamu pourrait ressembler à Louis
Destouches, mais la ressemblance physique n'est
pas un préalable obligatoire. Quand il était
jeune, Alexandre Rignault avait un faux air de
Ferdinand... Et il en avait la voix... On a
parlé de Belmondo... peut-être... je verrais
bien Lino Ventura en médecin des pauvres...
quant à Charles Gérard, à mon avis, il " est "
Robinson.
Mais le temps passe, Ferdinand n'a pas quarante ans quand il travaille au
dispensaire de Clichy... Je crois que Gérard
Depardieu ferait un vrai Bardamu et peut-être
Jacques Dutronc un savoureux Robinson...
Je dis tout ça comme ça me vient. Mais c'est vrai, Gérard Depardieu-Bardamu,
j'aimerais voir ça...
***
LES
PAMPHLETS, LA GUERRE, LES JUIFS...
J'ai plusieurs raisons de dire ici ce que je
pense. D'abord je veux apporter le témoignage de
quelqu'un qui avait entre vingt-six et trente
ans quand parurent les pamphlets. Je suis donc
de ceux qui se sont fait une opinion à chaud, et
je suis de ceux qui étaient mobilisables en cas
de guerre (rejoint le premier jour). Je voudrais
m'adresser aux jeunes, à ceux qui sont informés
des faits de l'avant-guerre par les livres, les
revues, les films, la télé, etc. Je voudrais
leur dire de n'oublier jamais que l'Histoire est
toujours un roman à thèse écrit par un
vainqueur.
(...)
Le Mal était alors identifié à l'Allemagne
nationale-socialiste (il est évidemment facile
de trouver à cette affirmation des preuves qui
ne souffrent pas de discussion). Et le Bien,
c'était ce que nos jeunes gens abhorent ; le
capitalisme international allié au communisme :
la Cité de Londres, plus Wall Street, plus le
Kremlin et Staline. Tout ce qui n'avait pas
rallié la coalition capitalo-stalinienne était
l'incarnation du Mal.
(...) La vérité est que, dès le jour de la
victoire de 1945, une gigantesque entreprise de
camouflage est née avec, pour seul objet,
d'interdire tout jugement nuancé sur les
évènements des vingt ou trente années
précédentes. Winston Churchill pouvait dire à
propos de Staline et d'Hitler... " Nous nous
sommes trompés, nous avons tué le mauvais cochon
" (20 millions de morts pour une petite
erreur d'appréciation) rien n'a pu altérer la
sérénité des historiens bien pensants, fidèles
défenseurs de la tradition manichéenne.
Je refuse l'amalgame des écrits passionnés et
souvent excessifs de Louis-Ferdinand Céline dans
les années 30 et des crimes commis pendant
l'occupation après 1940...
J'ai donc lu les quatre pamphlets à leur date de parution, et ce que j'en
dis aujourd'hui, ce que j'en pense aujourd'hui
est exactement ce que je disais, ce que je
pensais à cette époque.
Céline, chaque fois qu'on l'a interrogé après son retour d'exil, a
déclaré formellement : " Tout ce que j'ai
écrit avant la guerre n'avait qu'un objet :
dissuader mes frères d'aller se faire tuer. Je
sentais la guerre venir, je voyais les efforts
gigantesques de certains clans (parmi lesquels
des clans juifs, je dis bien " parmi lesquels "
pour précipiter mes compatriotes à l'abattoir.
J'ai crié mon horreur de la guerre et tout fait
pour prévenir celle qui venait. "
(...)
Les juifs. Ils sont traités en Allemagne d'une
manière ignominieuse. Ils sont aussi très
forts, très armés au niveau international. Très
riches. Ils maîtrisent dans le monde la plupart
des médias, cinéma, presse, théâtre, radio,
information. Ils sont liés au capitalisme
international. Ils vont se défendre et
déclencher dans le monde entier un formidable
mouvement de propagande anti-allemande. Comme
Hitler, ils utilisent tous les processus,
propagande, persuasion, diplomatie, et pour
finir la guerre (toujours Clausewitz).
Que l'on me comprenne bien. Que l'on ne me fasse dire que ce que j'écris
ici. Je ne porte pas de jugements de valeur. Les
juifs sont traités d'une manière indigne et
criminelle. Mais ils sont armés, ils vont se
défendre par tous les moyens. Ce sont des faits.
Si j'étais dans leur situation, je ferais comme
eux. Mais ce n'est pas le cas et en 1939 je suis
mobilisable. C'est à moi et à mes semblables que
Céline va s'adresser : " Attention, on va
vous faire gicler vers le grand abattoir ;
refusez ! "
 Voilà
le jeu tel qu'il est distribué au moment où
Céline écrit ses pamphlets. D'un côté
l'Allemagne qui répand une doctrine hostile au
capitalisme international, combat le marxisme,
prône le racisme, déchire le traité de
Versailles, revendique un espace vital à l'Est
et traite les juifs d'une manière abominable. De
l'autre, le communisme stalinien, le
capitalisme, la puissance anglo-saxonne, dont la
domination est menacée, et le lobby juif, tous
décidés à se défendre et à maintenir leur
puissance. Voilà les conditions de la guerre. Voilà
le jeu tel qu'il est distribué au moment où
Céline écrit ses pamphlets. D'un côté
l'Allemagne qui répand une doctrine hostile au
capitalisme international, combat le marxisme,
prône le racisme, déchire le traité de
Versailles, revendique un espace vital à l'Est
et traite les juifs d'une manière abominable. De
l'autre, le communisme stalinien, le
capitalisme, la puissance anglo-saxonne, dont la
domination est menacée, et le lobby juif, tous
décidés à se défendre et à maintenir leur
puissance. Voilà les conditions de la guerre.
Céline n'a évidemment aucun pouvoir d'intervention auprès du gouvernement
allemand. Pas plus que du gouvernement français.
Mais, en France, il peut être lu. Alors, il va
écrire, ou plutôt il va hurler. Il va s'en
prendre à tous ceux qui, selon lui, constituent
le clan belliciste, indifférent aux souffrances
que produira le conflit en préparation. Il va
jeter l'anathème sur les banquiers anglo-saxons,
les industriels de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, les dirigeants anglais et américains
soumis aux puissances d'argent que menace
l'Europe autarcique, les membres du lobby juif,
les francs-maçons qui font la liaison entre les
pouvoirs financiers et les gouvernements
français soumis depuis quinze ans aux directives
anglaises, l'armée des épigones du traité de
Versailles, représentants des ex-empires
centraux, toujours prêts au terrorisme
provocateur, concussionnaires, vendus, pourris
(" demandez Titulesco !... qui n'a pas acheté
Titulesco ? ", dit une scie à la mode),
installés dans les couloirs d'une "
société des nations " inapte à régler le moindre
conflit, mais toujours prête à attiser les
zizanies locales et souffler sur les foyers
allumés ici et là, par des incendiaires
intéressés à l'embrasement de la planète.
(...)
Et puis, je donne ici une opinion tout à fait
personnelle. Je ne trouve ni injurieux, ni
condamnable le fait de reconnaître aux juifs une
puissance capable d'infléchir le cours des
évènements. Ce que je trouve offensant pour les
juifs c'est de les considérer comme d'innocentes
victimes bêlantes, incapables de réagir, de se
venger, de contre-attaquer.
En fait, ils sont forts, puissants, riches, organisés, courageux, ils le
prouvent tous les jours en Israël. Ce qui est
vrai aujourd'hui, l'était déjà avant 1939.
Est-ce leur faire injure de le dire.
Je regrette que tant d'autres torturés soient privés de ce pouvoir.
Mieux armés, plus riches, plus maîtres des
médias, ils pourraient, comme les juifs, alerter
la conscience universelle, dénoncer les
bourreaux... Les millions de Khmers massacrés
sous le regard amusé du correspondant de presse
du journal " Le Monde "... Et les
Vietnamiens du Sud ? Et le génocide des
Arméniens ? Un million six cent mille... Je
connais une petite d'Arménien... Son père,
enfant en 1916, avait été contraint par les
Turcs de coudre le sac dans lequel était enfermé
son père assassiné et d'aller le jeter à la
rivière...
Soixante ans plus tard, ces crimes abominables, aucun gouvernement ne
laisse aux Arméniens le droit d'honorer
publiquement leurs martyres. Ils n'ont pas droit
aux manifestations, aux défilés, aux monuments
commémoratifs. Il leur manque la puissance. Dans
leur malheur, les victimes nanties ont encore la
possibilité de hurler... Barrès disait qu'il y
avait des martyrs privilégiés... Ceux qui
peuvent donner l'alerte... Cette discrimination
est de tous les temps... Comme celle qui
concerne les bonnes races et les mauvaises.
Aujourd'hui, nous savons qui nous pouvons injurier impunément et qui nous
devons honorer sous peine d'être poursuivi en
justice. La polémique a ses barbelés.
(Ferdinand furieux, Lettera, L'Age d'Homme, 1979).
|
 CONTACT
CONTACT  LIVRE D'OR
LIVRE D'OR INTERVIEWS
INTERVIEWS