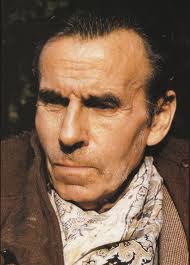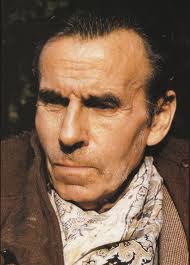|
LES
BATEAUX

LE MEKNES
En 1936, Céline décide de faire un voyage en Russie
soviétique, pour dit-il, y dépenser ses droits d'auteur.
Il y découvrira les beautés de Leningrad, son musée de
l'Ermitage, le théâtre Marinski. De ce voyage naîtra
Mea culpa, son premier texte politique, qu'il
publiera la même année chez Denoël et Steele. C'est
durant le trajet de retour en France à destination du
Havre que cette photo a été prise, à bord du Meknès,
paquebot de la Compagnie générale transatlantique.
(Le Petit Célinien, jeudi 3 mai 2012).
Louis-Ferdinand Céline à bord du
Meknès (1936)
***
Louis-Ferdinand CÉLINE : «
avec vergues, voiles, nuages, tempêtes ! »
Alors faut l'avouer quelque chose ! les navires à
travers les âges... vraiment du grisant comme choix...
de tous les siècles et pavillons... des draggars
jusqu'aux longs-courriers, clippers, paquebots mixtes et
frégates, galions et corvettes... tous les bourreurs de
l'océan par tous les temps et parages... plats bleu
d'azur, mers de plomb, ouragans d'écumes !... C'était
tentant comme emplette, autre chose que les courses
étoupe... le réassortiment des fontes... Ah ! j'en
aurais pris des navires, une
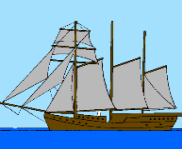 collection,
un vrai choix, j'en aurais mis plein les murs, plein
l'escalier du colonel, plein notre chambre avec
Sosthène, un caprice une rage tout d'un coup, deux trois
beaux trois-mâts par exemple, et puis cinq six mixtes à
vapeur ?... collection,
un vrai choix, j'en aurais mis plein les murs, plein
l'escalier du colonel, plein notre chambre avec
Sosthène, un caprice une rage tout d'un coup, deux trois
beaux trois-mâts par exemple, et puis cinq six mixtes à
vapeur ?...
« Chiche ! qu'elle me défie la gosse.
- Chiche alors ! go ! la douzaine ! »
Et les plus beaux en couleurs, et puis encore douze !
avec vergues, voiles, nuages, tempêtes ! perroquets
tendus ! les vents d'ouragan plein les drisses ! je
lésine en rien. Je m'en colle pour quarante-sept livres
! Lorgnon il en louche quand même quand je lui allonge
quarante-sept fafs... Il m'avait jamais rien vendu... Ça
me faisait un très fort rouleau en plus de ma quincaille
mes fontes... Et que c'était moi le colletineur !...
enfin je m'étais passé l'envie... Il était plus temps de
se dédire... Bien sûr c'était peu raisonnable... encore
sur le pèze au colon ! Y avait plus de limites !... j'y
ai fait bien remarquer à la petite... qu'elle était
fautive comme moi... qu'elle m'avait dit chiche... ça y
était égal inconsciente... c'est des histoires qu'elle
voulait... que je commente encore les batailles, les
autres tableaux du magasin. J'ai dit où c'était :
Wardour Street... deux pas après le Palladium...
Il en avait bien d'autres Binocle, des cartes anciennes
de toute beauté... les batailles célèbres, Lépante, les
galères tonnantes... en plus des monstres marins !...
baleines poustouflantes des naseaux... furieuses à la
lame... en pleine charge contre les frégates ! les
caravelles d'Armada en pleine bourrasque atlantique
debout à crever l'océan, éclatantes de mousse et
poudre... des sujets formidables !... et puis tout un
rayon d'atlas, tous les grands tracés du long cours...
les distances d'émeraude : Pernambouc 3 000 milles...
Yokohama 10 100... Tahiti 14... et puis d'autres semis
au vent... tout au bout du monde... aux antipodes, plus
loin encore... l'embarras du choix...
(Guignol's band II, Pléiade, p.453. In Le Petit
Célinien, jeudi 18 septembre 2014).
***
LE CHELLA
" Après la déclaration de guerre de 1939,
Louis-Ferdinand Céline « va vivre un épisode bouffon,
très célinien. En septembre, il devient médecin maritime
pour la compagnie Paquet. Il embarque donc sur le Chella,
qui assure la ligne vers le Maroc. Mais dans la nuit du
5 au 6 janvier 1940 devant Gibraltar, le navire éperonne
par mégarde un aviso britannique. Il y a vingt-sept morts du
côté anglais et le docteur Destouches (vrai nom de
Céline) soigne les victimes. Le Chella rallie tant bien
que mal Marseille.» (François Gibault, dans Lire
hors-série n°7).
mégarde un aviso britannique. Il y a vingt-sept morts du
côté anglais et le docteur Destouches (vrai nom de
Céline) soigne les victimes. Le Chella rallie tant bien
que mal Marseille.» (François Gibault, dans Lire
hors-série n°7).
Céline est en fait volontaire mais trop vieux pour
aller au front et invalide à 75% depuis la Première
Guerre mondiale après des faits d’arme qui lui valurent
des médailles et la quatrième de couverture en couleur
de L’Illustré national. Il devient donc médecin
de bord sur le Chella, réquisitionné pour des
transports d’armes : « Militaire comme tu me connais,
tu ne seras pas surpris de me voir devenu médecin de la
marine de guerre et embarqué à bord d’un paquebot armé
» écrit-il à un de ses amis, le docteur Camus.
Il écrit aussi à René Arnold : « Gibraltar 11
janvier [1940] À peine venais-je de vous écrire que nous
faisions naufrage devant ce port. Heureusement (si l’on
peut dire) sauf, mais ayant expédié au fond 24 vaillants
anglais. Collision de détroit ! avec explosion - et
blessés partout. Quelle nuit ! Quelle longue nuit ! Nous
rejoindrons Marseille plus tard et puis je rechercherai
un embarquement. Comme la vie est aléatoire ! ».
Enfin il précise, toujours professionnel : « Les
médicaments font merveille ! après cette nuit dans l’eau
que de bronchites guéries, prévenues ! ».
(Extrait de
Chella, Lyautey et Céline,
article du site
Maîtres du vent,
Le Petit Célinien, 28 juillet 2011).
Photo: Le paquebot Chella de la compagnie
de navigation Paquet dans un bassin du port de la
Joliette. (Collection
des Archives du musée d’histoire de Marseille).
Paquebot en acier de 130 mètres de long, construit aux
Forges et chantiers de la Méditerranée à La Seyne en
1933.
*********
LE RMS TARQUAH
Le 1er mai
1917, le RMS Tarquah de l'Affican Steamship Company
entre dans le port de Liverpool, en provenance
d'Afrique, avec à son bord Louis Destouches dans un très
piètre état. Il a vingt-deux ans et vient de passer un
an au Cameroun, protectorat allemand occupé par les
Anglais et les Français, au service de la Compagnie
forestière Shanga-Oubangui. Après quelques mois au
consulat de Londres où il avait découvert les bas-fonds
et s'était même marié, le jeune réformé avait quitté
l'Europe
 pour
un poste en Afrique de " surveillant de plantations ". pour
un poste en Afrique de " surveillant de plantations ".
Avant même de débarquer à Douala, Louis avait écrit à
ses amis pour leur faire part de sa désillusion. Ainsi,
le 1er juin 1916, de Lagos, à Simone Saintu : " Votre
vieil ami a bien changé, il est devenu encore plus
vilain qu'avant, couleur rieur citron, secoué par une
fièvre qui paraît m'affectionner, légèrement rendu myope
par les doses exorbitantes de quinine absorbées,
transpirant ou grelottant, suivant les heures. " Et,
le lendemain, à Albert Milon : " Rien n'est plus
triste que les visages des colons d'ici jaunes,
languissants, l'air miné par toutes les fièvres
possibles. Tristes épaves dont la vie semble s'échapper
peu à peu, comme absorbée par un soleil qui noie tout et
tue infailliblement ce qui lui résiste. "
Dès son arrivée à
Douala, il est envoyé à Bikobimbo, village de la tribu
des Pahouins, plus ou moins anthropophage, à vingt-sept
jours de marche de Douala, à onze jours du premier
Européen. En ce lieu perdu d'une terre étrangère, Louis
Destouches souffre de solitude. Une des constantes de sa
vie. Il s'organise du mieux qu'il peut, avec les moyens
du bord : " du matin au soir je me promène entouré
d'épais voiles contre les moustiques. Je fais ma cuisine
moi-même de peur d'être empoisonné. Je m'intoxique à la
quinine et à pas mal d'autres
drogues pour me protéger des fièvres " (28 juin
1916, à Simone Saintu).
Il est armé en permanence et craint d'être mangé par ses clients ou par
ses employés. Et en plus, il n'aime pas les Noires : "
Jamais je n'ai été aussi sage, j'ai horreur des Noires
j'ai trop aimé les Blanches. " (14 septembre 1916, à
ses parents).
(François Gibault, Figaro Hors-Série 2011, 1er mai
1917, Retour d'Afrique, in Le Petit Célinien, 21 avril
2012).
*********
Le ciel en bateau.
" L'amour de Céline
pour les bateaux est bien connu. Le train, le ballon, le
métro feraient même figure de second violon à côté des
transports maritimes. : " Je connaissais un peu la
marine, plus que la technique ferroviaire... J'ai même
fait naufrage à Gibraltar... vous dire ! "
(Rigodon p. 201). La marine à voile est au plus haut
niveau dans la hiérarchie des transports. Les beautés
féminines sont, pour Céline, des " trois-mâts " :
Elle possédait Sophie cette démarche ailée, souple et précise qu'on
trouve, si fréquente, presque habituelle chez les femmes
d'Amérique, la démarche des grands êtres d'avenir que la
vie porte ambitieuse et légère encore vers de nouvelles
façons d'aventures... Trois-mâts d'allégresse tendre, en
route pour l'Infini... (Voyage p. 473).
Cette passion ne
s'exprime nulle part avec autant d'intensité que dans
Guignol's band 2. Devant un bateau, le narrateur
bascule dans le rêve : " Il [le trois-mâts] me
secouait. Je voyais plus très bien, sous le charme, le
lieu, la situation... l'embarquement pour la berlue ! "
(GB 2, p. 673). Le bateau est un transport magique,
féerique. Son élément n'est pas tant la mer que le ciel
:
Le plus tragique
c'est les filins qui retiennent le navire par les bouts,
gros comme il est, énorme en panse, il est léger, il
s'envolerait, c'es un oiseau, malgré les myrions de
camelotes dans son ventre en bois, comble à en crever,
le vent qui lui chante dans les hunes l'emporterait par
la ramure, même ainsi tout sec, sans toile, il
partirait, si les hommes s'acharnaient pas, le
retenaient pas par cent mille cordes, souquées à rougir,
il sortirait tout nu des docks, par les hauteurs, il
irait se promener dans les nuages, il s'élèverait au
plus haut du ciel, vive harpe aux océans d'azur, ça
serait comme ça le coup d'essor, ça serait l'esprit du
voyage, tout indécent, y aurait qu'à fermer les yeux, on
serait emporté pour longtemps, on serait parti dans les
espaces de la magie du sans-souci, passager des rêves du
monde ! (GB 2, p. 672).
C'est en bateau,
que Céline voudrait s'envoler. Le Haut, le Nord, la
Beauté, l'Idéal : nous sommes tout près de la légende :
" On a été lire les noms, en or jaune et rouge aux
écus... Le Draggar, le Norodosky... Ah ! le Kong Hamsün
!... " (GB 2, p. 671). La rêverie de ces noms est
clairement " orientée " : le Draggar, autant dire le
Drakar, le transport des hommes du Nord ; dans le
Norodosky, on reconnaîtra le Nord, l'or et le ciel ;
enfin avec le Kong Hamsün, nom jumeau d'un
jumeau, le prix Nobel collaborateur Knut Hamsün, Céline
indique clairement de quel rêve il s'agit.
La féerie, la
légende, versant " positif " des pamphlets (tout aussi
compromis idéologiquement) n'arrive cependant pas à
terme dans les romans. Pour embarquer sur le Kong
Hamsün, Ferdinand doit abandonner Sosthène et
Virginie. L'embarquement rate comme tous les
embarquements de l'œuvre.
Le bateau n'a pas sa place dans les romans : pensons à
la traversée périlleuse de Bardamu sur
l'Amiral-Bragueton, au retour en galère, aux minables
mensonges de la péniche toulousaine, au grand voyage de
renvoyage en Angleterre...
(David Décarie, Métro-tout-nerfs-rails-magiques,
Editions 8, mars 2018).
*********
Le Kong Hamsuns.
Ah ! je veux ! Ah ! les
superbes ! Quelles étraves ! Quels flancs ! Quel prestige ! Ah ! les admirables
navires ! Ils sont à quai là deux, trois, quatre, bien sages, géants bord à bord
!
Ils tiennent presque toute la nappe, tout Canion Dock de foc en proue, d'amples
carrures, à vergues planantes ! de ciel en poupe, d'un bord à l'autre, à
profiler, tremblantes au miroir du bassin, d'immenses ramures, beauprés lancés,
flèches d'aventure, à raser les toits, loin par-dessus les hangars.
Nous passons au long faufilons d'une amarre à l'autre... A l'ombre de proue
tout incline, fouit en laideur, ratatiné rien ne supporte, racorni, rat d'eau,
rat d'homme, rien ne rivale piteux étonne, faible, disparaît raton.
 L'admirable
envol des étraves... Pitié pour nous ! Nous rôdons encore un peu à toucher les
filins, les ancres, pendeloques, breloques de géants, tampons colosses,
dentelles d'algues, vertes, bleues, rouges, à bout de chaîne, parure d'abysses,
dieux de terreur, perruques. L'admirable
envol des étraves... Pitié pour nous ! Nous rôdons encore un peu à toucher les
filins, les ancres, pendeloques, breloques de géants, tampons colosses,
dentelles d'algues, vertes, bleues, rouges, à bout de chaîne, parure d'abysses,
dieux de terreur, perruques.
On a été lire les noms en or jaune et rouge aux écus... Le Draggar,
le Horodosky... Ah ! le Kong Hamsuns !... Ah ! je l'admire
d'emblée. J'extase ! Quel meuble ! Je le touche ! L'ampleur, la force de ce gros
flanc ! Rapeux ! Brun crasse, bois et sel !... Mousses d'embrun !... le flanc
s'élève... s'élève encore... exaltant ! Courons en proue ! Quel défi ! la proue
! Quelle majesté ! Creusée au motif ! L'énorme barbu couronné domine l'étrave !
Cuirassé ! Tout ! Glaive au poing ! Il ordonne, commande ! aux flots !
C'est lui ! le Kong Hamsuns ! frisé ! bouclé !
barbu ! les yeux verts ! repeint tout frais ! Navire superbe prêt à l'élan !
Larguez ! Larguez ! Pas encore ? Quelle multitude ! Quel labeur ! Plein les
passerelles ! et tous les échelons ! grimpent, déboulinent cent... mille...
suants... Ça se précipite... grouille de partout...
l'afflux docker... à surcharger postes et cuisines... à colporter barils et fûts
! cotons, énormes bobines, par trois, par six !... bonder les soutes...
whisky... brandy pour les tropiques... fil de fer pour les antipodes !...
J'accroche un quinteux sur une borne... Il me regarde vague... Je le secoue...
- Jovil ? Jovil le Skip !... ?
[...] Le plus tragique c'est les filins qui retiennent le navire
par les bouts, gros comme il est, énorme en panse, il est léger, il
s'envolerait, c'est un oiseau. Malgré les myrions de camelotes dans son ventre
en bois, comble à en crever, le vent qui lui chante dans les hunes l'emporterait
par la ramure, même ainsi tout sec... sans toile, il partirait, si les hommes
s'acharnaient pas, le retenaient pas par cent mille cordes souquées à rougir, il
sortirait tout nu des docks par les hauteurs, il irait se promener dans les
nuages, il s'élèverait au plus haut du ciel, vive harpe aux océans d'azur, ça
serait comme ça le coup d'essor, ça serait l'esprit du voyage, tout indécent, y
aurait plus qu'à fermer les yeux, on serait emporté pour longtemps, on serait
parti dans les espaces de la magie, du sans-souci, passager des rêves du monde !
C'est les filins, c'est les câbles qui le ligotent, le retiennent de partout,
qui gênent à quai tout le trafic, qui font que tout le monde se casse la gueule
et que Jovil le Skip hurle si fort. On largue qu'au dernier instant, il prend le
vent s'en va tous deux !...
C'est pas autre chose les miracles ! Ah ! je suis heureux que près des
bateaux, c'est ma nature, j'en veux pas d'autre !
(Le pont de Londres, Folio, 1978, P.392).
*********
Goélettes et Virginia.
C’est dans
Guignol’s Band encore que Céline a le mieux exprimé
cette nostalgie des ports, le charme de ces paysages entre ciel et eau, avec
leurs docks et leurs bateaux qui entraînent, et les brouillards qui pèsent sur
les gens et les lieux, qui les confondent, les oublient et les enchantent.
Tout dépend du genre que l’on aime !... Je
vous le dis sans prétention !... Le ciel… l’eau grise… les rives mauves… et l’un
dans l’autre, ne se commande… doucement entraînés à ronde, à lentes voltes et
tourbillons, vous vous charmez toujours plus loin vers d’autres songes… tout à
périr à beaux secrets, vers d’autres mondes qui s’apprêtent en voiles et brumes
à grands dessins pâles et flous, parmi les mousses et la chuchote… Me
suivez-vous ?
Céline trouve là des accents lyriques assez bouleversants. Son
écriture ne pèse plus. Elle se répète musicalement, en infimes variations
nostalgiques. Le passé et la mort viennent battre comme un ressac. Et il ne
reste plus sur sa page que l’écume de ses visions et de ses regrets.
O bien trop poignants souvenirs ! grandeurs,
misères, charges du large ! Dundee Goélette Côtres à l’embrun ! Mort les
Aliges ! Mort le Charme ! Evaporée cavalerie mousse ! Hauts flots grondants à
recouvert ! Adieu Cardiff gras et de poisse, pelles à charbon bourrant d’écume !
Adieu focs fous et brigantines ! Adieu ! vagues libres et de vent…
Les bateaux, les bateaux
à voiles lui paraissent affranchis de la pesanteur.
Comme les danseuses. Mieux que les danseuses. Comme les
animaux, comme les chats. Mieux que les chats… Dans leur
perfection, ils atteignent à l’inhumain, si tant est que
le propre de l’humain, c’est la lourdeur, la terrible
pesanteur…
« L’homme est lourd », ne cessera de répéter
Céline. Il se pourrait que tout son art poétique ne
consistât en dernière analyse qu’à échapper à cette
pesanteur, qu’à faire voltiger les phrases – en musique,
en ondes…
Et de même que l’homme n’a de cesse de tout rabattre à sa commune
mesure, au poids accablant de ses digestions, de ses
intérêts et de ses rancœurs, de même les bateaux se
voient-ils ligotés à leur tour, maintenus à quai comme
par l’effet d’une jalousie ou d’une vengeance médiocre.
Le plus tragique c’est les filins qui
retiennent le navire par les bouts, gros comme il est,
énorme en panse, il est léger, il s’envolerait, c’est un
oiseau. Malgré les myrions de camelotes dans son ventre
en bois, comble à en crever, le vent qui lui chante dans
les humes l’emporterait par la ramure, même ainsi tout
sec… sans toile, il partirait, si les hommes
s’acharnaient pas, le retenaient pas par cent mille
cordes souqués à rougir, il sortirait tout nu des docks
par les hauteurs, il irait se promener dans les nuages,
il s’élèverait au plus haut du ciel, vive harpe aux
océans d’azur, ça serait comme ça le coup d’essor, ça
serait l’esprit du voyage, tout indécent, y aurait plus
qu’à fermer les yeux, on serait emporté pour longtemps,
on serait parti dans les espaces de la magie, du
sans-souci, passager des rêves du monde ! (…) C’est pas
autre chose les miracles ! Ah ! je suis heureux que près
des bateaux, c’est ma nature, j’en veux pas d’autres !
Lorsque Céline comparait autrefois les femmes à des
navires, ses images n’étaient pas seulement piquantes.
On mesure désormais leur nécessité. Tout vient ici les
recouper, les approfondir. Il parle de Virginia
exactement comme il parlait des goélettes…
C’est Virginia la plus gracieuse, sans
aucun doute… une enchanteresse… Elle pèse rien dans la
musique… Tout le monde l’admire… elle est exquise …
c’est l’esprit du tourbillon… l’essor l’emporte c’est un
rêve… aux flonflons… vire, glisse, câline… s’envole un
deux trois la valse… poupée…
(Frédéric Vitoux, Céline, Les dossiers Belfond, 1987).
*********
L'Amiral Bragueton.
" En Afrique ! que j'ai dit
moi. Plus que ça sera loin, mieux ça vaudra ! " C'était
un bateau comme les autres de la Compagnie des Corsaires
Réunis qui m'a embarqué. Il s'en allait vers les
tropiques, avec son fret de cotonnades, d'officiers et
de fonctionnaires.
Il était si vieux ce bateau qu'on lui avait enlevé jusqu'à sa plaque de
cuivre, sur le pont supérieur, où se trouvait autrefois
inscrite l'année de sa naissance ; elle remontait si
loin sa naissance qu'elle aurait incité les passagers à
la crainte et aussi à la rigolade.
On m'avait donc embarqué là-dessus, pour que j'essaie de me refaire aux
colonies. (...) Tant que nous restâmes dans les eaux
d'Europe, ça ne s'annonçait pas mal. Les passagers
croupissaient, répartis dans l'ombre des entreponts,
dans les W.C., au fumoir, par petits groupes soupçonneux
et nasillards. Tout ça bien imbibés de picons et
cancans, du matin au soir et semblait-il sans jamais
regretter rien de l'Europe.
Notre navire avait nom : l'Amiral
Bragueton. Il ne devait tenir sur ces eaux tièdes
que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par
pelures avaient fini par lui constituer une sorte de
seconde coque à
l'Amiral Bragueton à la manière d'un oignon. Nous
voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande ; celle des
insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes
inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux
croisements de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un
paquet de lames " Pilett " j'allais trafiqer avec eux
des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des
esclaves mineures. C'était promis. La vie quoi ! Rien de
commun avec cette Afrique décortiquée des agences et des
monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah ! non.
Nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique
! Nous les passagers buissonnants de l'Amiral
Bragueton. miasmes délétères, des solitudes
inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux
croisements de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un
paquet de lames " Pilett " j'allais trafiqer avec eux
des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des
esclaves mineures. C'était promis. La vie quoi ! Rien de
commun avec cette Afrique décortiquée des agences et des
monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah ! non.
Nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique
! Nous les passagers buissonnants de l'Amiral
Bragueton.
(...) Ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité
désespérante de chaleur, tout le contenu humain du
navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se
mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au
fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce
moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler
l'angoissante nature des blancs, provoquée, libérée,
bien débraillée enfin, leur vraie nature, tout comme à
la guerre. Etuve tropicale pour instincts tels crapauds
et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août,
sur les flancs fissurés des prisons.
(...) Ainsi, le Portugal passé, tout le monde se mit, sur le navire, à se
libérer les instincts avec rage, l'alcool aidant, et
aussi ce sentiment d'agrément intime que procure une
gratuité absolue de voyage, surtout aux militaires et
fonctionnaires en activité. Se sentir nourri, couché,
abreuvé pour rien pendant quatre semaines consécutives,
qu'on y songe, c'est assez, n'est-ce pas, en soi, pour
délirer d'économie ? Moi, seul payant du voyage, je fus
trouvé par conséquent, dès que cette particularité fut
connue, singulièrement effronté, nettement
insupportable.
(...) Et voici comment les choses
se passèrent. Quelques temps après les îles Canaries,
j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me
trouver poseur, voire insolent ?... Qu'on me soupçonnait
de maquereautage en même temps que de pédérastie...
D'être même un peu cocaïnomane... Mais cela à titre
accessoire... Puis l'Idée fit son chemin que je devais
fuir la France devant les conséquences de certains
forfaits parmi les plus graves. Je n'étais cependant
qu'aux débuts de mes épreuves. C'est alors que j'appris
l'usage imposé sur cette ligne, de n'accepter qu'avec
une extrême circonspection, d'ailleurs accompagnée de
brimades, les passagers payants ; c'est-à-dire ceux qui
ne jouissaient ni de la gratuité militaire, ni des
arrangements bureaucratiques, les colonies françaises
appartenant en propre, on le sait, à la noblesse des "
Annuaires ".
Je tenais, sans le vouloir, le rôle de l'indispensable " infâme et
répugnant saligaud " honte du genre humain qu'on signale
partout au long des siècles, dont tout le monde a
entendu parler, ainsi que du Diable et du Bon Dieu, mais
qui demeure toujours si divers, si fuyant, quand à terre
et dans la vie, insaisissable en somme. Il avait fallu
pour l'isoler enfin " le saligaud ", l'identifier, le
tenir, les circonstances exceptionnelles qu'on ne
rencontrait que sur ce bord étroit.
Une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de
l'Amiral Bragueton. " L'immonde " n'échapperait pas à
son sort. C'était moi.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956,
p.114).
*********
Le Papaoutah.
Enfin, le petit cargo sur lequel
je devais longer la côte, jusqu'à proximité de mon
poste, mouilla en vue de Fort-Gono. Le Papaoutah
qu'il s'intitulait. Une petite coque bien plate, bâtie
pour les estuaires. On le chauffait au bois le
Papaoutah. Seul blanc à bord, un coin me fut concédé
entre la cuisine et les cabinets. Nous allions si
lentement sur les mers que je crus tout d'abord qu'il
s'agissait d'une précaution pour sortir de la rade. Mais
nous n'allâmes jamais plus vite. Ce Papatouah
manquait incroyablement de force.
Nous cheminâmes ainsi en vue de la côte, infinie bande
grise et touffue de menus arbres dans la chaleur aux
buées dansantes. Quelle promenade ! Papatouah
fendait l'eau comme s'il l'avait suée toute lui-même,
douloureusement. Il défaisait une vaguelette après
l'autre avec des précautions de pansements. Le pilote,
me semblait-il de loin, devait être un mulâtre ; je dis
" semblait ", car je ne trouvai jamais l'entrain qu'il
aurait fallu pour monter là-haut sur la passerelle me
rendre compte par moi-même. Je restai confiné avec les
nègres, seuls passagers, dans l'ombre de la coursive,
tant que le soleil tenait le pont, jusque sur les cinq
heures.
[...] Enfin, nous approchâmes du port de
ma destination. On m'en rappela le nom : " Topo. " A
force de tousser, de crachoter, trembloter, pendant
trois fois le temps de quatre repas de conserves, sur
ces eaux de vaisselle huileuses, le Papaoutah
finit donc par aller accoster.
Sur la berge pileuse, trois énormes cases coiffées de
chaume se détachaient. De loin, cela vous prenait au
premier coup d'œil un petit
air assez engageant. L'embouchure d'un grand fleuve
sablonneux, le mien, m'expliqua-t-on, par où je devrais
remonter pour atteindre, en barque, le beau milieu de ma
forêt. A Topo, ce poste au bord de la mer, je ne devais
rester que quelques jours, c'était convenu, le temps de
prendre mes suprêmes résolutions coloniales.
Nous fîmes cap sur un léger embarcadère et le
Papaoutah, de son gros ventre, avant de l'atteindre,
rafla la barre. En bambou qu'il était l'embarcadère, je
m'en souviens bien. Il avait son histoire, on le
refaisait chaque mois, je l'appris, à cause des
mollusques agiles et prestes qui venaient par milliers
le bouffer au fur et à mesure. C'était même, cette
infinie construction, une des occupations désespérantes
dont souffrait le lieutenant Grappa commandant du poste
de Topo et des régions avoisinantes.
Le Papaoutah ne trafiquait qu'une fois par mois mais les
mollusques ne mettaient pas plus d'un mois à bouffer son
débarcadère.
[...] Le lieutenant Grappa préparait sa justice. Nous y
reviendrons. Il surveillait aussi de loin toujours et de
l'ombre de sa case, la construction fuyante de son
embarcadère maudit. A chaque arrivée du Papaoutah
il allait attendre optimiste et sceptique des
équipements complets pour ses effectifs.
(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1956, p.151).
*********
L'Infanta Combitta.
Il est bien rare que la vie revienne à votre chevet,
où que vous soyez, autrement que sous la forme d'un
sacré tour de cochon. Celui que m'avaient joué ces gens
de San Tapeta pouvait compter. N'avaient-ils pas profité
de mon état pour me vendre gâteux, tel quel, à
l'armement d'une galère ? Une belle galère, ma foi, je
l'avoue, haute de bords, bien ramée, couronnée de jolies
voiles pourpres, un gaillard tout doré, un bateau tout
ce qu'il y avait de capitonné aux endroits pour les
officiers, avec en proue, un superbe tableau à l'huile
de foie de morue représentant l'Infanta Combitta
en costume de polo. Elle patronnait, m'expliqua-t-on par
la suite, cette Royauté, de son nom, de ses nichons, et
de son honneur royal le navire qui nous emportait.
C'était flatteur.
(...) Ce capitaine de l'Infanta
Combitta avait eu quelque audace en m'achetant, même
à vil prix, à mon curé au moment de lever l'ancre. Il
risquait tout son argent dans cette transaction le
capitaine. Il aurait pu tout perdre. Il avait spéculé
sur l'action bénéfique de l'air de la mer pour me
ravigoter. Il méritait sa récompense. Il allait gagner
puisque j'allais mieux déjà et je l'en trouvais bien
content. (...) Il s'amusait bien à me voir essayer de me
soulever sur ma paillasse malgré la fièvre qui me
tenait. Je vomissais. " Bientôt, allons, merdailleux,
vous pourrez ramer avec les autres ! " me prédit-il.
(...) On se fatiguait assez peu pendant cette traversée parce qu'on
voguait la plupart du temps sous voiles. Notre condition
dans l'entrepont n'était guère plus nauséeuse que celle
des ordinaires voyageurs des basses classes dans un
wagon du dimanche et moins périlleuse que celle que
j'avais endurée à bord de l'Amiral Bragueton pour
venir. Nous fûmes toujours largement éventés pendant ce
passage de l'est à l'ouest de l'Atlantique. La
température baissa. On ne s'en plaignait guère dans les
entreponts. On trouvait seulement que c'était un peu
long. Pour moi, j'en avais assez pris des spectacles de
la mer et de la forêt pour une éternité.
(...) L'Infanta Combitta roula
encore pendant des semaines et des semaines à travers
les houles atlantiques de mal de mer en accès et puis un
beau soir tout s'est calmé autour de nous. Je n'avais
plus de délire. Nous mijotions autour de l'ancre. Le
lendemain au réveil, nous comprîmes en ouvrant les
hublots que nous venions d'arriver à destination.
C'était un sacré spectacle !
(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1956, p.183).
*********
Le remorqueur.
De loin, le
remorqueur a sifflé ; son appel a passé le pont, encore
une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin,
plus loin... Il appelait vers lui toutes les péniches du
fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la
campagne et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi,
tout, qu'on n'en parle plus.
(Dernières phrases du Voyage).
*********
Le trois-mâts russe et le
charbonnier.
Il a proposé lui-même qu'on aille faire un tour vers
le port... Il s'y connaissait en navires. Il se
souvenait de toute sa jeunesse. Il était expert en manœuvres.
On a laissé maman avec ses bardas, on a piqué vers les
bassins. Je me souviens bien du trois-mâts russe, le
tout blanc. Il a fait cap sur le goulet à la marée de
tantôt. Depuis trois jours il bourlinguait au large de
Villiers, il labourait dur la houle... il avait de la
mousse plein ses focs... Il tenait un cargo terrible en
madriers vadrouilleurs, des monticules en pleine pagaye
sur tous ses ponts, dans les soutes rien que de la
glace, des énormes cubes éblouissants, le dessus d'une
rivière qu'il apportait d'Arkangel exprès pour revendre
dans les cafés...
 Il avait pris dans le mauvais temps une bande énorme et
de la misère sur son bord... On est allés le cueillir
nous autres avec papa, du petit phare jusqu'à son
bassin. L'embrun l'avait tellement drossé que sa grande
vergue taillait dans l'eau... Le capitaine, je le vois
encore, un énorme poussah, hurler dans son entonnoir,
dix fois fort encore comme mon père ! Ses lapins, ils
escaladaient les haubans, ils ont grimpé rouler là-haut
tous les trémats, la toile, toutes les cornes, les
drisses jusque dessous le grand pavillon de
Saint-André... On avait cru pendant la nuit qu'il irait
s'ouvrir sur les roches. Les sauveteurs voulaient plus
sortir, y avait plus de Bon Dieu possible... Six bateaux
de pêche étaient perdus. Le " corps marin " même, sur le
récif du Trotot il avait rué un coup trop dur, il était
barré dans ses chaînes... Ça
donnait une idée du temps.
Il avait pris dans le mauvais temps une bande énorme et
de la misère sur son bord... On est allés le cueillir
nous autres avec papa, du petit phare jusqu'à son
bassin. L'embrun l'avait tellement drossé que sa grande
vergue taillait dans l'eau... Le capitaine, je le vois
encore, un énorme poussah, hurler dans son entonnoir,
dix fois fort encore comme mon père ! Ses lapins, ils
escaladaient les haubans, ils ont grimpé rouler là-haut
tous les trémats, la toile, toutes les cornes, les
drisses jusque dessous le grand pavillon de
Saint-André... On avait cru pendant la nuit qu'il irait
s'ouvrir sur les roches. Les sauveteurs voulaient plus
sortir, y avait plus de Bon Dieu possible... Six bateaux
de pêche étaient perdus. Le " corps marin " même, sur le
récif du Trotot il avait rué un coup trop dur, il était
barré dans ses chaînes... Ça
donnait une idée du temps.
Devant le café " La Mutine " y a eu la
manœuvre aux écoutes... sur
bouée d'amarres avec une dérive pas dangereuse... Mais
la clique était si saoule, celle du hale, qu'elle savait
plus rien... Ils ont souqué par le travers... L'étrave
est venue buter en face dans le môle des douaniers... La
" dame " de la proue, la sculpture superbe s'est embouti
les deux nichons... Ce fut une capilotade...
Ça en faisait des étincelles... Le beaupré a
crevé la vitre... Il s'est engagé dans le bistrot... Le
foc a raclé la boutique. Ça
piaillait autour en émeute... Ça
radinait de tous les côtés. Il a déferlé des jurons...
Enfin tout doux... Le beau navire s'est accosté... Il a
bordé contre la cale, criblé de filins... Au bout de
tous les efforts, la dernière voilure lui est retombée
de la misaine... étalée comme un goéland.
L'amarre en poupe a encore un grand coup gémi... La terre embrasse le
navire. Le cuistot sort de sa cambuse, il lance à
bouffer aux oiseaux râleurs une énorme écuelle. Les
géants du bord gesticulent le long de la rambarde, les
ivrognes du débarquement sont pas d'accord pour
escalader la passerelle... les écoutilles pendent... Le
commis des écritures monte le premier en redingote... La
poulie voyage au-dessus avec un bout de madrier... On
recommence à se provoquer... C'est le bastringue qui
continue... Les débardeurs grouillent sur les drisses...
Les panneaux sautent... Voici l'iceberg au détail !...
Après la forêt !... Fouette cocher !... Le charroi
s'amène... Nous n'avons plus rien à gagner, les émotions
sont ailleurs.
Nous retournons au sémaphore,
c'est un charbonnier qu'on signale. Par le travers du "
Roche Guignol " il arrive en berne. Le pilote autour
danse et gicle avec son canot d'une vague sur l'autre. Il se
démène... Il est rejeté... enfin il croche dans
l'échelle... il escalade... il grimpe au flanc. Depuis
Cardiff le rafiot peine, bourre la houle... Il est
tabassé bord sur bord dans un mont d'écume et
d'embrun... Il rage au courant... Il est déporté vers la
digue... Enfin la marée glisse un peu, le requinque, le
refoule dans l'estuaire... Il tremble en rentrant,
furieux, de toute sa carcasse, les paquets le
pourchassent encore. Il grogne, il en râle de toute sa
vapeur. Ses agrès piaulent dans la rafale. Sa fumée
rabat dans les crêtes, le jusant force contre les
jetées.
gicle avec son canot d'une vague sur l'autre. Il se
démène... Il est rejeté... enfin il croche dans
l'échelle... il escalade... il grimpe au flanc. Depuis
Cardiff le rafiot peine, bourre la houle... Il est
tabassé bord sur bord dans un mont d'écume et
d'embrun... Il rage au courant... Il est déporté vers la
digue... Enfin la marée glisse un peu, le requinque, le
refoule dans l'estuaire... Il tremble en rentrant,
furieux, de toute sa carcasse, les paquets le
pourchassent encore. Il grogne, il en râle de toute sa
vapeur. Ses agrès piaulent dans la rafale. Sa fumée
rabat dans les crêtes, le jusant force contre les
jetées.
Les " casquets " au ras d'Emblemeuse on les discerne, c'est le moment...
Les petites roches découvrent déjà sur la marée basse...
Deux cotres en perte tâtent un passage... La tragédie
est imminente ; il faut pas en perdre une bouchée...
Tous les passionnés s'agglomèrent à la pointe de la
digue, contre la cloche de détresse... On scrute les
choses à la jumelle... Un des voisins nous prête les
siennes. Les bourrasques deviennent si denses qu'elle
bâillonnent. On étouffe dessous... Le vent grossit la
mer encore... elle gicle en gerbes haut sur le phare...
elle s'emporte au ciel.
Mon père enfonce sa casquette... Nous ne rentrerons
qu'à la nuit... Trois pêcheurs rallient démâtés... Au
fond du chenal leurs voix résonnent... Ils
s'interpellent... Ils s'empêtrent dans les avirons...
Maman, là-bas est inquiète, elle nous attend à la "
Petite Souris ", le caboulot des mareyeurs... Elle a pas
vendu grand-chose... On ne s'intéresse plus nous autres
que dans les voyages au long cours.
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.135).
*********
Le cargo des Indes.
Un
terrible râle de chaudière m'a réveillé en sursaut !...
Un bateau longeait la rive... Il forçait contre
courant... Les " Salvations " de tout à l'heure ils
étaient barrés... Les nègres sautaient sur l'estrade...
Ils cabriolaient en jaquette... Ils rebondissaient sur
la chaussée... Les pans mauves frétillaient derrière,
dans la boue et l'acétylène. Les " Ministrels " c'était
inscrit sur leur tambour... Ils arrêtaient pas...
Roulements... Dégagements... Pirouettes !... Une grande
énorme sirène a déchiré tous les échos... Alors la foule
s'est figée... On s'est rapprochés du bord, pour voir la
manœuvre d'abordage... Je me
suis calé dans l'escalier, juste tout près des vagues...
La marmaille des petits canots s'émoustillait dans les
remous à la recherche du filin... La chaloupe, la grosse
avec au milieu sa bouillotte, l'énorme tout en cuivre,
elle roulait comme une toupie... Elle apportait les
papiers. Il résistait dur au courant le " cargo " des
Indes... Il tenait toujours la rivière dans le milieu du
noir... Il voulait pas rapprocher... Avec son
œil vert et son rouge...
Enfin, il s'est buté quand même, le gros sournois,
contre un énorme fagot qui retombait du quai... Et ça
craquait comme un tas d'os... Il avait le nez dans le
courant, il mugissait dans l'eau dure... Il ravinait
dans sa bouée... C'était un monstre à l'attache... Il a
hurlé un petit coup... Il était battu, il est resté là
tout seul dans les lourds remous luisants... On est
retournés vers le manège, celui des orgues et des
montagnes...
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.245).
**********
Tous les modèles.
Un
soir je l'ai aperçu mon père... Il longeait les grilles.
Il s'en allait aux commissions... Alors pour pas courir
le risque, je restais plutôt dans le Carrousel... Je me
planquait entre les statues... Je suis entré une fois au
Musée... C'était gratuit à l'époque. Les tableaux, moi
je comprenais pas, mais en montant au troisième, j'ai
trouvé celui de la Marine. Alors je l'ai plus quitté.
J'y allais très régulièrement. J'ai passé là, des
semaines entières... Je les connaissais tous les
modèles... Je restais seul devant les vitrines...
J'oubliais tous les malheurs, les places, les patrons,
la tambouille... Je pensais plus qu'aux bateaux... Moi,
les voiliers, même en modèles, ça me faisait franchement
déconner...
J'aurais bien voulu être marin... Papa aussi
autrefois... C'était mal tourné pour nous deux !... Je
me rendais à peu près compte...
En rentrant à l'heure de la soupe, il me demandait ce que j'avais fait
?... Pourquoi j'arrivais en retard... - J'ai cherché !
que je répondais... Maman avait pris son parti. Papa, il
grognait dans l'assiette... Il insistait pas davantage.
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.351).
*********
|