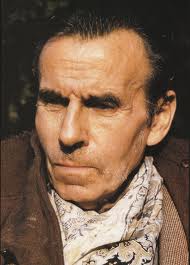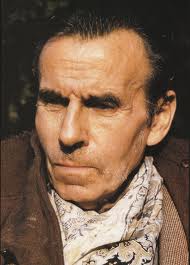|
SES
VOYAGES
Son dernier voyage. Ce
1er juillet 1961...
Evocation de ce dernier voyage à partir de la
documentation célinienne disponible et de la presse de
l'époque.
Philippe Alméras : Céline entre haines et passions,
Robert Laffont 1994.
François Gibault : Céline, 1944-1961, Cavalier de l'Apocalypse,
Mercure de France, 1981.
Jean Guenot : Louis-Ferdinand Céline damné par l'écriture, chez
l'auteur, 1973.
Pierre Monnier : Ferdinand furieux, L'Age d'Homme, 1979.
Erika Ostrovsky : Céline, le voyeur-voyant, Ed. Buchet-Chastel, 1972.
Paul Del Perugia : Céline, Nouvelles Editions Latines, 1987.
Robert Poulet : Mon ami Bardamu, Plon, 1971.
Dominique de Roux : La mort de L-F Céline, Christian Bourgois,
1966.
Frédéric Vitoux : La vie de Céline, Grasset, 1988.
... Chaleur d'été. Paris en
stagnation : presque une nécropole où ne viennent que
les étrangers. Des boulangeries fermées d'où l'odeur du
pain s'est envolée et des canalisations éventrées par
les travaux. Tous les habitants sont partis pour
célébrer l'exode annuel à la campagne ou à la mer.
La route des Gardes se déploie au soleil, plonge dans la brume, serpente
depuis Versailles jusqu'au lointain palais du Louvre.
Ancienne route des rois de France. Flanquée à présent de
modestes pavillons, avec les usines Renault en bas.
Seuls les pavés d'autrefois demeurent et aussi la
splendeur continue de la vallée de la Seine. La route se
traîne le long de clôtures de maçonnerie et de villas en
mauvais état, puis s'élève à un sentier étroit, presque
dissimulé à la vue.
Une rude montée conduit à trois
maisons identiques. Style Louis-Philippe, séparées par
des jardins et de vieux arbres. Elles dominent le paysage au-dessous d'elles. Rappel de
la noblesse d'antan. La dernière (" Villa Maïtou
") est fermée par de hautes portes jaunes. Elle est
haute et crépie sur un soubassement de pierre. Une allée
pavée de dalles de ciment rose contourne le gazon par la
droite. Ce qui frappe le plus, en montant cette allée,
c'est le contraste entre le style du pavillon
Louis-Philippe et les peintures bleu piscine des
barrières. C'est là que vivent depuis dix ans
Louis-Ferdinand Destouches et son épouse Lucette.
Elles dominent le paysage au-dessous d'elles. Rappel de
la noblesse d'antan. La dernière (" Villa Maïtou
") est fermée par de hautes portes jaunes. Elle est
haute et crépie sur un soubassement de pierre. Une allée
pavée de dalles de ciment rose contourne le gazon par la
droite. Ce qui frappe le plus, en montant cette allée,
c'est le contraste entre le style du pavillon
Louis-Philippe et les peintures bleu piscine des
barrières. C'est là que vivent depuis dix ans
Louis-Ferdinand Destouches et son épouse Lucette.
La vue sur Paris et la Seine a
emporté un choix qui par ailleurs déroute. La cuisine
est à l'entresol. Céline travaille et dort au
rez-de-chaussée, Lucette a aménagé les deux étages
supérieurs pour la danse. La vue profite surtout au
studio. Le confort est très relatif, le chauffage
central existe mais l'installation est ancienne et on ne
l'allume pas souvent. On a ajouté des chauffage au gaz.
Nul chauffage nécessaire ce 1er
juillet 1961 : une vague de chaleur submerge la France.
La veille, il a fait plus de 32° à Paris et la météo
annonce qu'il fera encore plus chaud aujourd'hui, avec
une tendance orageuse accrue. Ce temps est dû à la
présence d'un anticyclone, solidement ancré sur l'Europe
centrale et qui commande sur l'hexagone un chaud flux du
sud.
Le grand soleil de la veille
ramène une aurore presque incandescente, Villa Maïtou,
les chiens, les chats, le perroquet s'ébrouent déjà dans
l'ombre de la maison. Les journaux du matin regorgent de
publicités pour les boissons rafraîchissantes - le 1/4
Ricqlès ou le " Tonic Water " de Perrier - et les glaces
Motta à la crème fraîche, " désormais fabriquées en
Normandie ".
A propos de l'Algérie, De
Gaulle confie en privé que " la seule solution
raisonnable reste l'association. " Et d'ajouter : "
Si tout accord avec le GPRA (Gouvernement
provisoire de la République algérienne) est
impossible, nous regrouperons les Français autour
d'Alger et d'Oran. "
Céline a fini par considérer la guerre d'Algérie comme un
évènement mineur en comparaison des problèmes Est-Ouest
et surtout de celui posé par la Chine. Dixit un
confrère, le docteur Robert Brami, familier du 25 ter
route des Gardes. Dans quelques jours, trois mois après
les accords d'Evian et deux jours après le référendum
d'autodétermination en Algérie, le président de la
République annoncera officiellement la reconnaissance
par la France de l'indépendance de l'Algérie. Si les
attentats au plastic se multiplient à Alger, le pire est
encore à venir... En métropole, la majorité des Français
n'en ont cure. Le grand rush des vacances a commencé en
ce premier week-end de juillet. Les citadins s'en vont,
sous la chaleur, à la recherche du calme, de la
fraîcheur, de l'eau... C'est le Tour de France qui
passionne les foules. La veille, le Belge Planckaert a
fait cavalier seul au Ballon d'Alsace et a gagné,
détaché, à Belfort.
Oui, l'été a surgi, torride.
Depuis quelques jours, Céline se retire sous la pierre
de sa maison, brûlante comme la Casbah. Il ne supporte
plus le soleil, sortant au crépuscule : " Je vais aux
commissions. " Il rapporte la viande des bêtes,
marcheur qui a perdu son ombre. Les gens de Meudon en le
croisant auraient pu dire, comme les habitants de Vérone
au sujet de Dante : " Eccovi l'uom ch'è stato all
inferno " (Voyez, l'homme qui a été en enfer).
Un autre médecin, André
Willemin, lui rend régulièrement visite : " Il s'est
enfermé dans cette villa de Meudon comme dans un
fortin... Sa carcasse ne l'intéresse plus, lui qui a été
un athlète et un cuirassier héroïque de 14. Il
l'abandonne aux
intempéries... Il ne trouve jamais plus de deux à trois
heures d'un sommeil constamment interrompu. Après
minuit, il erre dans la maison... "
" Quand il arrête de travailler, dit Lucette, il a le sang à la
tête, les mains qui tremblent, les jambes qui
flageolent, il me fait peur. " - " Je te dis que je vais
crever ! " répète Céline...
Chaleur étouffante dès le matin
de ce samedi 1er juillet. Lucette, levée à six heures,
trouve Louis à la cave, à la recherche d'un peu de
fraîcheur, l'air absent. Il accepte de remonter dans sa
chambre et de s'allonger. Il lui dit : " Ferme tout.
Je ne peux pas supporter la lumière. " Cette
photophobie annonce l'hémorragie cérébrale qui va le
foudroyer quelques heures plus tard...
En fin de matinée, Serge
Perrault passe, comme il le fait souvent, mais Céline
refuse de le voir. Il ne veut voir personne. Au tout
début de l'après-midi, Marie-Claude et Rose de France
viennent travailler avec Lucette au premier étage. Vers
quinze heures, Marie-Claude descend dans la chambre de
Céline pour boire une tasse de thé. Il se sent un peu
mieux et plaisante gentiment.
" Ce jour-là, il se plaignit
de la tête plus que d'habitude. Je lui ai appliqué des
compresses. Il s'est allongé, nu, tellement il avait
chaud. Et son bras droit est devenu glacé, ce qui était
étonnant par une journée aussi caniculaire. Le sang n'y
circulait plus. Je pense que l'hémorragie cérébrale du
côté gauche était déjà commencée. Tout de suite, j'ai
deviné que la crise était anormale. J'ai voulu appeler
un médecin mais son médecin traitant n'était pas là.
J'ai pensé à Willemin . Louis m'a dit : " Je te défends de l'appeler, je
ne veux pas, je veux qu'on me laisse crever tranquille,
je ne veux ni piqûre ni médecin, je ne veux plus rien. "
Tout devait suivre la nature jusqu'au bout.
A la fin de
l'après-midi, sa poitrine se soulève douloureusement
pour des inspirations de plus en plus saccadées et
courtes. Il suffoque. Vers dix-huit heures, sa poitrine
se soulève une dernière fois.
Au-dehors, un soleil toujours éclatant, et,
dans la maison, une étrange impression de silence et
d'apaisement. Etrange ? Pourquoi ?... Au bout d'un
moment, on comprend que les animaux se sont tus. Il n'y
a plus un aboiement, les chats sont invisibles, cachés,
il n'y a plus un pépiement d'oiseaux. Toto le perroquet
ne parle plus... Il va rester des mois sans parler...
Quelques jours
auparavant, Christian Dedet, jeune confrère et romancier
comme lui, est l'un des derniers à avoir une vraie
conversation avec Céline :
" Je lui ai rendu visite vingt-quatre heures avant sa mort. J'ai été
frappé parce qu'il faisait une canicule épouvantable ce
jour-là et lui, il avait plusieurs tricots de laine. En
plus de tout ça, il grelottait, il avait froid. Il
s'asseyait, il se levait parce qu'il tenait en place
nulle part, il avait des douleurs partout, il était très
arthrosique, et en plus il avait des sifflements dans
l'oreille, des maux de tête.
J'ai pensé qu'il avait le centre de régulation thermique atteint,
peut-être par une tumeur du cerveau, peut-être par
l'évolution en sclérose de son artério-sclérose
cérébrale dont officiellement il est mort mais je me
demande s'il n'avait pas une tumeur au cerveau. "

" La mort, disait Céline à la fin
de sa vie, m'est toujours présente. A chaque seconde
de ma vie, je l'ai vue et je la vois, en moi, en face de
moi. Tout homme qui me parle est à mes yeux un mort ; un
mort en sursis, si vous voulez ; un vivant par hasard et
pour un instant. Quant à ma mort à moi, c'est ce que
j'ai de plus présent, de plus conscient. Ma grande
préoccupation , pour le moment, n'est-elle pas de
protéger ma femme, autant que possible, contre les
désagréments qui peuvent l'atteindre quand je ne serai
plus ?
Travaillant, écrivant, je poursuis cette idée, je m'installe donc
continuellement par l'esprit dans l'avenir proche pour
moi comme pour nous tous, où je serai mort et enterré. A
cette seconde où je vous parle, j'ai la cervelle occupée
à la fois
par les choses dont nous parlons et par la conviction
que maintenant, tout de suite, je peux m'affaisser et
rendre mon dernier souffle. Mais cette hantise ne
m'attriste pas, ne me paralyse pas, comme tant de
morts-vivants qui jouent à
cache-cache avec la pourriture. "
Pour conclure,
donnons la parole à un quatrième médecin, André Jacquot,
qui délivra cette manière d'épitaphe : " C'était un
esprit curieux de tout, lisant énormément, s'intéressant
aux problèmes les plus complexes comme aux choses les
plus banales. Il aimait s'entretenir avec les gens les
plus simples et il les écoutait avec patience et
attention. Servi par une prodigieuse mémoire, il
possédait une érudition extraordinaire qui lui
permettait de traiter avec compétence n'importe quel
sujet...
Malgré la vigueur de ses écrits, il s'est toujours défendu d'être un
doctrinaire, encore moins un chef de file... La seule
création originale qu'il revendiquait avec véhémence
parfois, c'était son style si particulier... Par
ailleurs, sa règle de vie
était : ne rien devoir à personne. Son esprit
d'indépendance était poussé à tel point qu'il n'accepta
aucune aide matérielle dans ses moments de grande
détresse...
Il avait horreur de l'embrigadement et détestait l'esprit de système...
Avec cela, il était un confrère excellent, sans
prétention, ignorant la jalousie. "
Cinquante ans après, un
tel diagnostic est-il encore admis par la bien-pensance
qui le voit résolument en grand écrivain ennemi du genre
humain ?
(BC n°318, avril 2010).
MEUDON
Peu après l'ordonnance
d'amnistie, le 1er juillet 1951, Céline et Lucette
prirent l'avion pour la France.
Ils emmenaient avec eux non seulement le chat Bébert, mais aussi la
chienne Bessy adoptée à Korsör ainsi que deux autres
chats.
Ils décollèrent de l'aérodrome de Kastrup, près de Copenhague, en
direction de Nice. Céline auparavant, avait tenu à
remercier la population de Korsör de son hospitalité,
par le biais d'un article publié dans le journal local.

Ils passèrent l'été sur la Côte
d'Azur où résidaient les parents de Lucette, à Menton.
Ils rencontrèrent Albert Paraz,
retiré à Vence.
En septembre, ils regagnèrent Paris et s'installèrent dans un pavillon du
bas Meudon dont ils venaient de faire l'acquisition, au
25 ter route des Gardes.
C'était une belle demeure
délabrée et sans confort, construite au milieu du siècle
dernier, et fort mal distribuée avec ses pièces les unes
au dessus des autres, sur trois niveaux. Elle dominait,
elle domine encore la Seine face à l'île Seguin et aux
usines Renault.
Céline ne devait plus guère en
bouger jusqu'à sa mort. Il demeura là, travaillant sans
relâche, ne s'accordant aucune
distraction, refusant toujours aussi obstinément de
boire une goutte d'alcool ou de fumer une seule
cigarette... Pas une sortie au restaurant, au théâtre,
au cinéma. Rien.
Lucette ouvrit là un cours de
danse, et Céline - ou plutôt le Dr Destouches - un
cabinet médical. Mais si Lucette put bénéficier assez
vite d'une clientèle de jeunes élèves qui venaient, au
premier étage, s'initier aux " danses classiques et de
caractère " sous l'œil
attentif et fatigué de l'écrivain, qui les voyait monter
et descendre en attendant que battent au plafond les
coups sourds de leurs exercices, lui, au contraire ne
pratiqua plus guère la médecine...
Sa réputation sulfureuse s'était vite répandue dans le
quartier. Sa vie de bohème et de sauvage faisait peur
aux patients. Jamais ou presque le docteur ne sortait de
chez lui. Il recevait peu et décourageait ses visiteurs.
Entouré de la meute assez terrifiante de ses chiens
molosses : Bessy, Agar, Balou..., vêtu d'un
amoncellement incroyable de pull-overs mités enfilés les
uns par-dessus les autres, il ne soignait guère que les
malades non prévenus se risquant jusqu'à sa porte, ou
les voisins trop pauvres pour se payer un médecin en
apparence plus rassurant...
Du reste, tous les journalistes
ou les amis venus le voir après la guerre, à Meudon, ont
gardés de Céline la même impression de méfiance bourrue,
de défiance loquace, de misère à la fois ostensible et
cachée. Trop ostensible pour être tout à fait vraie,
trop cachée aussi pour ne pas receler l'amertume des
grandes solitudes et l'habitude des souffrances qui
oppressent.
Dès 1951, les éditions
Gallimard avaient racheté les droits des
œuvres de Céline (à
l'exception de ses pamphlets) et les republièrent toutes
entre mars et mai 1952.
Bébert venait de mourir, ses maîtres l'avaient enterré dans le jardin de
Meudon... En juin 1952 sortait Féerie pour une autre
fois, le premier livre de Céline où le chat faisait
entendre ses miaulements. Le silence de la critique fut
total et l'échec public évident.
Céline souffrit de cet isolement intellectuel qu'atténuèrent un peu
le soutien (tant matériel que moral) de Gaston
Gallimard, la bienveillance affectueuse de Jean Paulhan
(avec lequel il se brouilla bien vite) et surtout
l'amitié de Roger Nimier. On peut presque dire que
Céline se maintint alors en vie (intellectuelle) par la
seule correspondance qu'il échangea avec eux.
En juin 1954, Gallimard
publia la suite de Féerie, intitulée Normance
- et ce fut le même échec et le même silence. C'est à ce
moment-là que Céline écrivit Entretien avec le
professeur Y (publié à l'origine dans La Nouvelle
Revue Française), qui reste une manière d'art
poétique provocateur et bouffon dont la gravité - cachée
- passa alors inaperçue.
Peu à peu se brisa
pourtant l'étau de silence qui pesait sur Céline. Des
écrivains situés à gauche comme Maurice Nadeau, Gaétan
Picon ou Jean-Louis Bory eurent le courage tranquille
d'afficher leur admiration pour l'auteur de Voyage au
bout de la nuit. Ce roman publié en " Livre de poche
" bénéficia dès 1956 d'une diffusion massive et toucha
de nouveaux lecteurs. Dans Arts ou dans
Paris-Match parurent des articles ou reportages sur
l'ermite de Meudon. Robert Poulet publia
 chez
Plon son livre Entretiens familiers avec L.F.
Céline... chez
Plon son livre Entretiens familiers avec L.F.
Céline...
Et surtout, en 1957, parut
D'un château l'autre, que cette fois-ci la critique
accueillit bruyamment. L'auteur fut l'invité de Pierre
Dumayet à l'émission de télévision Lectures pour tous
(le document est saisissant), il s'exprima à la radio
suisse-romande, il donna à L'Express une
interview tonitruante et provocatrice qui choqua nombre
de ses amis de droite, il polémiqua avec Roger
Vaillant... La force de son roman s'imposa. Des
étudiants et des universitaires apprirent le chemin de
Meudon.
La publication de Nord
en 1960 confirma amplement ce regain d'intérêt. Céline
échappait déjà de son vivant au purgatoire. N'entra-t-il
pas en 1960 dans la collection " La Pléiade ", pour
Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit
préfacés par le professeur Henri Mondor ? Pendant
longtemps, seuls André Malraux, Henri de Montherlant et
lui-même connurent ce privilège d'y avoir été publiés de
leur vivant.
Le 1er juillet 1961,
alors qu'il venait d'achever la deuxième version de son
roman Rigodon, Céline fut frappé d'une rupture
d'anévrisme et mourut subitement. Il fut inhumé le 4
juillet au cimetière de Meudon.
" Nous n'étions pas trente
pour l'accompagner au cimetière. Le curé de la paroisse
lui avait refusé son eau bénite. Tous les honneurs ! Il
pleuvait. Un enterrement incomparable, celui que
méritait Céline. "
(Lucien Rebatet, Cahiers de l'Herne
n° 3). (F. Vitoux, Céline, Dossiers Belfond, 1978).
KLARSKOVGAARD, près du
port de KORSÖR
Le 19 mai 1948, Céline
et Lucette (et toujours Bébert), acceptent l'invitation
de Thorvald Mikkelsen, leur avocat.
Ils partent pour la propriété de celui-ci à Klarskovgaard, près du port de
Korsör, au bord de la Baltique.
Des pavillons qui composaient le domaine,
ils occupent surtout le plus modeste et le plus retiré :
Fanehuset(littéralement, la " maison du drapeau
", demeure assez inconfortable, semble-t-il, sans eau
courante, au sol de terre battue, chauffée par des feux
de tourbe à la chaleur parcimonieuse, affirmera Lucette
Destouches.
Que dire de ces longs mois
d'exil à Klarskovgaard ? Céline et sa femme y mènent une
vie austère, rude, laborieuse et triste. On connaît leur
témoignage... Céline multiplie ses correspondances,
comme pour se maintenir en vie.
Un jeune universitaire américain d'origine juive, Milton Hindus, se
passionne pour son œuvre,
lui écrit et vient même lui rendre visite. Leur entente
fut de courte durée.
En vérité, ce n'est pas à
Korsör mais à un millier de kilomètres de là que
l'actualité célinienne se développe alors. Si le 17
octobre 1949, l a cour de justice de la Seine vient
d'arrêter les poursuites engagées contre Céline, le 3
septembre de la même année le commissaire du
gouvernement réclame à son encontre l'application de la
loi pénale concernant les délits mineurs contre la
sûreté de l'Etat. a cour de justice de la Seine vient
d'arrêter les poursuites engagées contre Céline, le 3
septembre de la même année le commissaire du
gouvernement réclame à son encontre l'application de la
loi pénale concernant les délits mineurs contre la
sûreté de l'Etat.
Le 21 février 1950, la cour de
justice rend son arrêt (un an d'emprisonnement, 50 000
francs d'amende, indignité
nationale),
mais un an plus tard, ces mêmes cours seront dissoutes.
Le 25 avril 1951, enfin, entre
en vigueur l'ordonnance d'amnistie rendue par le
tribunal militaire de Paris.
Sur le plan littéraire,
Casse-pipe avait été publié en 1948 dans les
Cahiers de la Pléiade, grâce à Jean Paulhan qui prit
la défense de l'écrivain.
C'est dans Le Gala des vaches d'Albert Paraz, ouvrage consacré en
partie à Céline, que figura A l'agité du bocal,
qui était encore inédit. Le ballet Foudres et Flèches
sortit chez un petit éditeur, Jonquières. Pierre Monnier
republia Casse-pipe, Mort à crédit et Scandale aux
abysses...
La polémique ne désarme pas en
France, bien entendu. L'heure est encore aux procès
d'épuration. Le Comité national des écrivains tranche
des bons et mauvais romanciers. (" Ces haineux " disait
Paraz).
Mais du moins commence-t-on à reparler timidement de l'auteur de
Voyage au bout de la nuit.
(F. Vitoux, Céline,
1978).
* * *
Quand Louis,
Bébert et elle débarquèrent à Klarskovgaard le 19 mai,
dans le bourgeonnement soudain du printemps tardif, dans
ce pays sans réelles demi-saisons, où, à l'hiver
interminable succédait un été miraculeux et trop bref,
se doutaient-ils qu'ils allaient y rester plus de trois
ans, ballottés dans cette propriété d'une demeure à une
autre, à attendre, à s'ennuyer, à écrire, à recevoir de
trop rares visites, à suivre de loin les péripéties des
actions en justice engagées contre l'écrivain, à
observer les efforts malheureux de petits éditeurs pour
relancer ses ouvrages d'avant-guerre ? Lui allait
souffrir de névralgies sans cesse plus prononcées. Elle
tomberait malade. Le vieux Bébert, âgé de quinze ans,
partagerait bientôt sa vie et l'intimité de ses maîtres
avec de nouveaux compagnons, une chienne et d'autres
chats ; après des mois d'enfermement dans une soupente
de Copenhague, il retrouverait surtout une certaine
liberté, rôdant en lisière de la forêt, dans la solitude
inquiétante de la nature. Formidable destin pour ce chat
de Montmartre !
Comment raconter la vie de Céline en cette période ? En évoquant
d'abord son existence au jour le jour, ses rencontres,
ses misères, ses découragements. Puis en distinguant ce
qui fut au fond ses deux principales préoccupations : la
republication difficile de ses livres, pour briser la
conspiration du silence qui s'acharnait sur lui dans le
climat de l'après-guerre, et bien sûr les étapes de ses
procès...
Ils débarquèrent donc du train à
Korsôr avec leurs bagages de bohémiens, leurs valises
miteuses, leurs casseroles, quelques livres. Un taxi les
emmena à Klarskovgaard. Mikkelsen n'était pas là.
Personne pour les accueillir, les aider à s'installer.
Ils logèrent pour quelques jours dans la demeure
principale. Louis put fouiner dans la bibliothèque. Les
choses se présentaient en somme assez bien. Mais dès
l'arrivée de l'avocat, ils durent déménager. Ils se
replièrent dans la maison d'amis. Pour une brève période
seulement. Car la vie mondaine de Klarskovgaard
commençait, avec ses « célébrités » que Mikkelsen s'enorgueillisait
de fréquenter.
« Louis n'était pas un homme de la campagne, explique
Lucette, et Korsôr, c'était la campagne, ce n'était
pas la vraie mer, celle que Louis aimait, Le Havre,
Saint-Malo, les mouvements des bateaux, du port. En face
de Korsôr s'étendait une mer grise, pas salée du tout,
sans marée, où l'on péchait des poissons qui n'avaient
pas de goût. Nous n'avions pas la même façon de voir,
lui et moi. L'aspect sauvage de cette côte me plaisait
plutôt. Je me baignais chaque jour, je me lavais dans la
mer. Elle était glacée l'hiver, ça ne me gênait pas.
Vivre ainsi, c'était tout naturel pour moi. Mais Louis
ne s'adaptait pas, ne parvint jamais à s'adapter.
Il vécut ce séjour tragiquement, comme un lion en cage.
Et puis il y avait ces déménagements incessants, d'une
maison à l'autre, comme des domestiques qu'on loge comme
on peut et que l'on chasse, dès qu'on a besoin de
récupérer les lieux qu'ils occupent. Vous savez, même
changer de cellule pour un prisonnier qui ne possède
presque rien, c'est un monde de désarroi. Louis avait
ses liasses de papier sur sa table, ses manuscrits en
cours, autour de lui le chat, ses animaux, ses
habitudes. Il fallait empaqueter nos affaires dans des
boîtes. Pour lui, c'était vraiment pénible. Et la cabane
(Fanehuset) était des plus rudimentaire. Sans compter
qu'il régnait un drôle de climat. Du jour au lendemain,
l'été finissait. Ça devenait du vent, du froid, de la
nuit. Il n'y avait qu'à regarder les arbres. A moins
d'un kilomètre d'où nous étions, nous apercevions des
dunes et les arbres qui s'y agrippaient avaient des
allures de nains qu'on aurait torturés. Ils avaient tenu
à la terre parce qu'ils voulaient vivre — mais dans quel
état ! Par chance, il y avait partout des oiseaux, des porcs-épics, des chats. J'aimais les
observer...
oiseaux, des porcs-épics, des chats. J'aimais les
observer...
Mikkelsen ? Il adorait recevoir. Des ambassadeurs, des
personnalités anglaises surtout. A peine arrivé chez
lui, il nous conviait à déjeuner. Nous n'y tenions pas
particulièrement. Ces convenances, ces mondanités !
Louis ne voulait pas se donner en spectacle, faire le
clown devant tous ces gens, comme Mikkelsen l'espérait.
Alors, il se renfermait, se renfrognait. Il ne disait
pas un mot. Il faisait celui qui ne parlait pas anglais.
Et puis on rentrait dans notre baraque. Par la suite, on
a renoncé à ces déjeuners. »
Premières visites personnelles pour Céline, peu après son
arrivée à Klarskovgaard, celle de l'éditeur américain
James Laughlin le 25 mai et de l'écrivain et journaliste
danois Ole Vinding le 12 juin. Ce dernier habitait alors
à une quinzaine de kilomètres de la propriété de
Mikkelsen. Il éprouva tout de suite une vive affection
doublée d'une grande admiration pour Céline. Ils prirent
l'habitude, dès lors, de se revoir assez souvent.
Surtout, il sut fort bien l'observer, le décrire, le
comprendre en profondeur tout en épiant chez lui les
symptômes les plus apparents de la maladie, du délire...
En ce premier été de Klarskovgaard, la visite la plus
déterminante, la plus éclairante aussi pour comprendre
Céline, fut sans conteste celle de Milton Hindus, du 20
juillet au 11 août. Le jeune universitaire américain
s'était décidé enfin à faire le voyage, à s'embarquer
pour l'Europe, à rencontrer Céline, cet écrivain
antisémite qu'il admirait et qui lui inspirait une si
troublante fascination. Il l'avait écrit au préalable
dans son journal intime : « Céline est une écharde
plantée dans mon esprit. Il faut que je l'absorbe ou la
rejette — complètement. »
Avant de gagner le
Danemark, Milton Hindus avait d'abord séjourné à Paris
où il avait rencontré la plupart des amis de Céline :
Marcel Aymé, Gen Paul, etc. A la demande de Céline, il
avait même été voir Guy Tosi, le directeur littéraire de
Denoël qui lui avait confié une lettre à l'intention de
l'écrivain.
A peine arrivé à Korsôr où Céline lui avait
retenu une chambre au-dessus d'un cabaret, un vrai
taudis, le logement le moins cher qu'il ait pu trouver,
le jeune universitaire (qui allait changer d'hôtel très
vite) fut frappé par la tristesse, la mélancolie,
l'usure de cet homme qui lui sembla si malade, accablé
de soucis. Ils se virent presque quotidiennement durant
le séjour de l'Américain. Tantôt Louis et Lucette
allaient en bicyclette jusqu'à Korsôr, tantôt Milton
Hindus qui avait loué un vélo, se rendait chez eux, à
Fanehuset.
Une Française, Mme Dupland, que Lucette avait connue à Copenhague
(elle habitait à l'étage au-dessous de Karen, au 20 Ved
Stranden), assista à de nombreux entretiens entre Céline
et Milton Hindus. Elle ne devait pas être d'une
indulgence excessive à l'égard de ses anciens voisins. «
C'est certainement de Madame D... que je tiens les
détails les moins ragoûtants sur Céline. » Elle
contribua sans nul doute à renforcer l'impression de
désenchantement, de déception que Milton Hindus éprouva
très vite à l'égard de l'auteur du Voyage.
On voit bien ce qui pouvait
nuire à Céline dans le livre de Milton Hindus : ses
propos rapportés sur Mikkelsen et les Danois, sur
l'antisémitisme, etc. Mais en niant tout en bloc et
jusqu'à la réalité de leurs rencontres, Céline
faisait-il preuve de cynisme, mentait-il délibérément ?
Je ne le crois pas. Toujours ce formidable aveuglement
célinien, cette façon d'écarter, presque de bonne foi,
une réalité qui le gênait ! Ses amnésies restaient aussi
sélectives que ses exagérations. Il balayait les
obstacles, les déceptions. Hindus n'avait manifestement
rien compris à sa singularité de créateur. Tant pis pour
Hindus ! Hindus du coup n'avait jamais existé. A peine
Céline l'avait-il aperçu une ou deux fois. Il en était
maintenant persuadé. Rien n'existait au-delà de
Klarskovgaard, du Danemark, de l'étroit domaine de ses
illusions et de ses souffrances.
Et l'été 48 se poursuivit pour lui dans la chaumière de Fanehuset
où, depuis le 9 août, il correspondait avec le médecin
et écrivain suédois Ernst Bendz, ancien vice-président
de l'Alliance française de Gôteborg. Bendz ne tarissait
pas d'éloges à son égard. Avec Raoul Nordling, le consul
général de Suède à Paris, il interviendra par la suite
pour épauler l'écrivain, tenter de plaider sa cause
auprès de la justice française lors de l'instruction de
son procès...
A qui Céline du reste n'écrivait-il pas ? Durant ces années
interminables de Klarskovgaard, c'était toujours pour
lui une façon de se maintenir en vie, sous pression, de
s'entraîner, de rompre son isolement. Pas de jour où il
n'envoyait au moins deux ou trois lettres, à Le Vigan ou
à Paraz, au pasteur Lochen ou à Daragnès, à Jean Paulhan
ou à Albert Naud, au docteur Camus ou à Marie Canavaggia
— au total près de 4 000 lettres emportées, violentes,
contradictoires, nostalgiques, tendres, affectueuses,
désespérées, envieuses, lumineuses, sombres, lyriques,
mesquines, généreuses, où il n'hésitait pas à critiquer
ses amis, ses collègues, ses relations, ses rivaux, à se
plaindre furieusement, à envier les autres, tous les
autres pour ne se soucier que de lui seul, et puis à
faire preuve soudain d'une tendre et inattendue
compassion pour son destinataire. Il soignait ainsi
Paraz à distance, s'inquiétait des manifestations de sa
tuberculose, etc. Bref, des lettres qui ressemblaient à
des conversations à bâtons rompus, libres, désinvoltes,
vagabondes, intimes, où Céline baissait sa garde,
n'écrivait pas pour la postérité, pour donner de lui une
image flatteuse mais s'abandonnait à la liberté
contradictoire de ses émotions et de ses révoltes de
l'instant, de ses petitesses et de sa grandeur.
Dès l'été 1948, un nouveau compagnon vint tenir auprès de lui
une place muette et considérable : la chienne Bessy
qu'il mit du temps à apprivoiser, que Bébert n'approcha
tout d'abord qu'avec la plus extrême circonspection et
dont Lucette se souvient avec la plus intense émotion...
« Dans la ferme où logeaient les Petersen, il y avait une
sorte de grande cage cubique en fer et là-dedans un
chien, un berger allemand très beau, très maigre, qui
avait l'air d'un loup affamé et sauvage. A peine
approchait-on qu'il montrait les crocs. Un chien
furieux. Alors nous leur avons demandé ce que faisait ce
chien là. Les Petersen nous ont répondu que les
Allemands, en partant, avaient laissé des chiots. Ils
les avaient tués, n'en avaient gardé qu'un seul,
soi-disant pour tuer les lapins, ces lapins sauvages qui
proliféraient dans la propriété et dévoraient les
plantations. Une fois par semaine, ils libéraient le
chien à qui ils ne donnaient pratiquement jamais à
manger, ils le lâchaient comme une bête sauvage, il
devait se nourrir en tuant des lapins. La chienne
revenait les pattes en sang. Ils la réenfermaient
jusqu'à la fois suivante. Quand on a vu la misère de
cette chienne qui n'avait jamais à manger, on a voulu
l'adopter.
Louis a donné un peu d'argent aux fermiers. Bessy était
vraiment une bête sauvage. Elle avait peur de nous, de
tout. L'apprivoiser nous a pris du temps. Il a fallu
beaucoup de gentillesse, de soins, de patience. On
l'avait attachée d'abord avec une corde, on avait peur
qu'elle nous bouffe Bébert et une autre chatte qui nous
avait adoptés depuis peu. Louis travaillait à sa table,
dans la petite chaumière, avec cette corde autour de la
taille qui retenait Bessy à l'autre bout. Ah ! je les
vois encore... Sitôt qu'elle apercevait Bébert, hop,
elle se précipitait. Et Bébert, lui, voulait s'approcher
de Louis et de la table. C'était épouvantable. J'ai
souvent vu Louis valdinguer avec cette chienne qui
tirait de toutes ses forces. A la longue, elle s'est
adoucie. Elle n'avait plus peur d'être battue. Elle
n'avait jamais connu d'affection. Et elle est devenue
d'un attachement à toute épreuve. Bébert dormait au
creux de son ventre. Il mangeait dans la même gamelle,
du porridge avec un peu de lait qu'on achetait à Korsôr.
La chienne, les chats, nous, nous mangions tous la même
chose. »
A la fin de l'été se présenta à Klarskovgaard un jeune
admirateur de Céline, Pierre Monnier, qui travaillait
comme dessinateur pour l'hebdomadaire Aux écoutes
et s'était retrouvé par hasard au Danemark, cet été là,
parachuté attaché de presse d'un groupe folklorique
auvergnat intitulé « La Bourrée », qui entamait
une tournée de trois semaines. C'était l'occasion de
rencontrer Céline. Il n'hésita pas. Un taxi, et il
débarqua un beau jour avec un ami devant la chaumière de
Fanehuset pour une première rencontre de près de trois
heures.
Pour Monnier, ce fut une sorte de coup de foudre face à cet
immense écrivain aux yeux bleu-gris si clairs, à la voix
grave et aux fous rires parfois si communicatifs. «
De retour à Paris, je lui écris et lui fais part de ma
décision de lui apporter autre chose que des paroles
d'encouragement... Je ne sais pas très bien ce que je
vais faire, mais mon désir de l'aider est net, précis.
Il faudra bien qu'il se matérialise. » Il allait se
matérialiser en effet. Nous y reviendrons...
Le 3 septembre 1948, toujours d'après les carnets de Mikkelsen,
nous savons que les Destouches quittèrent Fanehuset pour
la maison un peu plus spacieuse mais guère plus
confortable de Skovly. C'est une habitude qu'ils
allaient prendre chaque année, passant l'hiver à Skovly,
émigrant à Fanehuset dès le printemps, avec l'arrivée
des beaux jours et des invités dans les autres demeures
de Mikkelsen.
Ce premier hiver fut maussade, froid, humide, dans cette
demeure si parcimonieusement chauffée avec son méchant
poêle de tourbe. Louis souffrait plus que jamais de
vertiges et de migraines. Il n'en pouvait plus de manger
du porridge à longueur de repas, des pommes de terre et
du hareng fumé. Les Petersen leur donnaient parfois du
lait, des fruits, assez chichement. Louis se rendit fin
novembre à un interrogatoire de police à Copenhague —
sans conséquences. Quelques nouvelles visites vinrent
tromper son ennui — celle de Raoul Nordling en janvier
et en mars 1949 par exemple.
En février, il retourna à Copenhague pour deux ou trois
jours. L'occasion d'arpenter l'asphalte, de faire
quelques courses, d'aller une fois au cinéma avec
Lucette, de demander au consulat de France un passeport
qui lui fut bien entendu refusé. Ils logèrent pour
l'occasion dans le petit bureau de Mikkelsen que Louis
et Lucette avaient soigné tout l'été de furoncles mal
placés et qui, de son côté, s'apprêtait à partir en
France (en emmenant peut-être le solde des pièces d'or
de Céline, pour pouvoir les changer). Sinon, c'était la
routine, les correspondances à expédier, le manuscrit de
Féerie qu'il reprenait et complétait sans cesse,
insatisfait, et qui finira par se dédoubler avec les
volumes : Féerie pour une autre fois et Normance.
De fait, les Pirazzoli séjournèrent bien à Korsôr
au printemps de cette année-là, dans la propre maison de
Mikkelsen, mais ils ne s'y attardèrent pas, trouvant la
vie là-bas trop maussade, trop ennuyeuse...
En été, Céline reçut la visite de deux nouveaux journalistes,
Jean et Marianne Kohler. Le premier relata leur
rencontre dans Carrefour du 15 septembre, la
seconde dans Paroles françaises du 30 décembre
1949. Céline s'était montré à chaque fois fort prudent.
Ne disant rien contre le Danemark. Se plaignant mezzo
voce. S'exprimant en idées générales. Exhalant sa
mélancolie de la France, aspirant à retourner n'importe
où, l'Afrique du Nord ou la Nouvelle-Calédonie, pourvu
qu'il y flottât un drapeau français.
Henri Mahé vint le voir en juillet. Rencontre heureuse entre
deux hommes qui s'éloignaient pourtant l'un de l'autre,
dont la complicité ne tenait qu'aux années insouciantes
et bohèmes d'avant-guerre - complicité qui n'avait pas
su se renouveler, se lester d'un plus grand poids à
l'épreuve du tragique, de la guerre, des revers de
fortune.
Le 7 décembre mourut Lucien Descaves. Encore une porte qui se
fermait pour Céline, un rideau de tiré sur son passé, un
deuil supplémentaire, un nouveau fantôme pour l'escorter
désormais dans sa vie qui ressemblait à une longue
marche funèbre.
1948, 1949, 1950...
Les jours, les mois, les années se traînaient pour lui, alors que
la Justice, en France, témoignait d'une patiente et
redoutable lenteur. Chez Mikkelsen, Céline rencontrait
de temps à autre Helga Pedersen qui était alors
secrétaire du ministre de la Justice et aussi Ottostrôm,
vieille relation d'avant-guerre, familier de la bande de
Karen, et qui était devenu pharmacien à Korsôr. Céline
ne manquait pas non plus de saluer à chacune de ses
visites Aage Seidenfaden, le chef de la police de Copenhague dont la bienveillance lui avait été
si bénéfique.
police de Copenhague dont la bienveillance lui avait été
si bénéfique.
A partir de mars 1950, il prit
l'habitude de correspondre avec Louis Lecoin, le vieil
anarchiste et objecteur de conscience qui comprenait
fort bien le pacifisme de Céline et entreprenait sa
défense avec ses propres moyens — Lecoin qui n'avait
cessé, à cause de ses opinions, d'être ballotté lui-même
de procès en procès, de prison en prison.
« Mon cher Lecoin, « (...) Vous êtes un saint de l'espèce saint
François... saint Vincent de Paul surtout. Sans
moquerie. Absolument. Je suis assez mystique moi-même.
Je vous comprends parfaitement. Vous faites votre vie,
votre légende en vivant à coup d'humanitarisme et de
prison. Vous payez horriblement votre Foi. Je vous
admire, je vous aime. Rien n'est gratuit, rien n'est
triché. »
André Pulicani, vieil ami de Montmartre, vint rendre visite à
Céline en mars 1950. « Je me souviens de cette pauvre
cabane des environs de Korsôr où j'avais eu la joie de
vous revoir tous deux et la tristesse de vous trouver
dans un dénuement terrible. »
Deux mois plus tard, les Destouches durent se rendre à
Copenhague. Lucette souffrait d'un fibrome. Il fallut
l'opérer d'urgence.
« Au moment de notre arrestation en décembre 1945,
j'avais mes règles. Elles se sont arrêtées subitement,
pour toujours. Je souffrais d'hémorragies à chaque
instant. J'étais épuisée. Un fibrome se formait sur un
ovaire, grossissait. Je ne disais rien. Et puis un jour,
Louis s'est aperçu de l'état dans lequel j'étais. Je ne
pouvais plus me lever. On est parti d'urgence pour
Copenhague où l'on m'a opérée le jour même. Sinon, je
risquais de mourir d'une dernière hémorragie. Louis
logeait dans un cagibi de l'appartement de Mikkelsen, où
il entassait des dossiers. On ne lui avait pas demandé
son avis pour l'opération. On ne l'avait pas laissé
entrer tout d'abord. Il rôdait sous les fenêtres de
l'hôpital. L'opération a été atroce. Je parlais très mal
l'anglais, je ne pouvais pas me faire comprendre,
j'étais trop faible.
Après l'intervention chirurgicale, la fièvre s'est mise à monter, à
monter. Louis pouvait enfin venir me voir dans la
chambre. La plaie s'était infectée. J'avais comme une
sorte de trou dans le ventre. Le médecin m'avait dit au
début : "Ah ! il faut vous lever, il faut vous secouer
un peu." Je n'avais pas beaucoup d'énergie. Ils m'ont
donc fait lever, afin d'éviter tout risque d'embolie. Je
me suis traînée jusqu'au bout du couloir, et la plaie
brutalement s'est rouverte, une éventration ! Je suis
tombée par terre. On m'a retrouvée là, on m'a ramenée à
la salle d'opération, on m'a recousue. Il n'y avait pas
de pénicilline à l'époque. Avec l'infection, c'était
effrayant à voir. Ils ne m'ont même pas endormie. Ils
m'ont recousue à vif, sans anesthésie, sans rien. Ils
m'ont dit que l'anesthésie serait sans effet parce qu'il
y avait trop de pus... Après, ils m'ont fichue sous un
drap, sur un chariot et je suis restée là de longues
heures, sans surveillance, sans calmant, sous un drap
comme si j'étais morte ! Le soir enfin, on m'a ramenée
dans mon lit. A trois reprises, j'ai subi de nouvelles
éventrations. Comment ai-je survécu ? " Si elle vit,
elle vit, si elle ne vit, elle ne vit pas ", disaient
les médecins, très philosophes, qui avaient l'air de
penser que bien d'autres avaient souffert avant moi,
avec la guerre et tout...
C'est le 15 juillet 1950 que Louis et Lucette regagnèrent seulement
Klarskovgaard, après l'hôpital. Le 25 mourut subitement
Jean-Gabriel Daragnès. Encore un deuil, un chagrin
auquel Céline ne pouvait que prendre part de loin, dans
son exil danois. « Au moins que certains chagrins
nous aident à ne plus regretter rien, je veux dire à
passer gentiment le pas, contents. »
Comme le monde lui paraissait distant, la politique,
l'actualité, les engagements de tout bord ! Certes,
Céline lisait les journaux, se tenait au courant, comme
on dit. Il n'ignorait rien de la guerre froide entre
Russie et Amérique, qui se frigorifiait davantage de
jour en jour. En juin, la guerre de Corée venait
d'éclater comme un abcès de fixation. La France
s'enlisait
en Indochine, face au Viêt-Minh. Roger Nimier, avec le
Hussard bleu, voulait réconcilier la littérature
française avec la désinvolture, l'élégance, la vitesse.
Une littérature de droite ? Sans doute. Surtout une
réaction contre les pesanteurs politiques, l'esprit de
revanche, les Temps modernes de Sartre, comme on
voudra.
Ce livre, à défaut du reste, compta pour Céline. Nimier lui
en avait adressé un exemplaire. Céline lui répondit le
15 octobre 1950 : « Ah monsieur vous me faites
joliment plaisir en m'envoyant votre hussard. Je me
marre dès la première page et à la vingtième j'arrête
plus ! Voilà un roman comme j'aime - en direct et savant
quand même, oh ! subtil habile roublard... sensible — oh
! là là, je désopile. Ah, c'est dur vous savez où je
suis, où j'en suis ! » Une sympathie très vive
allait naître dès lors entre les deux écrivains...
Marcel Aymé à son tour, le fidèle des fidèles, l'ami
taciturne, vint faire le pèlerinage à Klarskovgaard, du
8 au 11 mars 1951. Que se dirent les deux hommes ?
Probablement pas grand-chose. Plus exactement, Marcel
Aymé dut se taire et Céline monologuer à perdre haleine.
Une vieille habitude entre eux. Ils se comprenaient
ainsi, ils s'estimaient, ils étaient heureux de se voir.
L'essentiel était là. Non dans les paroles ou les
confidences mais dans cette sympathie mystérieuse et
profonde qui les unissait, eux les écrivains, les
familiers du silence.
Printemps 1951. Le séjour de Céline à Klarskovgaard touchait à son
terme. Il bénéficierait bientôt d'une loi d'amnistie.
Avec Lucette toujours lente à se rétablir, Bébert
vieillissant, la chienne Bessy et les nouveaux chats
Thomine, Flûte ou Poupine, il s'envolerait pour la
France. Finis le porridge, les patates et le hareng
fumé, les rapports parfois tendus avec les Petersen, le
confort approximatif des demeures de Mikkelsen où tout
de même, à Skovly, à partir de novembre 1949, un nouveau
puits permit une meilleure alimentation en eau courante
! Céline allait retrouver la France et ses proches.
Sa fille Colette ? Il lui avait écrit du Danemark à maintes
reprises des lettres affectueuses. Le 28 juin 1950, elle
avait mis au monde un cinquième enfant.
Ces grossesses répétées désolaient Céline qui tenait son gendre
pour un parfait imbécile. En décembre, il fallut opérer
Colette d'un fibrome. Comme l'a écrit François Gibault,
« Céline manifesta en cette occasion une extrême
inquiétude. Il demanda au docteur Camus d'assister à
l'opération et de lui envoyer le compte rendu
opératoire. Il téléphona souvent à Paris pour avoir des
nouvelles de sa fille, souffrit de son impuissance et de
ne pouvoir être avec elle. Il requit aussi de
nouveau les Marteau qui entourèrent Colette de leur
mieux et réglèrent les frais de son opération. »
Cette inquiétude, on en trouve d'autres traces dans la
correspondance de Céline. Dans les lettres qu'il
adressait en particulier à cette époque à Ernst Bendz. «
Je suis resté abasourdi par une mauvaise nouvelle, ma
fille (5 enfants !) opérée à Paris. »
Signalons par ailleurs que Paul Marteau avait été mis
en contact avec Céline, en 1948, par l'intermédiaire de
Daragnès. Cet industriel, propriétaire des cartes
Grimaud, disposait d'une très grosse fortune. Il voulait
aider Céline de son mieux. Pas question évidemment de
lui faire la charité. Il proposa d'acheter en mai 1947,
à un prix fort élevé, des pages manuscrites, au crayon,
de la version initiale de Féerie composée à la
prison de Vestre Faengsel. Dès lors, Paul Marteau et
Céline n'allaient cesser de correspondre. Céline
n'hésitait pas à lui demander de menus services, par
exemple de déposer de sa part un paquet de bonbons à sa
fille. Ce qui ne contribua hélas ! en aucun cas à lever
la méfiance, l'hostilité, la rancune que Colette devait
éprouver pour son père, sentiments que son mari attisait
probablement.
Rien ne pouvait atténuer non plus la rancœur, l'hostilité à peine
déguisée que Gen Paul manifestait à Céline depuis la
Libération. Comme s'il ne lui pardonnait pas de l'avoir
compromis, de l'avoir entraîné à Berlin en mars 1942, de
l'avoir fait inviter à l'ambassade d'Allemagne, de
l'avoir associé étroitement à lui en lui demandant
d'illustrer ses ouvrages.
Gen Paul avait filé assez vite en Amérique, dès la fin de la
guerre. Prudence, prudence... Il s'était plaint à qui
voulait l'entendre que tout était de la faute de Céline,
que lui-même n'avait aucune opinion, qu'il ne vendait
plus de tableaux maintenant par sa faute, etc. Céline
qui avait tant d'affection pour lui n'en prit pas
d'abord ombrage, même s'il souffrait au fond du lâchage
assez piteux de celui qui avait été sans conteste le
meilleur ami de ses dernières années parisiennes...
En novembre 1950, la nouvelle compagne de Gen Paul,
Gaby, vint rendre visite aux Destouches, à Klarskovgaard.
Pourquoi ? Gen Paul ne voulut jamais revoir Céline qui
finit enfin par juger très sévèrement le peintre. Comme
en fait foi cette lettre non datée de Céline à Le Vigan
: « Il paraît qu'il [Gen Paul] a peur de l'âge et de
crever ! La vie belle - complètement pourri. Il fait
plus que des gouaches. Il a plus le courage pour le
canevas - mais tout s'enlève - il est riche pas un rond
de frais. 800 fr de loyer par an ! Riche ça veut dire
terrible. Le passage de Léon Bloy est absolu... L'homme
riche est une brute inexorable qu'on ne peut arrêter
qu'avec une faux ou un paquet de mitraille dans le
ventre. »
Cette référence à Bloy n'a rien d'accidentel. Céline
découvrit son œuvre à Korsôr. Bloy le forcené, le
catholique vociférateur et intolérant, le vomisseur des
tièdes, le persécuté réel et imaginaire, l'exilé
volontaire des bords de la Baltique, qui vouait aux
protestants en général et aux Danois en particulier une
haine aussi féroce que son mépris, lui renvoyait en
somme une image à peine déformée de lui-même. Tous deux
étaient des grands stylistes, des pamphlétaires, des
hommes de l'excès, de la passion, de l'amour trop
souvent déçu et des violences jamais contrôlées...
Évoquer une dernière fois Céline dans le séjour
désolé de Klarskovgaard avant son retour en France,
c'est voir surgir derrière lui le fantôme de cet autre
écrivain français, Bloy, l'auteur du Désespéré,
qui campait lui aussi « au seuil de l'Apocalypse
».
COPENHAGUE
En mars 1945, alors que
l'Allemagne à feu et à sang s'apprêtait à céder
définitivement à la pression des troupes alliées, Céline
décrocha enfin son visa pour le Danemark.
Le 6 mars, Lucette, Bébert et lui prirent le train. Ulm, Kassel,
Göttingen, Hanovre, Hambourg, Flensbourg - une nouvelle
fois ils parcoururent l'Allemagne dans toute sa
longueur, du sud au nord. Le voyage dura trois semaines.
" Nous avons changé vingt-sept fois de train. Tout perdu et
brûlé en route, sauf le chat. Nous avons fait des
trente-sept kilomètres à pied, d'une armée à l'autre,
sous des feux pires qu'en 1917. " (Lettres au Dr Camus.
Ecrits de Paris, octobre 1961).
27 mars 1945 : Arrivés à
Copenhague encore occupée. Céline, Lucette et
Bébert trouvent asile au troisième étage d'un immeuble
bourgeois prêté par Karen Marie Jensen. Il apprend alors
successivement la mort de sa mère (6 mars), et le mandat d'arrêt lancé contre lui à Paris par la cour de
justice de la Seine pour trahison (19 avril).
mandat d'arrêt lancé contre lui à Paris par la cour de
justice de la Seine pour trahison (19 avril).
16 mai 1945 : Alors que le
Danemark a été libéré, première rencontre avec Me
Thorvarld Mikkelsen qui sera son avocat.
Il écrit péniblement la suite de Guignols band I, jette les
premières ébauches de Féerie pour une autre fois
et commence la rédaction d'un court ballet : Foudres
et Flèches.
Le 17 décembre 1945, à la suite
de l'annonce à la une d'un quotidien de Copenhague, de
la présence de Céline au Danemark, et alors que la
légation française venait de demander aussitôt son
extradition, Céline et Lucette sont écroués à la prison
Vestre Faengsel de la capitale. On conduit Bébert dans
une clinique vétérinaire.
Dix jours plus tard, Lucette, tenue sans nouvelle de son mari, est
libérée. Elle récupère Bébert et logera dans un tout
petit appartement sous les combles d'un immeuble du
centre de Copenhague, au 8 Kronprinsesse Gade.
L'année 1946 : Onze mois durant,
Céline va resté incarcéré à Copenhague dans des
conditions extrêmement dures, avec des va-et-vient entre
cellule et infirmerie. Il souffre de bourdonnements
incessants, atteint de la pellagre, ayant perdu toutes
ses dents, il finit par ne peser que soixante kilos pour
ses un mètre quatre-vingt.
Une fois par semaine, puis deux fois, Lucette peut venir le voir, avec
Bébert enfoui dans un sac qui sort son museau au bon
moment pour le renifler derrière les barreaux.
 Le
6 novembre 1946, Céline écrit un long mémoire pour se
justifier des accusations portées contre lui. A côté
d'argumentations et de réfutations précises, on peut
lire ces lignes pour le moins ahurissantes : " Les
Juifs devraient m'élever une statue pour le mal que je
ne leur ai pas fait et que j'aurais pu leur faire. Eux
me persécutent, je ne les ai jamais persécutés. " (Helga
Pedersen, Le Danemark a-t-il sauvé Céline ?, Plon, 1975). Le
6 novembre 1946, Céline écrit un long mémoire pour se
justifier des accusations portées contre lui. A côté
d'argumentations et de réfutations précises, on peut
lire ces lignes pour le moins ahurissantes : " Les
Juifs devraient m'élever une statue pour le mal que je
ne leur ai pas fait et que j'aurais pu leur faire. Eux
me persécutent, je ne les ai jamais persécutés. " (Helga
Pedersen, Le Danemark a-t-il sauvé Céline ?, Plon, 1975).
Le 8 novembre, il est
hospitalisé au Sundby Hospital.
Le 26 février 1947 : Après
plusieurs séjours en milieu hospitalier, il est admis au
Rigshospital de Copenhague (hôpital civil), et son
ordinaire s'améliore quelque peu.
Le 27 juin 1947 : les autorités
danoises le libèrent sur parole, mais Céline s'engage à
ne pas quitter le territoire.
Près d'une année durant, il
vécut alors avec Lucette au 8, Kronprinsesse Gade. Là,
il finit Guignol's band II (publié après sa mort
sous le titre contestable de Pont de Londres), et
poursuivit la rédaction des futurs Féerie pour une
autre fois et Normance.
Ulcéré par l'accusation de Sartre portée à son encontre dans ses
Réflexions sur la question juive ( " Si Céline a
pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est
qu'il était payé " ), il rédigea un court pamphlet
d'une violence inouïe dans son délire scatologique :
A l'agité du bocal. Sartre y devenait un ténia...
(F.
Vitoux, Céline, Dossiers Belfond, 1978).
SIGMARINGEN
Quand un
matin du début de novembre 1944, le bruit se répandit
dans Sigmaringen : « Céline vient de débarquer »,
c'est de son Kränzlin que le bougre arrivait tout droit.
Mémorable rentrée en scène. Les yeux encore pleins du
voyage à travers l'Allemagne pilonnée, il portait une
casquette de toile bleuâtre, comme les chauffeurs de
locomotives vers 1905, deux ou trois de ses canadiennes
superposant leur crasse et leurs trous, une paire de
moufles mitées pendues au cou, et au-dessous des
moufles, sur l'estomac, dans une musette, le chat
Bébert, présentant sa frimousse flegmatique de pur
Parisien qui en a connu bien d'autres.
Il fallait voir, devant l'apparition de ce trimardeur,
la tête des militants de base, des petits miliciens : «
C'est ça, le grand écrivain fasciste, le prophète génial
? » Moi-même, j'en restais sans voix.
Louis-Ferdinand,
relayé par Le Vigan, décrivait par interjections la
gourance de Kränzlin, un patelin sinistre, des Boches timbrés,
haïssant le Francose, la famine au milieu
 des troupeaux
d'oies et de canards. En somme, Hauboldt était venu le
tirer cordialement de ce trou, et Céline, apprenant
l'existence à Sigmaringen d'une colonie française, ne
voulait plus habiter ailleurs. des troupeaux
d'oies et de canards. En somme, Hauboldt était venu le
tirer cordialement de ce trou, et Céline, apprenant
l'existence à Sigmaringen d'une colonie française, ne
voulait plus habiter ailleurs.
La première stupeur passée, on lui faisait fête. Je le
croyais fini pour la littérature. Quelques mois plus
tôt, je n'avais vu dans son Guignol's Band qu'une
caricature épileptique de sa manière (je l'ai relu ce
printemps, un inénarrable chef-d'œuvre,
Céline a toujours eu dix, quinze ans d'avance sur nous).
Mais il avait été un grand artiste, il restait un
prodigieux voyant.
Nous nous sommes rencontrés tous les jours pendant
quatre mois, seul à seul, ou en compagnie de La Vigue,
de Lucette, merveilleuse d'équilibre dans cette débâcle
et dans le sillage d'un tel agité. Céline, outre sa
prescience des dangers et cataclysmes très réels, a été
constamment poursuivi par le démon de la persécution,
qui lui inspirait des combinaisons et des biais fabuleux
pour déjouer les manœuvres de quantité d'ennemis
imaginaires. Il méditait sans fin sur des indices
perceptibles de lui seul, pour parvenir à des solutions
à la fois aberrantes et astucieuses. Autour de lui, la
vie s'enfiévrait aussitôt de cette loufoquerie
tressautante, qui est le rythme même de ses plus grands
bouquins. Cela aurait pu être assez vite intolérable.
Mais la gaieté du vieux funambule emportait tout.
L'auditoire des Français, notre affection le
ravigotaient d'ailleurs, lui avaient rendu toute sa
verve. Bien qu'il se nourrît de peu, le ravitaillement
le hantait : il collectionnait par le marché noir les
jambons, saucisses, poitrines d'oies fumées. Pour
détourner de cette thésaurisation les soupçons, une de
ses ruses naïves était de venir de temps à autre dans
nos auberges, à l' « Altem Fritz », au « Baren
», comme s'il n'eût eu d'autres ressources, partager la
ration officielle, le « Stammgericht », infâme
brouet de choux rouges et de rutabagas. Tandis qu'il
avalait la pitance consciencieusement, Bébert le «
greffier » s'extrayait à demi de la musette, promenait
un instant sur l'assiette ses narines méfiantes, puis
regagnait son gîte, avec une dignité offensée.
" Gaffe Bébert ! disait Ferdinand. Il se laisserait crever
plutôt que de toucher à cette saloperie... Ce que ça
peut être plus délicat, plus aristocratique que nous,
grossiers sacs à merde ! Nous on s'entonne, on
s'entonnera de la vacherie encore plus débectante.
Forcément ! "
Puis, satisfait de sa manœuvre, de nos rires, il s'engageait dans
un monologue inouï, la mort, la guerre, les armes, les
peuples, les continents, les tyrans, les nègres, les
faunes, les intestins, le vagin, la cervelle, les
Cathares, Pline l'Ancien, Jésus-Christ. La tragédie
ambiante pressait son génie comme une vendange. Le cru
célinien jaillissait de tous côtés. Nous étions à la
source de son art. Et pour recueillir le prodige, pas un
magnétophone dans cette Allemagne de malheur ! (Il en
sort à présent cinquante mille par mois chez Grundig
pour enregistrer les commandes des mercantis noyés dans
le suif du « miracle » allemand.)
Dans la vaste bibliothèque du château des Hohenzollern
Céline avait choisi une vieille collection de la
Revue des Deux Mondes, 1875-1880. Il ne tarissait
pas sur la qualité des études qu'il y trouvait : «
Ça, c'était du boulot sérieux... fouillé, profond,
instructif... Du bon style, à la main... Pas de blabla.
» C'est la seule lecture dont il se soit jamais
entretenu devant moi. Il était extrêmement soucieux de
dissimuler ses « maîtres », sa « formation ». Comme si
son originalité ne s'était pas prouvée toute seule,
magnifiquement.
De temps à autre, quand nous nous promenions tous deux sans témoin,
le dépit lui revenait de sa carrière brisée, mais sans
vaine faiblesse, sur le ton de la gouaille :
" Tu te rends compte ? Du pied que j'étais parti... Si j'avais pas
glandé à vouloir proférer les vérités... Le blot que je
me faisais... Le grand écrivain mondial de la « gôche
»... Le chantre de la peine humaine, de la connarderie
absurde... Sans avoir rien à maquiller. Tout dans le
marrant, Bardamu, Guignol, Rigodon... Prix Nobel... Les
pauvres plates bouses que ça serait, Aragon, Malraux,
Hemingway, près du Céline... gagné d'avance... Ah ! dis
donc, où c'est que j'allais atterrir !... « Maî-aître
»... Le Nobel... Milliardaire... Le Grand Crachat...
Doctor honoris causa... Tu vois ça d'ici ! "
[...] Les Allemands passaient tout à Céline, non point à cause de ses
pamphlets qu'ils connaissaient mal, mais parce qu'il
était chez eux le grand écrivain du Voyage, dont
la traduction avait eu un succès retentissant. Le fameux
colonel Boemelburg lui-même, terrible bouledogue du S.D.
et policier en chef de Sigmaringen, s'était laissé
apprivoiser par l'énergumène. Il fallait bien d'ailleurs
que Céline fût traité en hôte exceptionnel pour être
arrivé à décrocher le phénoménal « Ausweis », d'un mètre
cinquante de long, militaire, diplomatique, culturel et
ultra-secret, qui allait lui permettre, faveur unique,
de franchir les frontières de l'Hitlérie assiégée.
Il n'avait pas fait mystère de son projet danois : puisque tout
était grillé pour l'Allemagne, rejoindre coûte que coûte
Copenhague, oh il avait confié dès le début de la guerre
à un photographe de la Cour son capital de droits
d'auteur, converti en or, et que ledit photographe avait
enterré sous un arbre de son jardin. L'existence, la
récupération ou la perte de ce trésor rocambolesque
n'ont jamais pu être vérifiées. Mais sur la fin de
février ou au début de mars, on apprit bel et bien que
Céline venait de recevoir le mythique « Ausweis » pour
le Danemark.
Deux ou trois jours plus tard, pour la
première fois, il offrit une tournée de bière, qu'il
laissa du reste payer à son confrère, le docteur
Jacquot. À la nuit tombée, nous nous retrouvâmes sur le
quai de la gare. Il y avait là Véronique, Abel Bonnard,
Paul Marion, Jacquot, La Vigue, réconcilié après sa
douzième brouille de l'hiver avec Ferdine, deux ou trois
autres intimes. Le ménage Destouches, Lucette toujours
impeccable, sereine, entendue, emportait à bras quelque
deux cents kilos de bagages, le reliquat sans doute des
fameuses malles, cousus dans des sacs de matelots et
accrochés à des perches, un véritable équipage pour la
brousse de la Bambola-Bramagance.
Un lascar, vaguement infirmier,
les accompagnait jusqu'à la frontière, pour aider aux
transbordements, qui s'annonçaient comme une rude
épopée, à travers cette Allemagne en miettes et en feu.
Céline, Bébert sur le nombril, rayonnait, et même un peu
trop. Finis les « bombing », l'attente résignée de la
fifaille au fond de la souricière. Nous ne pèserions pas
lourd dans son souvenir. Le train vint à quai, un de ces
misérables trains de l'agonie allemande, avec sa
locomotive chauffée au bois. On s'embrassa longuement,
on hissa laborieusement le barda. Ferdinand dépliait,
agitait une dernière fois son incroyable passeport.
Le convoi s'ébranla, tel un tortillard de Dubout. Nous
autres, nous restions, le cœur serré, dans l'infernale
chaudière. Mais point de jalousie. Si nous devions y
passer, du moins le meilleur, le plus grand de nous tous
en réchapperait.
(Lucien Rebatet, Mémoire d'un
fasciste (1941-1947), Pauvert, 1976, Extrait).
KRÀNZLIN
Bébert dans sa fameuse gibecière percée de petits trous,
Lucette, Le Vigan et Céline débarquèrent donc à Berlin
début septembre 1944. Leur dernière visite remontait aux
premiers jours de juillet. En deux mois la ville avait
subi d'innombrables bombardements. A peine la
reconnurent-ils. Bâtiments dévastés, gravats, éboulis...
« C'était une ville plus qu'en décors... des rues
entières en façades, tous les intérieurs croules,
sombres dans les trous... »
Ils y restèrent environ huit jours.
Louis se rendit tout d'abord à l'hôtel Adlon, le
meilleur sans doute de Berlin. Pourtant économe, il
avait pris ainsi l'habitude de ne descendre, à
l'étranger, que dans des palaces. L'Adlon, il
avait pu l'apprécier au cours de son bref séjour
berlinois de mars 1942, quand il avait remis les clés de
son coffre de Copenhague à Karen.
« Vous voulez une chambre ?
— Deux chambres !... une pour moi, ma femme !... et une pour notre ami, là
!...
Ce portier est de la grande époque, la redingote plus que vaste, à
passementeries très vermicelle, casquette de
super-amiral... mais il aperçoit Bébert !... sa tête
!... Bébert aussi le regarde fixe...
Vous avez un chat ?
Foutre, il le voit !... clac !... il referme son registre !... il veut
plus de nous !
Aucun animal n'est admis !... »
L'équipe dut se rabattre sur un gîte plus modeste que Céline dénomme
le « Zénith Hôtel » dans Nord, tenu par un gérant-moujik
à barbe, bottes et chemise bouffante, originaire de
Sibérie et possible rescapé de l'armée Vlassof...
Grâce à Epting, Céline rencontra donc le docteur Hauboldt à qui Céline
avait été rapidement présenté en juin 42, à l'occasion
d'une conférence faite par son collègue allemand au
Cercle européen sur les problèmes hygiéniques et
prophylactiques posés par le rapatriement et
l'émigration des populations d'origine allemande au
cours de l'hiver 1939-1940. Le titre exact de Hauboldt ?
Céline, dans Nord, l'avait promu au rang de S.S.-Reichoberartz.
L'intéressé, dans le procès qui suivra la publication de
Nord, intenté par la famille Scherz qui se jugeait
diffamée, précisera que ses fonctions étaient plus
modestes : responsable du seul service des émigrés de
souche allemande, et mobilisé dans la Waffen S.S. Il y
occupait de toute façon le poste élevé de
Standartenfïïhrer et s'occupait réellement des relations
de la Chambre des médecins du Reich avec l'étranger. Le
docteur Knapp, à ce titre, était l'un de ses
subordonnés. Hauboldt travaillait et séjournait à Berlin
au 62 Konigsallee dans le quartier résidentiel de
Grùnwald. Il occupait une belle et vaste demeure de
style classique dont les sous-sols avaient été
transformés en bunker pour y regrouper ses services.
Selon Céline dans Nord, Hauboldt (qui deviendra Harras dans
la nouvelle édition de l'ouvrage consécutive au procès)
les reçut en peignoir « citron et bleu ciel », au
moment où il s'apprêtait à prendre un bain dans sa
piscine privée. Luxe extravagant, nourriture abondante,
éclairages tamisés au milieu d'un essaim de dactylos
ravissantes avec en bruit de fond le bourdonnement des
téléscripteurs alors que loin, très loin à la surface,
la ville s'effondrait par pans entiers, hantée par plus
de fantômes que d'êtres vivants.
Hauboldt donna à Céline l'autorisation d'exercer officiellement la
médecine en Allemagne. L'équivalence des diplômes
facilitait singulièrement cette mesure. Il lui offrit
par ailleurs, semble-t-il, un poste médical fixe, bien
rétribué, que l'écrivain refusa. Il lui proposa alors un
refuge hors de Berlin, dans une vaste demeure
appartenant à des amis personnels, les Scherz, où
étaient déjà regroupés quelques services sanitaires
dépendant de son autorité. Difficile pour l'écrivain de
refuser cette dernière offre. La demeure en question,
Krànzlin, était proche du village de Neuruppin, à
une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Berlin.
Ce qui rapprochait déjà un peu Céline et ses compagnons
de Rostock et Warnemûnde d'où ils pourraient peut-être
s'embarquer pour le Danemark...
A Berlin, Céline eut encore le temps de dîner avec Karl
Epting, le 10 septembre, dans une taverne en sous-sol de
la Wilhelmstrasse. Alain Laubreaux le surexcité de Je
suis partout s'était joint au groupe. Ce fut sans
doute un repas mélancolique entre Epting et Céline, une
conversation entre deux hommes de culture trop lucides
qui devaient évoquer l'avant-guerre sous un paysage de
ruines.
Vers le 15 septembre, le quatuor Bébert-Lucette-Le
Vigan-Céline arriva donc à Krànzlin, conduit
peut-être directement par Hauboldt en grand uniforme de
Waffen S.S.
« Soit ! la vie continue !... une très grosse
voiture... pas une gazogène... à essence !... il prend
le volant... nous sommes en septembre... il fait beau...
leur campagne en septembre tourne au rouge, les
feuilles... il fait déjà plus que frais... il va pas
vite... nous traversons tout Grùnwald, des allées de
villas en décombres... et puis des étendues de terres
grises... où sûrement rien ne pousse... genre de
cendre... pas du paysage aimable !... deux... trois
arbres... une ferme au loin... plus près un paysan qui
bine, je crois... »
Et ils découvrirent alors le vaste domaine agricole des
Scherz, Krànzlin, où ils allaient séjourner près
d'un mois et demi.
D'abord le manoir, une grande et belle demeure
rectangulaire construite au XIXe siècle
vraisemblablement, avec deux demi-tours d'angle de
chaque côté de la façade principale (l'une surplombant
de la hauteur d'un étage le toit du bâtiment)
Le rez-de-chaussée était légèrement surélevé, sous un
unique premier étage. Les fenêtres qui ouvraient à
hauteur du sol appartenaient à des pièces sensiblement
enfoncées sous terre : cuisines, débarras, offices. Des
vignes vierges couvraient une partie des murs. Le manoir
était entouré d'une vaste pelouse où s'élevaient des
arbres plus que
centenaires. Un peu plus loin
s'étendait le domaine agricole avec ses fermes, granges
et
 baraquements récemment construits. Enfin, non loin de
l'habitation principale se dressait un pavillon
d'habitation du style maison de jardinier assez
luxueuse, bordé d'une galerie en bois. baraquements récemment construits. Enfin, non loin de
l'habitation principale se dressait un pavillon
d'habitation du style maison de jardinier assez
luxueuse, bordé d'une galerie en bois.
Au manoir habitait le vieux Erich Scherz, quatre-vingts
ans révolus et ancien capitaine de cavalerie, le type
même du soldat prussien. Céline en fit un gâteux notoire
qui s'efforçait de culbuter les petites Polonaises du
domaine ou d'uriner sur elles. Rien ne permet
d'authentifier cette assertion que les Scherz eurent
toutes les raisons du monde de juger diffamatoire. Au
premier étage séjournait également la sœur de son épouse
disparue, Fraulein Kàthe Lake, qui jouait du piano avec
plus de vigueur que de musicalité. Des employés du
service de santé (Dienststelle) de Hauboldt logeaient
encore dans ce bâtiment où furent accueillis avec un
dédain non déguisé, comme des indésirables qu'il fallait
le moins possible fréquenter, Céline et Lucette dans une
petite chambre-réduit du rez-de-chaussée, sans eau
courante et sans chauffage, et Le Vigan dans une pièce
du sous-sol sans aération, non loin des cuisines
inaccessibles et torturantes.
Erich Scherz le fils dirigeait en fait le domaine depuis la
retraite de son père. Agé de quarante-cinq ans, il
vivait au pavillon avec son épouse Asta et leurs deux
enfants Udo et Anne-Marie. Paralysé depuis dix ans à la
suite d'une poliomyélite, Erich junior ne quittait pas
son fauteuil. Un prisonnier russe à la taille et à la
force monumentales l'escortait, le soulevait, le
déposait selon ses ordres.
Enfin, au domaine agricole se côtoyaient différentes communautés :
quelques prisonniers français, des objecteurs de
conscience allemands (Bibelforscher) qui construisaient
des baraquements, des prisonniers russes qui assuraient
toutes les tâches agricoles du domaine, des réfugiés
ukrainiens et polonais, d'anciennes prostituées de
Berlin recyclées dans les travaux forcés et même une
communauté de gitans logés dans des baraquements ou des
roulottes.
Et Bébert ? Lucette se souvient encore d'une petite domestique
allemande qui travaillait dans le bunker de Grùnwald et
était tombée amoureuse du chat. Elle profitait chaque
week-end d'une liaison de service entre Berlin et
Krânzlin pour lui apporter d'affreux petits poissons
qu'elle avait dû pêcher pour lui au bord d'un lac ou
d'un ruisseau. Bébert faisait-il grand cas de ce présent
? Lucette en était du moins infiniment touchée.
Les Scherz demandèrent un jour aux Destouches de leur confier justement
le chat pour chasser des souris dans les sous-sols. «
On leur a donc prêté Bébert une nuit, on l'a apporté
dans la cave. Ils étaient très gênés. C'était la caverne
d'Ali-Baba, cette cave, tant il y avait de victuailles.
Bébert s'en foutait, des souris. Il n'a rien chassé du
tout. On a dû le ramener. Cela a encore entraîné des
discussions avec les Scherz. Ils avaient pris Bébert
comme on prend un outil. Nous, on avait vu des jambons,
des saucissons et tout. Bébert n'avait rien mangé. Il
n'était pas si gourmand. »
Autre personnalité locale, le Landrat chargé de
l'administration de la région de Neuruppin, que Lucette
ne portait pas précisément dans son cœur depuis qu'il
avait menacé d'éliminer Bébert. « Il l'avait pris par
les pattes et voulait le tuer en le lançant contre un
mur. Je ne comprenais pas bien. En fait, il disait que
Bébert n'était pas reproductif. Les animaux domestiques
châtrés devaient être tués. Je n'ai d'ailleurs jamais vu
de chats en Allemagne, étaient-ils mangés ? J'ai bondi
sur le maire, et Bébert est sorti avec nous. Le maire
répétait : " Il faut tuer cet animal inutile." Il
l'aurait fait. »
Louis, Lucette et Le Vigan étaient quasiment prisonniers
de cette vaste propriété qu'ils ne pouvaient quitter
sans autorisation. Deux fois tout au plus allèrent-ils
jusqu'au village voisin de Neuruppin où la population
les accueillit avec la plus menaçante hostilité. Que
faire pour rompre la terrible monotonie des jours ?
« Louis avait espéré que je pourrais travailler ma danse
au premier étage, dans le salon de la belle-sœur du
vieux propriétaire. J'y suis allée un peu, au début, et
puis ça ne m'a pas plu. Je n'aimais pas ces gens-là qui
ne nous témoignaient aucune gentillesse. Le vieux Scherz,
le père du paralysé, avait une allure à la Kaiser, très
grand seigneur. Il possédait une jument de vingt-cinq
ans qu'il montait encore. Il y avait deux petites
Lituaniennes qui servaient pieds nus, avec un joli
costume. Elles avaient dix-douze ans. Elles riaient tout
le temps. Elles fermaient la porte avec leur derrière.
On les voyait toujours en train de nettoyer. »
A deux reprises, Lucette, Le Vigan et Céline furent
invités à déjeuner au pavillon par Asta et Erich Scherz
le paralytique. Courtoisie forcée et, pour les trois
Français, nourriture plus convenable qu'à l'ordinaire...
« Au milieu du repas, tout à coup, une explosion
formidable, un avion venait de s'écraser à cent mètres
de la maison. Un petit avion allemand dont le pilote
avait été tué sur le coup. Tout le monde a regardé. Et
puis les Scherz sont retournés à table comme si de rien
n'était. Le jour précisément où nous étions invités !
Avons-nous pu poursuivre notre repas ? Avons-nous pris
quelque chose pour Bébert ? »
Et Lucette revoit encore ce Russe qui portait Erich Scherz sur son
dos. « Un grand Russe dont Louis a dit qu'il l'avait
une fois foutu dans la mare, et pourquoi s'en étonner
car ce Scherz le traitait tellement mal, comme un
cheval, il le battait, et ce pauvre malheureux Russe
faisait tout ce qu'il pouvait. Il y avait aussi des
Russes parmi les prisonniers, totalement sous-alimentés.
C'étaient eux les plus malheureux. Ils faisaient les
travaux les plus durs, on les voyait tomber d'inanition,
ils ne se défendaient pas. »
Une distraction pour Céline, la visite inespérée, un jour, de Karl Epting
et puis une excursion autour du domaine à l'occasion
d'un séjour à Krànzlin de la mère d'Asta Scherz.
Un pique-nique avait été organisé. Louis conseilla à
Lucette de ne manger aucun sandwich. Il craignait qu'on
ne les empoisonnât. Sa paranoïa était à la mesure de son
oisiveté, de son désespoir. Il discutait aussi de temps
à autre avec Hauboldt qui venait inspecter ses services
et présentait ses hommages visiblement très, très
empressés à son hôtesse Asta Scherz encore belle et
altière avec ses quarante-trois ans. Par ailleurs,
raconte toujours Lucette, « Hauboldt écrivait une
sorte de livre sur l'Apocalypse et il voulait l'avis de
Louis. L'Apocalypse, à ses yeux, c'était l'Allemagne
d'aujourd'hui et ce qui s'y passait. Je crois que Louis
n'a pas été très enthousiasmé par son livre et il le lui
a dit. Il ne faisait pas de concessions. Immédiatement,
les gens se cabraient et c'était fini. On ne voulait
plus le voir. »
Comment Céline, d'une façon générale, aurait-il pu être
favorablement accueilli à Krànzlin ? Il parlait
trop bien l'allemand et recevait trop de personnalités
officielles (Epting, Haubold) pour n'être pas suspect
aux yeux des prisonniers français et des autres
opposants au régime hitlérien qui s'essoufflaient à
déterrer des rutabagas du matin au soir. Il évoquait
trop imprudemment sa possible fuite au Danemark pour
n'être pas jugé comme un ennemi par les nazis du coin.
Il ne cachait pas son dédain pour la Prusse, sa
certitude de la défaite imminente du Reich pour ne pas
irriter ses hôtes. Il commentait enfin avec une
franchise trop excessive les travaux littéraires d'Hauboldt
pour se conserver ses bonnes grâces.
Du moins, mieux valait pour lui séjourner là qu'en
France où l'épuration s'organisait enfin après les
désordres inévitables de la Libération. Le 4 septembre,
le Comité national des écrivains avait publié une
première liste noire de douze noms parmi lesquels il
figurait. Les cours de justice se mettaient en place à
une allure record. Parmi les premiers condamnés à mort,
le journaliste Georges Suarez, directeur du quotidien
très collaborationniste Aujourd'hui... Ignorant
tout des circonstances de la Libération, Céline songeait
seulement à gagner le Nord. De Neuruppin à Rostock et à
la Baltique, cent trente kilomètres à vol d'oiseau et
peut-être le rêve fou de s'embarquer pour le Danemark.
Il s'expliqua du reste très clairement sur ses projets
dans une lettre à son avocat Tixier-Vignancour, le 23
juin 1949 :
« Toujours dans mon projet de fuite au Danemark, je
montais tout un roman de m'établir comme médecin à
Rostock, afin de pouvoir étudier sur place à Warnemiinde
le moyen de passer clandestinement au Danemark. Le Vigan
demeura 5 jours à Kràntzlin cependant
qu'avec ma femme nous fûmes à Rostock raconter des
bêtises à la Chambre des médecins de Rostock et leur
demander la permission de nous rendre par chemin de fer
en excursion à Wamemùnde (port proche). Nous sommes
restés 24 heures à Warnemiinde à étudier les
possibilités d'embarquer clandestinement. Nous avons été
repérés presque immédiatement. Je n'ai jamais vu autant
de policiers sur une plage ni autant de mitrailleuses
sur des jetées. Nous avons été interpellés 20 fois en qq
heures ! »

Selon François Gibault, c'est Hauboldt qui, le premier,
aurait proposé à l'écrivain un poste de médecin dans une
usine d'armements. Louis avait fait semblant d'accepter
pour pouvoir se rendre sur place. Quoi qu'il en soit,
l'embarquement s'avéra impossible.
Louis et Lucette avaient dû confier Bébert à Le Vigan avant
de partir pour Rostock puis Warnemiinde. « Il y
avait, raconte-t-elle, de petits bateaux de pêcheurs. On
a bien essayé de soudoyer un marin pour un futur
embarquement. Impossible. Sur cette grève de Warnemùnde,
avec ses galets noirs et blancs, ce paysage si pauvre,
si démuni, on ne voyait que des soldats et des
mitraillettes. Dans le train qui nous conduisait là-bas
depuis Neuruppin, nous avions rencontré un médecin grec
qui avait été prisonnier en Russie pendant dix ans.
C'est lui qui nous disait : " J'ai appris à ne plus
penser parce qu'on voit mes pensées. Là-bas, en
détention, si vous pensiez, on savait que vous pensiez.
J'ai donc appris à ne plus penser." Et en effet, on
avait l'impression d'être en présence de quelqu'un de
vide. Il cherchait du travail et il cherchait aussi sa
femme qui avait été dans un camp. Elle était grecque, et
médecin également. Partout autour de nous, on voyait des
prisonniers, des personnes déplacées, c'était l'horreur.
»
De retour à Krànzlin, Louis et Lucette
retrouvèrent Bébert d'une maigreur squelettique. Les
provisions mises de côté pour le chat, pommes de terre
et ersatz de saucisson, Le Vigan les avait dévorées.
J'avais faim, expliqua-t-il. Bébert par bonheur avait la
vie dure, comme un vrai matou de Montmartre. Ses
maîtres, eux, étaient désespérés. La frontière danoise
définitivement verrouillée, que faire ? Demeurer à
Krànzlin dans cette atmosphère sourdement hostile,
alors que l'automne s'installait déjà, que les
bombardements sur Berlin ébranlaient l'horizon et
faisaient rougeoyer le ciel, en pleine nuit, que les
privations se faisaient plus cruelles, l'isolement
intolérable, l'attente et le sentiment d'inutilité plus
pressants ?
C'est alors, peu après le retour piteux de Rostock, que
Céline entendit parler pour la première fois de
l'existence, dans la petite ville de Sigmaringen avec
son château au bord du Danube, d'une enclave créée par
les nazis pour regrouper le gouvernement français en
exil, de gré ou de force, avec les derniers miliciens,
les rescapés de la division Charlemagne, les
intellectuels en fuite et autres collaborateurs tous
menacés de l'article 75, c'est-à-dire de haute trahison
par le nouveau gouvernement français. Tant qu'à être
bloqué en Allemagne, pensa Céline, autant retrouver des
Français, pouvoir s'exprimer dans sa langue, soigner des
compatriotes et, qui sait, pouvoir à défaut franchir la
frontière suisse. Il écrivit donc à Fernand de Brinon,
membre éminent de ce cabinet fantôme chargé d'assurer,
dans les fourgons de l'étranger, la problématique
légitimité de l' « Ordre nouveau » qui attendait et
espérait la reconquête du territoire grâce aux
contre-attaques des armées du Reich. Brinon lui répondit
sur-le-champ. Céline serait le bienvenu. Un médecin
serait le bienvenu.
Selon Lucette, c'est Le Vigan qui avait fait d'abord pression sur eux
pour partir vers le sud. « Louis était angoissé.
Chaque seconde était pour lui une rumination d'horreur.
Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Il était
incapable de rester comme ce Grec entraperçu dans le
train, qui avait réussi à faire le vide complet dans sa
tête et ne sentait plus rien. Louis, c'était tout le
contraire, dans une effervescence sans repos. Et cette
force énorme, cette intelligence pour lui qui n'écrivait
pas, il les avait mises dans cette idée d'évasion.
Chaque seconde lui apportait une idée d'évasion, par le
train, le bateau, il n'arrêtait pas. Je lui disais de
rester tranquille et d'attendre, une espèce de fatalité,
que l'on se laisse donc porter par-ci, par-là. Louis ne
voulait pas. C'est pour cela que nous sommes partis pour
Sigmaringen après avoir mis tous nos efforts à nous
enfuir de l'autre côté. Je n'y tenais pas, à
Sigmaringen. C'est un peu la faute de Le Vigan. Il
pensait trouver à manger là-bas, erreur d'ailleurs !
Louis hésitait, il devinait que c'était là le refuge des
singes, et comme il n'avait rien de commun avec eux,
rien à faire avec eux, il n'avait pas de raison de les
rejoindre. Aucune nostalgie, aucune complicité, non. Il
a simplement dit qu'il servirait au moins à soigner des
Français, sans se faire davantage d'illusions. Il était
très lucide. Arrivée à Sigmaringen, j'ai eu l'impression
de tomber sur des fous ou des demi-fous. Il y en a un
qui me disait : " J'en ai tué cinquante ", l'autre " cent ".
Ils se vantaient d'avoir tué des Français. Chacun
s'accrochait à son lambeau de pouvoir... A
Krânzlin, nous n'avions pas de radio. Peut-être
avons-nous appris par Hauboldt l'existence de
Sigmaringen... »
Fin octobre, avec l'accord des autorités allemandes et du docteur
Hauboldt bien entendu, Céline et ses compagnons
quittèrent donc le domaine de Krânzlin et la
demeure des Scherz qui les virent s'éloigner sans
regret. Pouvaient-ils deviner que plus tard, avec ses
formidables mensonges visionnaires, sa chronique
déformée et hissée au rang d'une tragi-comédie
grinçante, bouffonne, entre le rire et la mort, Céline
allait faire de Krânzlin (Zornhof dans la
nouvelle édition) au centre de cette plaine du
Brandebourg l'un des lieux à peine imaginaire les plus
flamboyants de la littérature moderne ?
BADEN-BADEN
En juin 1944, quelques
jours après le débarquement allié en Normandie, Céline,
Lucette et Bébert obtinrent l'autorisation de gagner
l'Allemagne. L'atmosphère s'alourdissait à Paris et les
menaces de mort, encore anonymes, se multipliaient pour
les collaborateurs et leurs amis.
De là, ils espéraient obtenir les laissez-passer nécessaires pour
parvenir au Danemark.
Il est difficile de suivre très précisément Céline à la trace. Lui-même a
donné, dans D'un château l'autre, Nord et
Rigodon, une représentation fort brouillée de ses
pérégrinations en Allemagne. Bornons-nous donc aux
informations les plus sûres, et renvoyons à ces trois
livres l'évocation délirante et juste de cette Allemagne
d'apocalypse, croulant sous les bombes, voyant refluer
des armées de toutes nationalités, des réfugiés, des
soldats, des traîtres et des fanatiques.
Céline, Lucette et Bébert à peine débarqués furent logés au Brenner's
Park Hôtel, le plus somptueux de toute la ville,
avec piscine, jardin privé le long de l'Oos, salons
immenses décorés avec stucs au plafond, tapis profonds
et couloirs interminables. C'est que le palace venait
d'être réquisitionné par le ministère des Affaires
étrangères du Reich.
 Le maître des cérémonies s'appelait le major Josef
Schleman. Il avait pour mission de veiller sur les
réfugiés politiques de Baden-Baden. Autrefois
vice-consul à Marseille, il voyait maintenant ses
fonctions et ses responsabilités croître
vertigineusement, à mesure que les revers des armées du
Reich entraînaient dans leur sillage diplomates et
réfugiés de toutes sortes. Sa première tâche consistait
à regrouper les passeports des hôtes étrangers du
Brenner's. Céline et Lucette durent obtempérer.
Bébert aussi peut-être, en montrant les griffes. Sans
passeport, inutile de songer à se déplacer. Le Danemark
? Une destination encore inaccessible. Entre le conte de
fées et la sorcellerie, il n'y avait qu'un pas. La
famille Destouches était prisonnière d'un mirage. Le maître des cérémonies s'appelait le major Josef
Schleman. Il avait pour mission de veiller sur les
réfugiés politiques de Baden-Baden. Autrefois
vice-consul à Marseille, il voyait maintenant ses
fonctions et ses responsabilités croître
vertigineusement, à mesure que les revers des armées du
Reich entraînaient dans leur sillage diplomates et
réfugiés de toutes sortes. Sa première tâche consistait
à regrouper les passeports des hôtes étrangers du
Brenner's. Céline et Lucette durent obtempérer.
Bébert aussi peut-être, en montrant les griffes. Sans
passeport, inutile de songer à se déplacer. Le Danemark
? Une destination encore inaccessible. Entre le conte de
fées et la sorcellerie, il n'y avait qu'un pas. La
famille Destouches était prisonnière d'un mirage.
Et les jours passèrent, les
semaines. Sans papiers, ils ne pouvaient rien faire.
Lucette emmenait Bébert se promener, en laisse parfois,
dans les jardins de Baden-Baden. Louis rongeait son
frein. Josef Schleman avait convoqué l'écrivain et lui
avait dit en substance, selon Lucette:
" Les gens qui sont en Allemagne doivent servir le pays. Vous
devez faire de la propagande, parler à la radio par
exemple. On ne peut pas vivre si on n'a pas un emploi !
Céline lui répondit :
" Vous êtes fou, il n'en est pas question ! "
Schleman dut insister, menacer, redire à Céline que, de toute façon, on
ne le laisserait pas sortir. Peine perdue. L'écrivain
rétorqua une fois de plus qu'il ne ferait rien, qu'il
n'écrirait rien, pas un mot, qu'on pouvait le tuer et ça
lui était bien égal. Schleman s'avoua vaincu.
La situation ne pouvait s'éterniser. Puisque Céline ne
pouvait rien obtenir à Baden-Baden, il décida de tenter
sa chance à Berlin pour obtenir enfin les laissez-passer
nécessaires pour le Danemark. Début juillet, il put se
rendre dans la capitale du Reich. « On nous avait
envoyé une femme doctoresse pour nous convoyer. Louis a
revu à Berlin le docteur Knapp. Ça n'a abouti à rien
», se souvient Lucette.
Knapp qui travaillait au département étranger de l'Office de la santé
publique du Reich, Louis le connaissait bien, l'avait
souvent rencontré à Paris, on l'a déjà dit. Mais que
pouvait-il faire pour lui, à Berlin, sinon le bercer de
bonnes paroles, lui promettre que sa requête serait
prise en considération ? Réponse analogue au ministère
des Affaires étrangères où Louis avait aussi tiré les
sonnettes. Qu'il rentre à Baden-Baden où une réponse
officielle lui serait notifiée, on n'avait rien d'autre
à lui dire !
La vie reprit donc son
cours au Brenner's, avec ses réfugiés de plus en
plus nombreux, ses escadrilles de plus en plus bruyantes
dans le ciel, ses magnolias et ses hortensias de plus en
plus fleuris — et ses angoisses de moins en moins
secrètes.
Lucette : « Ces gens très mondains continuaient à
vivre leur vie habituelle qui n'avait plus aucun sens
puisqu'ils n'avaient plus de vie, plus de personnalité,
plus d'identité, plus de papiers, rien. Ils continuaient
à former une société, à bavarder à table, à s'inviter à
prendre le thé. Je les observais de temps à autre.
J'aurais pu participer à leurs groupes si je n'avais pas
été danseuse, si je n'avais pas consacré trop de temps
pour m'entraîner. Céline bavardait par curiosité à
droite, à gauche. A-t-il travaillé à certains manuscrits
? Je crois qu'il m'avait dit : je voulais continuer à
travailler mais finalement je ne peux pas, je n'ai pas
la tête à ça, on verra plus tard ! Tout était en fait
très angoissant. Louis s'imaginait jeté dans un camp de
prisonniers puisqu'il ne voulait pas travailler pour les
Allemands. Sur place, il soignait, en dépannage. Il
avait sa trousse, des piqûres, un matériel d'urgence.
Mais déjà les médicaments se faisaient rares. La
morphine surtout... "
Et de nouveau les jours passèrent, les semaines. Céline
s'ennuyait. Il écrivit à Karl Epting, début août, lui
demanda de lui envoyer des livres, Chateaubriand,
Ronsard et les chroniqueurs du Moyen Âge comme si déjà
il songeait confusément à prendre exemple sur eux... La
France pendant ce temps se libérait à la vitesse des
tanks du général Patton. Vers la mi-août commencèrent
les premiers combats pour la libération de Paris...
Au Brenner's, il
fallut se serrer. Les Destouches furent chassés de leur
belle chambre du premier étage. On les installa dans une
pièce plus modeste, sous les toits. C'est que les
vedettes de la collaboration affluaient. La nourriture
se fit aussi plus frugale. Adieu les gigots ou les choux
à la crème ! On dégusta plus souvent des topinambours,
rutabagas et ersatz de saucisson. dans une
pièce plus modeste, sous les toits. C'est que les
vedettes de la collaboration affluaient. La nourriture
se fit aussi plus frugale. Adieu les gigots ou les choux
à la crème ! On dégusta plus souvent des topinambours,
rutabagas et ersatz de saucisson.
Malgré tout, ces nouveaux réfugiés vivaient encore dans
le rêve, dans les consolantes illusions de la victoire
de leurs idées et de leurs intérêts. Ils s'agitaient.
Ils créaient des comités de ceci, de cela. Agitation
funambulesque.
Pour paraphraser le mot d'Oscar Wilde, c'est fou, depuis Céline,
comme la réalité se mettait à devenir célinienne —
décors et personnages ! La pianiste Lucienne Delforge,
vaguement compromise à cause d'on ne sait trop quelle
liaison coupable, venait de débarquer elle aussi à
Baden-Baden. Sa liaison avec Céline, en 1935-1936, cela
remontait à si loin, la nuit des temps... Et Le Vigan à
son tour arriva le 16 août, halluciné, sans un sou, un
bagage, rien. Il avait commencé à tourner à Nice le rôle
du marchand d'habits dans les Enfants du paradis
quand survint l'annonce du débarquement allié en
Normandie. Pris de panique, il disparut. Au dire de
Marcel Carné, sa composition y était extraordinaire.
Comme il n'avait tourné qu'une seule scène, il fut
remplacé sans difficulté. Pierre Renoir reprit le rôle.
Le Vigan erra, de-ci, de-là, persécuté plus ou moins
imaginaire, avant de sauter dans un train et de
retrouver Céline son vieil ami et Bébert son ancien
chat.
Et encore de
nouveaux jours, de nouvelles semaines. Le mois d'août
s'acheva. Céline n'avait aucune nouvelle du ministère
des Affaires étrangères qui lui avait pourtant promis
une réponse. Aucun visa en vue pour le Danemark par
conséquent. Céline appela à la rescousse encore une fois
Karl Epting qui avait, entre-temps, été rapatrié à
Berlin. Epting à son tour alerta le ministère qui
chargea le docteur Hauboldt de s'occuper de
l'écrivain-médecin, de lui trouver une quelconque «
affectation ». Début septembre, convoqué à Berlin,
Céline quitta, définitivement cette fois, Baden-Baden,
en compagnie de Bébert, Lucette et Le Vigan...
Voyage à BERLIN.
C'est en mars 1942 que
Céline effectua un voyage de cinq jours à Berlin.
Echaudé par la confiscation de son or déposé en
Hollande, l'écrivain avait pour objectif de confier à
son amie Karen Marie Jensen la clé et la combinaison de
son coffre bancaire à Copenhague,
et ce afin qu'elle mette l'argent en lieu sûr.
C'est en compagnie de Lucette, Gen Paul et deux confrères médecins.
Auguste Bécart et Jean-Claude Rudler, qu'il fit ce
voyage. C'est donc sous le couvert d'un voyage
scientifique et médical que Céline put se rendre en
Allemagne. Au cours de ce séjour, on lui demanda de
rendre une visite au Foyer des ouvriers français de
Berlin et d'y prononcer une allocution.
Après la guerre, Céline résuma à sa façon la teneur de son intervention :
" Ouvriers français. Je vais vous dire une bonne
chose, je vous connais bien, je suis des vôtres, ouvrier
comme vous, ceux-là (les Allemands) ils sont moches. Ils
disent qu'ils vont gagner la guerre, j'en sais rien. Les
autres, les russes, de l'autre côté, ne valent pas
mieux. Ils sont peut-être pire ! C'est une affaire de
choix entre le choléra et la peste ! C'est pas drôle.
Salut ! "
" La consternation au " Foyer " fut grande ". Le fait que la causerie de
Céline laissa une impression mitigée n'est pas
douteux. En témoigne le compte rendu, paru le 12 mars
1942, dans Le Pont, " hebdomadaire de l'amicale
des travailleurs français en Allemagne " financé par le
Reich.
Le pessimisme de Céline, politiquement incorrect avant la lettre, ne fit
assurément pas l'affaire de ceux qui l'avaient pressenti
pour galvaniser ces travailleurs français qui avaient
choisi de venir travailler outre-Rhin.
" La séance hebdomadaire
du groupe d'études sociales et politiques fut ouverte à
20 heures par notre camarade chargé de la direction du
groupe. En quelques mots, il présenta Louis-Ferdinand
Céline qui doit prendre la parole. C'est alors que le "
docteur " se leva et vint s'asseoir à la table du
conférencier.
Céline entra de suite dans le sujet. Sans détours, il ne cacha pas son
opinion, acquise d'après une longue expérience
personnelle, qu'il était très difficile de réunir les
Français à l'étranger et de les faire s'entendre, sinon
s'aimer.
Cependant, comme pour lui donner un démenti, la salle était fort bien
remplie d'auditeurs avides de ses paroles. Et les débuts
de son allocution furent quelque peu troublés par de
nombreux retardataires qui faisaient grincer la porte
d'entrée.
En quelques mots, Céline eut vite fait de créer l'atmosphère, " son
atmosphère ". " Je vais vous parler tout simplement,
je ne vous ferai pas de discours, ni de conférence, mais
vous parlerai comme en famille. Je suis un enfant du
peuple, et suis resté tel. J'ai fait mes études de
médecine, non pas comme étudiant mais comme travailleur.
Je fais partie du peuple et le connais bien ".
Et Céline commença immédiatement un diagnostic sévère de la maladie qui,
selon lui, atteint chacun de nous. (...) Nous manquons
d'idéal. Et Céline ne craint pas de nous dire nos "
quatre vérités ". Nous souffrons d'un mal très sérieux,
par suite d'un manque quasi total de lyrisme,
d'idéalisme.
Le docteur-écrivain nous dit ensuite son opinion sur les multiples causes
de notre mal, et sa conviction qu'il avait de notre
exploitation par les juifs qui " savent admirablement
nous opposer les uns aux autres "... L'intérêt du
juif est de nous diviser en partis opposés, de façon à
donner excuse à notre nonchalance. On rejette les fautes
sur l'opposant, ainsi artificiellement créé. La lutte
des partis n'est qu'une splendide invention d'Israël...
Céline s'adressa ensuite aux communistes éventuels, avec la franchise qui
le caractérise. Que pensez-vous qu'il vous arriverait en
cas de victoire des Soviets ? " Mais vous serez
immédiatement déportés en Sibérie, avant les bourgeois
même. Une fois votre " utilité " passée, vous
deviendriez plus dangereux et inutiles que les modérés.
"
Finalement, Céline dressa un
très sombre tableau de la situation, et ne laissa
entrevoir aucune issue. A un tel point, que les visages
commençaient à montrer de l'étonnement, pour ne pas dire
de l'indignation dans la salle comble.
(...) C'est alors que se leva un jeune légionnaire français. En quelques
paroles il sut montrer à l'auditoire enthousiasmé que
l'horizon n'était pas aussi sombre que Céline avait bien
voulu nous le dépeindre. Il dit sa conviction que Céline
avait voulu " piquer au vif " son auditoire. " Certes,
tout n'est pas le mieux dans le meilleur des mondes ;
mais il ne faut pas désespérer, il faut agir, se montrer
des hommes dignes des idées qu'ils prétendent avoir, et
même défendre ces idées ; c'est ce que nous, volontaires
contre le bolchevisme, faisons chaque jour. De même vous
qui travaillez en Allemagne, contribuez chaque jour
efficacement à la lutte que l'Europe mène contre son
ennemi d'aujourd'hui, le bolchevisme, et son ennemi de
toujours, l'Angleterre. (Applaudissements sans fin).
(Piche, Le Pont, 12 mars 1942, dans BC n°309, juin
2009)
VERS La ROCHELLE
Le 30 janvier 1940, son
contrat [médecin militaire] prend fin et il retourne à
Paris.
De janvier à mars 1940, Céline est chez sa mère, sans emploi. En mars, il
est nommé médecin chef au dispensaire municipal de
Sartrouville, dans lequel il avait déjà travaillé en
tant que médecin scolaire. Il y assure des consultations
de médecine générale et le service d'inspection médicale
des écoles.
Alors que les Allemands
approchent de Paris, il participe à l'exode de juin en
accompagnant jusqu'à La Rochelle l'ambulance de son
dispensaire. Il rentre à Sartrouville le 14 juillet mais
se retrouve sans emploi au retour du front des médecins
titulaires.
AU DIRECTEUR DU SERVICE DE SANTE DE LA PREFECTURE DE
SEINE-ET-OISE
Le [23 juillet 1940]
Monsieur le Directeur,
C'est avec un peu
d'étonnement que j'ai reçu (transmise) la note ci-jointe
de la mairie de Sartrouville.
1° Parce que je ne demeure pas à Sartrouville. Je n'ai aucun domicile à
Sartrouville. Je demeure ici depuis 30 ans à Paris, 11,
rue Marsollier.
2° J'ai accepté d'assurer 2 heures par jour la consultation de
médecine générale à Sartrouville depuis le mois de
mars - en remplacement du Dr Dubroca (titulaire) médecin
chef du dispensaire municipal. Là se borne mon rôle.
 3°
Il est exact d'autre part que j'ai accepté pour
rendre service de faire partie du convoi
d'évacuation de la mairie de Sartrouville - le 10 juin.
A cet effet, j'ai quitté mon domicile à Paris pour me
joindre avec la pompe à incendie, les archives, les
vivres etc. sous la direction du Maire de
Sartrouville à la colonne se dirigeant primitivement
sur Pressigny-les-Pins. 3°
Il est exact d'autre part que j'ai accepté pour
rendre service de faire partie du convoi
d'évacuation de la mairie de Sartrouville - le 10 juin.
A cet effet, j'ai quitté mon domicile à Paris pour me
joindre avec la pompe à incendie, les archives, les
vivres etc. sous la direction du Maire de
Sartrouville à la colonne se dirigeant primitivement
sur Pressigny-les-Pins.
En cours de route, j'ai donné mes soins à d'innombrables blessés et
malades. J'ai pu mettre en lieu sûr à travers les
bombardements 2 enfants d'un mois - à Issoudun Cher.
Enfin au cours d'un long et très pénible périple (Sartrouville-La
Rochelle), j'ai réussi à sauver de la destruction
l'ambulance de Sartrouville qui m'avait été confiée et
que j'ai pu ramener à la mairie le 14 juillet.
Observant que tout ceci ne m'a pas rapporté un sou de
traitement (je suis payé à Sartrouville à la
consultation), que tous les frais du voyage furent
entièrement à ma charge et de ma poche du départ
à l'arrivée, c'est-à-dire pendant cinq semaines,
(essence, réparations etc.) j'ai perdu, confiés à
d'autres camions, environ 5 000 francs de bagages
personnels, que j'ai entretenu pendant plusieurs
semaines à mes frais personnels ambulance, chauffeur,
malades en ambulance etc... sans avoir reçu au départ un
sou de la mairie (à laquelle d'ailleurs je ne réclame
rien).
4° Enfin, je n'ai pas eu à " apprécier les raisons justifiant mon départ
". Je suis parti avec la colonne administrative
d'évacuation commandée par le maire en personne - et
pour rendre service - presque rien ne m'y obligeant,
n'ayant aucune situation médicale ou administrative
stable à Sartrouville.
En bref, aucun avenir (et aucun compte à rendre).
Je ne regrette rien.
Curieux de nature et si j'ose dire de vocation, j'ai été fort heureux de
participer à une aventure qui ne doit se renouveler
j'imagine que tous les 3 ou quatre siècles.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur à l'assurance
de mes sentiments très distingués.
Dr Destouches.
(Lettres, La Pléiade,
Gallimard, 2009).
VERS le MAROC.
1 décembre : Bien que réformé, les convictions de sa
jeunesse l’emportent. Il trouve un emploi de médecin
maritime et embarque sur Le Chella, un paquebot
réquisitionné pour le transport de troupes, direction le
Maroc. Au moment où le Dr Destouches remplace par
intérim, le médecin du bord, le Chella n’est
encore qu’un bâtiment purement civil qui ne fait que
poursuivre ses activités habituelles. Il n’est pas
question de « combattre les Allemands comme le dit
Lucette… »

Cependant, peu de temps après, le paquebot reçoit des
canons, pour être armé en croiseur auxiliaire de la
marine nationale, appelé à transporter des troupes et
éventuellement à se défendre contre des sous-marins. Par
voie de conséquence, le Dr Destouches devient médecin de
marine de 3ième classe.
1940
Le 3 janvier à Gen Paul : « J’ai reçu ma commission
d’officier de la marine militaire de 3ème classe
temporaire. »
5-6 janvier : Cette nouvelle expérience martiale fut brève.
Dans la nuit, au large de Gibraltar, le bateau éperonna
un aviso britannique, le Kingston Cornelian, qui
naviguait tous feux éteints. Le choc fut terrible, en
quelques minutes le navire de guerre chargé d’explosifs
explosa et coula.
9 janvier : Au docteur Camus : « Vaillance et discipline,
et toujours le premier. Ainsi je voguais fort estimé sur
les mers traîtresses quand mon paquebot éventra l’autre
nuit, en pleine vitesse, un torpilleur anglais qui fit
une de ces explosions qui comptent dans la vie et la
mort d’un navire, se coula corps et biens en moins d’une
minute. »
C’est cette année que Céline et Gen Paul se retrouve à Marseille.
Le 18 mai 1938 : Céline
part de New York, s’embarque sur le Normandie,
pour arriver au Havre le 23.
23 mai 1938 : Rentre des USA au Havre où il rédige L’Ecole des
cadavres.
Par lettre il remercie Gen Paul et Mahé qui avait diligenté des truands
pour intimider un partenaire de danses indiennes de
Lucette qui lui causait des désagréments professionnels.
Voyage de Céline au CANADA, mai 1938.
Lorsque
le docteur Destouches débarqua en Amérique sans tambour
ni trompettes, presque incognito et sans que la
République l’eût chargé de mission officielle, il était
loin de nous être inconnu. Voyage au bout de
la nuit, vendu ouvertement, ne le cédait en tirage
qu’à L’amant de Lady Chatterley, débité, quelques
années auparavant, sous le manteau.
Le fait d’avoir été recalé au Goncourt gonflait ses
voiles. Il avait le vent en poupe. La critique louvoyait
tandis que, dans les salons, les universitaires français
criaient déjà, à l’épuration. J’osai, pour ma part, en
faire le sujet d’un cours en l’entourant de toutes les
précautions hygiéniques requises. Il y a des leçons
d’anatomie littéraire plus répugnantes encore. Quoi
qu’il en soit, lorsque, par un beau dimanche, on
m’apprit que Céline était à Montréal, je me lançai
aussitôt à sa recherche.
Je le trouvai, nous étions en mai 1938, à une
assemblée de chemises brunes, peut-être noires, taillées
sur le modèle
 européen et dont l’existence, m’apprit-il,
lui avait été signalée par un ami de New York. Lui-même
portait une chemise qui avait dû être blanche naguère.
Le « cher maître » que je lui servis le fit s’esclaffer,
et tout de suite nous fûmes dans les meilleurs termes.
Il me fut, toutefois, impossible de vaincre sa phobie
des discours en public. Non, pour quelque cachet que ce
soit, il ne ferait pas de conférence, ni en smoking (il
n’avait jamais eu de quoi s’en acheter un) ni en veston
de ville. D’ailleurs, ce n’était une question de
costume, c’était une incapacité totale à « faire le
pitre » pour l’amusement des gens du monde. Un dîner
d’écrivains ? Oui, mais à condition qu’ils ne soient pas
plus d’une dizaine et que tout se passe à la bonne
franquette comme à un rendez-vous des cochers et des
chauffeurs. européen et dont l’existence, m’apprit-il,
lui avait été signalée par un ami de New York. Lui-même
portait une chemise qui avait dû être blanche naguère.
Le « cher maître » que je lui servis le fit s’esclaffer,
et tout de suite nous fûmes dans les meilleurs termes.
Il me fut, toutefois, impossible de vaincre sa phobie
des discours en public. Non, pour quelque cachet que ce
soit, il ne ferait pas de conférence, ni en smoking (il
n’avait jamais eu de quoi s’en acheter un) ni en veston
de ville. D’ailleurs, ce n’était une question de
costume, c’était une incapacité totale à « faire le
pitre » pour l’amusement des gens du monde. Un dîner
d’écrivains ? Oui, mais à condition qu’ils ne soient pas
plus d’une dizaine et que tout se passe à la bonne
franquette comme à un rendez-vous des cochers et des
chauffeurs.
Nous étions au-delà d’une vingtaine. Malgré la bonne
chère et les bons vins, Céline ne desserra pas les
dents. Assailli de questions, abasourdi par les caquets
d’une femme de lettres dans le secret de toutes les
fausses gloires de Paris, il toucha à peine aux plats.
Je m’attendais au pire, mais l’ogre ne dévora personne.
Son passage dans une maison de santé américaine (cf. le
Voyage) l’avait rendu invulnérable aux propos de
ses confrères. Il n’en avait pas moins déçu les invités
lorsque je mis fin à son supplice et qu’à son corps
défendant je l’amenai dans une maison amie boire le coup
de l’étrier, le « night cap » du Ritz. Les dieux
m’aimèrent, ce soir-là, car nous n’en étions encore qu’à
notre première libation que, soudainement du soliveau
qu’il avait été jusqu’à cette heure, Céline se mua en le
plus disert et le plus pittoresque des compagnons. Pour
le voir au naturel, il avait suffi de le voir dans
l’intimité.
Un mot par-ci, un mot par-là, et Céline enfourchait
l’un après l’autre tous ses dadas, multipliant les
anecdotes, donnant des noms, dressant des généalogies,
fulminant, prophétisant jusqu’aux petites heures de la
nuit. Encore que bien en-deçà de ce que devait être la
réalité, il entrevoyait jusqu’au sort qui lui était
réservé. Ce fut pour nous un nouveau Voyage au bout
de la nuit. A cette différence, cependant, que pas
une seule fois il n’emprunta pour le décrire la langue
anarchique par laquelle il s’était illustré. Pas un
terme malsonnant, malodorant. Il fut, au contraire,
d’une correction académique.
Lorsque je le reconduisis à son hôtel, Céline
parlait encore, mais il n’était plus question de
Bagatelles pour un massacre. Il y a de bien belles
femmes à Montréal, me dit-il. Au fait, comment s’appelle
cette magnifique rouquine qui n’a pas ouvert la bouche
de la soirée ? A l’an prochain, me promit-il, tout
souriant et allégé de sa faconde. Il avait prévu une
foule de choses, sauf les oubliettes.
(Victor
Barbeau, de l’Académie canadienne-française, Aspects de
la France, 17 janvier 1963, BC n°198.)
15 avril 1938
: Il embarque à Bordeaux pour Saint-Pierre-et-Miquelon
où il débarque le 26 avril. Sa présence est attestée à
Montréal le 5 mai (lettre à Marie Canavaggia).
Il se rendra ensuite aux Etats-Unis où son éditeur américain
prépare la publication de la traduction (expurgée) de
Mort à crédit, mais à refusé dès janvier 1938, celle
de Bagatelles pour un massacre.
Mon voyage avec Céline - Mme Jeanne Allain-Poirier
se souvient de la traversée qu’elle fit à l’âge de dix
ans, en compagnie de Céline.
Tous
les récits de mes souvenirs de jeunesse ont laissé en
moi une empreinte indélébile. Mais s’il est un chapitre
auquel je suis particulièrement attachée, c’est bien
celui de mon voyage Bordeaux-Saint-Pierre-et-Miquelon en
date précise du 15 avril 1938.
Le cargo français Le Celte en provenance de
Zeebruge, arrivé deux jours avant à Bordeaux, avait
chargé deux cent quarante tonnes de marchandises.
Vingt-deux hommes, sous la houlette du Commandant
Eneault, composaient l’équipage.
Quatre passagers en supplément s’embarquaient à bord
pour la destination directe de
Saint-Pierre-et-Miquelon : 1) Monsieur Louis Destouches
(docteur en médecine) – 2) Monsieur René Haran
(originaire des îles) – 3) Madame Elisa Allain (idem) –
4) Mademoiselle Jeanne Allain… moi-même.
La perspective d’entreprendre cette traversée de
l’Atlantique inquiétait particulièrement ma mère et pour
cause : je venais d’être opérée d’une appendicite aiguë
avec complication de péritonite quelque temps
auparavant.
Mais quand le Commandant lui annonça qu’il y avait
un médecin à bord, elle fut soulagée et sécurisée. On
appareilla donc, en fin d’après-midi, et ce jour-là,
c’était un vendredi saint. J’ai remonté le temps en
faisant le compte à rebours et je n’ai rien inventé.
Ainsi, à l’heure de la cloche, nous nous sommes
trouvés à la table du Commandant, dès le premier soir.
Un repas de circonstance avec du poisson au menu. C’est
ainsi que je fis la connaissance de l’écrivain que
j’appelai aussitôt « Monsieur ». Dès cet instant, nous
avons sympathisé tous les deux et je garde au cœur le
privilège que j’ai pu avoir de le rencontrer. Il faut
croire qu’il a fait grande impression sur moi pour en
être marquée à un tel point. On est rapidement devenus
deux amis.
Je
garderai toute ma vie l’image de ce grand monsieur à
l’imperméable beige, au gros cache-nez à double tour et chaussant des bottes en peau de phoque. A cette époque,
je ne savais pas qu’il était écrivain mais je sentais
malgré tout qu’il passait entre nous un courant un peu
spécial.
chaussant des bottes en peau de phoque. A cette époque,
je ne savais pas qu’il était écrivain mais je sentais
malgré tout qu’il passait entre nous un courant un peu
spécial.
Chaque jour, il me rendait visite dans ma cabine. Il
frappait à la porte, bien que cette dernière fut le plus
souvent ouverte pour me permettre de regarder le
mouvement. La plupart du temps, je lisais les Fables de
La Fontaine. Il trouvait cela très bien, m’avait-il dit.
Mais moi, je lui ai posé une question un peu
embarrassante. On dit toujours que la vérité sort de la
bouche des enfants. Oui, lui ai-je dit, mais l’auteur,
pour moi, avait menti en faisant parler les animaux.
Une
autre fois, un jour de très grosse mer, il m’avait
demandé si je n’avais pas peur de ces montagnes de
vagues qui déferlaient sur le bateau. Bien au contraire,
je prenais plaisir à voir le bateau et les vagues
arroser le hublot de la cabine. Plus on dansait quand il
y avait du roulis, plus j’étais contente « Tu vois,
me disait-il, quand on va de gauche à droite, ça fait
des zig et ça fait des zag, des zigs-zags. » Cela,
j’ai du plaisir à le répéter et je ne l’ai jamais
oublié.
Un autre jour, la conversation s’aiguille sur les
poissons. Très rapidement, croyant tout savoir sur le
sujet, j’énumère tous ceux qui me venaient à l’esprit et
que l’on trouvait au pays. « Ah !, me dit-il,
cherche bien, je suis sûr que tu en oublies un ».
Non, je ne voyais pas. « Et le hareng ! Faut pas
oublier que nous en avons un avec nous à bord ». Il
faisait allusion à un passager qui portait ce nom. « Eh
bien toi, me dit-il, tu seras la sardine. »
C’est ainsi que j’héritai de ce sobriquet pendant le
reste du voyage.
Ainsi donc défilaient les jours, en tanguant ou en
roulant selon les caprices du temps, et pas un seul jour
ne s’est passé sans que l’écrivain ne vienne me rendre
visite chaque après-midi. Mais il n’existe pas de voyage
sans problèmes, que ce soit en train, avion ou bateau et
c’est toujours quand on s’y attend le moins que les
catastrophes ou les surprises vous arrivent.
Tout cela, c’était trop beau pour durer et il a fallu
qu’un coup du sort vienne me tomber dessus. Comme
surprise, elle fut de taille. Le vent avait-il viré,
sans prévenir ? En tout cas, à l’instant même où
j’entendis la cloche sonner pour le déjeuner, il m’est
arrivé une énorme lame de travers, m’arrosant
copieusement dans ma banette. Prise de panique, je me
mis à crier pour alerter. Je fus secourue et rassurée
sur le champ. Je venais d’hériter d’une belle douche
écossaise surnommée « le baptême de l’Atlantique ».
Après être remise de mes émotions, je crois me
souvenir que ce fut à table que l’on arrosa l’évènement.
Pour éviter un second baptême, la porte de la cabine fut
fermée mais cela n’empêchait pas mon ami de me rendre
visite. Je lui avais confié que j’aurais aimé rester à
Bordeaux mais ma mère avait décidé de repartir à cause
des rumeurs de guerre et que l’on serait certainement
plus tranquille à Saint-Pierre. Elle avait vu juste,
mais moi, je ne comprenais pas très bien. La seule chose
qui m’intéressait c’était la perspective de retrouver
mes oncles.
De
jour en jour, on se rapprochait donc du pays sans penser
aux risques qui nous attendaient. Mauvaise saison que ce
mois d’avril, pour ceux qui naviguent dans le sillage
des icebergs descendant du Grand Nord. Mais personne ne
parlait de cela à bord. Hélas, par un brouillard épais,
une nuit, nous avons eu très froid et cela nous a
réveillés. Tout à coup, le bateau s’est penché, puis
sans doute un changement de direction nous a fait
pivoter. Nous avions évité le pire, en frôlant une de
ces masses de glace flottantes, détachée de la banquise.
On peut dire, sans jeu de mot, que ça donne le frisson
des glaces.
Mais, quand je pense à ce voyage sur Le Celte,
je me dis que nous avons eu beaucoup de chance de ne pas
faire naufrage. Alors, nous avons senti que le bateau
avançait à vitesse réduite par la suite. Puis, on nous a
annoncé l’arrivée à bon port sous quelques heures. Très
exactement, dans un brouillard très épais, nous sommes
rentrés le mardi 26 avril, dans l’après-midi, sous bonne
escorte des pilotes. C’est là que le Monsieur me
dédicaça un autographe, avant de nous quitter, en me
disant que je lirais ses romans plus tard, dans
l’avenir. Je regrette beaucoup de ne pas avoir conservé
cette preuve, en souvenir de ce voyage. Il n’en reste
pas moins certain que, lorsque j’en parle autour de moi,
on n’ose pas croire que j’ai côtoyé Louis-Ferdinand
Céline pendant onze jours.
Ainsi le hasard veut que j’écrive ces souvenirs en
cette année 1994, date anniversaire du centenaire de sa
naissance. Le 27 mai dernier, j’ai eu une pensée
particulière pour celui que j’appelais le Monsieur
lorsque nous nous sommes connus.
Jeanne Allain-Poirier.
(BC n°145, octobre
1994).
NEW-YORK
1er
Février 1937 : Départ pour New York. Il arrive le 8
février. Il est là pour négocier personnellement les
droits de traduction pour Mea culpa et Mort à crédit
(séjour au Barbizon hotel, New York, du 8 au 20
février. De retour en France fin février.
Début
mai : Quitte Paris pour Saint-Malo.
Mai 1937: C’est dans la cité corsaire que sont commencés
les pamphlets. Céline dès les premières pages de
Bagatelles confie : « Vers la fin de cet été,
j’étais encore à St Malo, je reprenais après un dur
hiver, le souffle… J’allais rêvant,
 méditant
au long des grèves. Je revenais, ce jour-là, tout pensif
du « Grand Bé ». Je cheminais lentement à l’ombre des
remparts, lorsqu’une voix… mon nom clamé… » méditant
au long des grèves. Je revenais, ce jour-là, tout pensif
du « Grand Bé ». Je cheminais lentement à l’ombre des
remparts, lorsqu’une voix… mon nom clamé… »
Le 23 juillet : De Saint-Malo Céline écrit à Gen Paul
qui s’apprête à partir le 1er août : « Te
voici bientôt sur le départ… […] Amuse-toi bien. Vois
surtout Sande (Margaret Sande, danseuse américaine au
Radio City Music Hall de New York, que Céline connaît
depuis 1936), de ma part et les amis Bourgeois et
Parker. Il est possible que je me trouve à ton retour au
Havre. […] Profite bien de cette aventure. J’attends
avec impatience et grande joie ton retour triomphal.
Dessine-moi des danseuses au Radio City. Ton vieux pote.
Mes bonnes amitiés à ta femme. Les amitiés aux potes – à
Pépino – à Bonvilliers – à tous les autres. »
Céline a commencé la rédaction de Bagatelles pour un
massacre.
Dans ce pamphlet houleux, qui ne traite pas seulement
de politique mais aussi d’esthétique, parmi les peintres
qui se rapprochent le plus de son idéal, Céline cite Gen
Paul, avec Vlaminck et Mahé. Sans doute à partir de là
les légendes – et Montmartre en est riche – vont
l’emporter sur la petite histoire.
Dans Bagatelles, Céline fait de Gen Paul un
personnage, mais qui demeure proche du modèle : « Popol,
mon pote […] Il est peintre, c’est tout vous dire, au
coin de l’impasse Girardon. » C’était clair et
précis. La suite est moins innocente, Céline prête des
paroles au peintre : « T’auras du coton… Les Juifs,
ils sont tous au pouvoir… […] T’auras du mal à les
sortir… Les youtres c’est comme les punaises… Tu sais
pas où tu mets les doigts… Ils te feront repasser… pas
eux-mêmes !... Mais par tes propres frères de race…
C’est des fakirs cent pour cent… […] Dans les Beaux-Arts,
ils ont tout pris ! Tous les primitifs les folklores !
Ils démarquent tout, truquent ! […] Tous les
professeurs, tous les jurys, les galeries, les
expositions sont à présent pleinement youtres. »
(E. Mazet, Spécial Céline)
LENINGRAD
Je créchais à l'Hôtel de l'Europe,
deuxième ordre, cafards, scolopendres à tous les
étages... Je dis pas ça pour en faire un drame... bien
sûr j'ai vu pire... mais tout de même c'était pas "
nickel "... et ça coûtait rien que la chambre, en
équivalence : deux cent cinquante francs par jour ! Je
suis parti aux Soviets, mandaté par aucun journal,
aucune firme, aucun parti, aucun éditeur, aucune police,
à mes clous intégralement, juste pour la curiosité...
Qu'on se le répète !... franc comme l'or !... Nathalie,
elle me quittait vers minuit comme ça... Alors j'étais
libre... Souvent j'ai tiré des bordées, après son
départ, au petit bonheur... J'ai suivi bien des
personnes... dans des curieux de coins de la ville... Je
suis entré chez bien des gens au petit hasard des
étages... tous parfaitement inconnus. Je me suis
retrouvé avec mon plan dans des banlieues pas
ordinaires... aux petites heures du matin... Personne
m'a jamais ramené... Je ne suis pas un petit enfant...
J'ai une toute petite habitude de toutes les
 polices du
monde... Il m'étonnerait qu'on m'ait suivi... Je
pourrais causer moi aussi, faire l'observateur, le
reporter impartial... je pourrais aussi, en bavardant,
faire fusiller vingt personnes... polices du
monde... Il m'étonnerait qu'on m'ait suivi... Je
pourrais causer moi aussi, faire l'observateur, le
reporter impartial... je pourrais aussi, en bavardant,
faire fusiller vingt personnes...
Quand je dis : tout est dégueulasse dans ce pays
maléfique, on peut me croire sans facture... (aussi vrai
que le Colombie a essuyé des petites rafales de
mitrailleuses en passant devant Cronstadt, un beau soir
de l'été dernier)...
La misère russe que j'ai bien vue, elle est pas
imaginable, asiatique, dostoiewskienne, un enfer moisi,
harengs-saurs, concombres et délation... Le Russe est un
geôlier-né, un Chinois raté.
[...] La ville emportée s'étend vers les nuages... ne tient plus à la
terre... Elle s'élance de partout... Avenues
fabuleuses... faites pour enlever vingt charges de
front... cent escadrons... Newsky !... Graves personnes
!... de prodigieuses foulées... qui ne voyaient
qu'immensité... Pierre... Empereur des steppes et de la
mer !... Ville à la mesure du ciel !... Ciel de glace
infini miroir... Maisons à leur perte... Vielles,
géantes, ridées, perclues, croulantes, d'un géant
passé... farci de rats... Et puis cette horde à ramper,
discontinue, le long des rues... poissante aux
trottoirs... rampe encore... glue le long des
vitrines... faces de glaviots... l'énorme visqueux,
marmotteux, grouillement des misérables... au rebord des
ordures... Un cauchemar traqué qui s'éparpille comme il
peut... De toute les crevasses il en suinte... l'énorme
langue d'Asie lampante au long des égouts... englue tous
les ruisseaux, les porches, les coopératives.
C'est l'effrayante lavette éperdue de Tatiana
Famine... Miss Russie... Géante... grande comme toutes
les steppes, grande comme le sixième du monde... et qui
l'agonise... C'est pas une erreur... Je voudrais vous
faire comprendre, de plus près, ces choses encore...
avec des mots moins fantastiques...
Imaginez un petit peu... quelque " Quartier " d'ampleur immense...
bien dégueulasse... et tout bondé de réservistes... un
formidable contingent... toute une armée de truands en
abominable état... encore nippés en civil... en
loques... tout accablés, gueunilleux... efflanqués...
qu'auraient passé dix ans dans le dur... sous les
banquettes à bouffer du détritus... avant de parvenir...
qu'arriveraient à la fin de leur vie... tout éberlués...
d'un autre monde... qu'attendraient qu'on les équipe...
en bricolant des petites corvées... de ci... de là...
Une immense déroute en suspens... Une catastrophe qui
végète.
(Bagatelles pour un massacre, Ecrits controversés, Omnia Veritas, Ltd,
p. 257).
VOYAGES et écritures
entre les quatre ans qui séparent "
Le Voyage de Mort
à crédit et de Mea culpa..."
de 1932 à 1936.
Insaisissable Céline !
Tantôt il est en Suisse et tantôt en Belgique. En
1934, on le retrouve aux Etats-Unis puis encore en
Belgique.
Un an plus tard, il fait un saut à Londres puis gagne le Danemark et
l'Autriche.
Il connaît alors une brève liaison avec la pianiste Lucienne Delforge. Et
durant toutes ces années s'écrivait lentement,
péniblement, son deuxième roman qui, intitulé d'abord
L'Adieu à Molitor, allait bientôt trouver son titre
définitif : Mort à crédit.
L'année 1936 fut décisive pour Céline. Il y eut la parution de Mort à
crédit, ses premières amertumes et ses premières
rancœurs à l'encontre des
milieux littéraires qui l'ignoraient ou le boudaient.
Il y eut dans sa vie privée, sa rencontre avec Lucette Almanzor, jeune
danseuse de l'Opéra Comique qu'il avait connue au cours
de danse de Mme d'Alessandri et qui allait devenir la
compagne - admirable de dévouement, de fidélité et de
silence - de toute sa vie.
Il y eut enfin son voyage en Union soviétique en juillet 1936, pour y
dépenser ses droits d'auteur du Voyage.
Dabit venait de mourir là-bas. Céline partit avec curiosité sinon avec
espoir. Sa déception fut pourtant cruelle.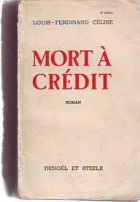
A André Pulicani, rencontré au retour chez Gen Paul, il confia : " En
résumé, trois choses, trois choses seulement, marchent
bien chez les Soviets : armée, police, propagande !
"
Et en décembre, il faisait paraître chez Denoël Mea culpa, bref
pamphlet incendiaire contre l'Union soviétique et le
système communiste.
A côté, la parution de l'un de ses arguments de ballets, Secrets
dans l'Ile, dans un recueil collectif de textes de
lauréats du prix Renaudot publié chez Gallimard en
novembre, ou la mise en scène au théâtre des Célestins
de Lyon de L'Eglise, pour une seule
représentation le 2 décembre, parurent des évènements
bien secondaires.
Du 20
juin au 4 août 1934 : Séjour aux USA. 67 lettres entre
ces dates éclairent son activité. Céline s’embarque au
Havre sur le « Champlain » vers le 12 juin et
arrive à New York le 20 où il descend à l’hôtel
Vanderbilt dans une chambre réservée par l’éditeur.
Il prévoit le 22 de se rendre à Boston pour y rencontrer
John Dos Passos mais quitte brusquement New York pour la
Californie le 23, allant rejoindre Elizabeth Craig à Los
Angeles.
Le 2 juillet, c’est à son adresse qu’il fait suivre son courrier
par Little, Brown. Céline indique à Little, Brown une
nouvelle adresse le 18 juillet, celle de Jacques Deval à
Beverly Hills. Le 16, il est à Chicago (New Lawrence
Hotel) et ne regagne finalement New York que le 26
juillet où il séjourne à l’Hôtel Lafayette
jusqu’au 4 août, date de son embarquement pour la France
sur le même bateau qu’à l’aller. Il arrive au Havre le
12 août, deux mois après son départ.
Paul Marteau rapporte, dans son journal inédit, que Céline
aurait « connu Jacques Deval à Hollywood, priapique
comme personne ». C’est à l’occasion de ce voyage
que celui-ci essaya de placer à Hollywood un scénario
inspiré de Voyage, sans succès.
1935
Février 1935 : Céline a passé 15 jours en Autriche, et en mars,
quelques jours à Anvers. Ce n’est que fin avril 1936
qu’il mettra la dernière main à Mort à crédit.
En février, l’écrivain pousse Tayar à rencontrer Jacques Deval qui
pourrait réaliser ou même produire le film. Celui-ci
prépare alors Club de femmes, assisté de Jean
Delannoy, avec Junie Astor, Danielle Darrieux et
Valentine Tessier comme actrices principales. L’appétit
donjuanesque de Jacques Deval fit peut-être échouer
l’affaire. Ouessant ne se fit pas. Le
scénario de Secrets dans l’île sera publié chez
Gallimard en 1936 dans le recueil de nouvelles, Neuf
et une, consacré aux lauréats du Renaudot.
La pianiste Lucienne Delforge (1909-1993), compagne de
Céline entre mai 1935 et mars 1936 est évoquée sans être
nommée dans Bagatelles (p.358). Elle connut une
carrière internationale de pianiste et, grande sportive,
réussit trois fois l’ascension du Mont Blanc.
9 mai 1935 : Céline confie à Karen : « Gen Paul est très
amoureux de vous. Il est prêt à donner sa vie et son
œuvre et sa fortune. Il ne reculera devant aucun
sacrifice. Il va même apprendre tout à fait bien à jouer
du piston pour vous séduire. Je suis jaloux. »
En juillet, Céline se rend à Badgastein avec Lucienne
Delforge.
Céline fait la connaissance de Lucette en cette fin
d’année. Elle a donné sa démission du ballet de l’Opéra
Comique, pour faire une tournée en Amérique.
1936
Avril 1936: Mort à crédit est achevé au Havre où rien ne
distrait Céline en dehors des mouvements du port.
3 septembre : Parti dans l’intention de se rendre à Moscou, Céline reste
trois semaines à Léningrad. Il embarqua, seul, sur le
Polaris à destination de Léningrad via Helsinki.
 26 septembre : Dans le Merle blanc est publiée
une lettre de Jean Etcheverry, de Biarritz, se
présentant comme un prolétaire, à Pierre Scize, via le
journal : « Je hais Céline. Parce que je n’aime pas
la merde. Je hais l’ordure. […] sa triste gueule de
dégénéré par excès de masturbation – à toi,
Ferdinand-la-Veuve-Poignet – d’obsédé sexuel, de
crapuleux érotomane. […] médicastre syphiligraphe […]
J’attends le suicide de Céline. Une salope la plus
parfaite salope de la littérature contemporaine. A
supprimer – et le premier – le jour où l’idéal crevant
nos paillasses, nous crèverons celles des saligauds de
son acabit. »
26 septembre : Dans le Merle blanc est publiée
une lettre de Jean Etcheverry, de Biarritz, se
présentant comme un prolétaire, à Pierre Scize, via le
journal : « Je hais Céline. Parce que je n’aime pas
la merde. Je hais l’ordure. […] sa triste gueule de
dégénéré par excès de masturbation – à toi,
Ferdinand-la-Veuve-Poignet – d’obsédé sexuel, de
crapuleux érotomane. […] médicastre syphiligraphe […]
J’attends le suicide de Céline. Une salope la plus
parfaite salope de la littérature contemporaine. A
supprimer – et le premier – le jour où l’idéal crevant
nos paillasses, nous crèverons celles des saligauds de
son acabit. »
3 octobre : Réponse de Céline : « Que risquez-vous à
publier un appel au meurtre contre moi ? Un petit peu de
correctionnelle. C’est tout. Puisque je n’appartiens à
aucun parti, aucune clique, aucune chapelle, que je suis
pratiquement seul ? […] Je n’ai même pas de miliciens à
mon service. »
En octobre : Il écrit à Cillie Ambor, ancienne petite amie
juive, autrichienne et communisante : « J’aurais bien
voulu t’épouser aussi Cillie si j’avais été riche. […]
Je suis revenu de Russie, quelle horreur ! quel bluff
ignoble ! quelle sale stupide histoire ! Comme tout cela
est grotesque, théorique et criminel ! »
Le 5 novembre : André Gide publie son Retour d’URSS, dédié «
à la mémoire de Eugène Dabit », où il critique l’absence
de liberté et de toute vie de l’esprit : « Je doute
qu’en aucun autre pays aujourd’hui, fût-ce dans
l’Allemagne de Hitler, l’esprit soit moins libre, plus
courbé, plus craintif, plus vassalisé. »
A Clichy, près du dispensaire, on se tue. Les ouvriers de l’usine de
bougies des quais de Clichy sont en grève, occupent
l’usine, et l’entreprise refuse d’appliquer les avancées
du Front populaire. Le fils du patron qui avait été
trésorier de la section locale des Croix de Feu,
force les grilles et provoque une fusillade qui fait
plusieurs blessés et un mort parmi les ouvriers. C’est
dans cette violence ambiante que Céline publie Mea
culpa le 28 décembre 1936.
Le 30 décembre 1936 : Mésentente entre Denoël et Steele,
notamment à propos du programme d’édition. L’américain
quitte la maison et cède à Denoël toutes ses parts dans
l’affaire.
VOYAGES encore après
" Le VOYAGE... "
Face à l'échec du
Goncourt, on aurait imaginé l'auteur du Voyage
plus détaché, plus désabusé, plus sceptique. S'il n'en
fut rien, c'est que Céline, à partir de 1932, bascula et
incarna un nouveau rôle, plus ou moins de bon gré :
celui de l'homme de lettres. Il en épousa donc les
regrets comme les ambitions.
Pourtant, cette intrusion de Céline parmi les personnages d'actualité ne
bouleversa pas sa vie quotidienne. Il ne renonça pas à
la médecine : il continua d'être attaché à la "
Biothérapie " et aux laboratoires Gallier, il conserva
ses vacations au dispensaire de Clichy.
Mieux : en décembre 1932, Céline quitta Paris en pleine crise Goncourt
pour une mission médicale officieusement supervisée par
Rajchman et le bureau d'hygiène de la S.D.N.
Il emmena sa mère à Genève, il gagna ensuite l'Autriche et l'Allemagne,
et écrivit à son retour un rapport rendu public sous le
titre : " Pour tuer le chômage, tueront-ils les
chômeurs ? "
C'est de Vienne, en Autriche, qu'il adressa encore à Léon Daudet cette
lettre fameuse où il résumait ainsi sa pensée : " Je
ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la
mort. Tout le reste m'est vain. "
C'est à Vienne encore qu'il retrouve sa maîtresse juive Cillie Ambor dont
il avait fait la connaissance trois mois plus tôt.
Hôtel Hessler - Berlin
[semaine de 18 décembre 1932]
Madame Cillie
Sie
sind böse und Jalouse mit mir. So ist es ! Ecrivez-moi
ici. Je partirai le 25 pour Breslau et serai le 2 ou 3 à
Vienne. J'irai directement à
l'Hôtel et NE VEUX pas coucher chez vous. Pour
plusieurs raisons. D'abord ce serait vous compromettre
très bêtement aux yeux de vos amis et de votre ami.
Ensuite je ne VEUX PAS que vous alliez coucher ailleurs
comme vous me le proposez.
Vous savez Cillie comme j'ai HORREUR qu'on fasse quelque chose
spécialement pour moi. Cela me gêne abominablement.
Soyez gentille indiquez-moi un hôtel très silencieux
près de chez vous. Je serai chez vous souvent mais
pas pour coucher.
De cette façon personne ne sera gêné. Voulez-vous être ainsi très
obéissante et très gentille ? Alors je vous aimerai
bien.
***
Pour le Goncourt ce fut une
horreur purement et simplement. Aucun plaisir cela ne me
fit - avec ou sans - C'est tout pareil pour moi. Je n'ai
retenu que la vulgarité, la grossièreté, l'impudeur de
toute cette affaire.
Il y a tant de gens qui aiment la gloire ou tout au moins la notoriété.
Sauf la Guerre je ne connais rien d'aussi horriblement
désagréable. Je fais tout ce que je peux pour oublier
cette catastrophe.
A bientôt Cillie et affectueusement
Louis.
(Lettres, Pléiade,
Gallimard, 2009).
RETOUR à CLICHY , puis
l'EUROPE.
L'année 1927 fut pour
Céline à Genève une année d'ennui, d'oisiveté
entrecoupée de pâles besognes administratives. S'il ne
voulait plus de la S.D.N., la S.D.N. ne voulait plus de
lui. Malgré l'appui de Rajchman, on le maintint à
l'écart. Décidément il n'avait pas su se plier aux
exigences d'un organisme qui le repoussait. Il se
contenta de dépenser inconsidérément son argent : il
acheta des meubles, des tapis, un cabriolet Citroën 5
CV. Il reçut chez lui beaucoup de jolies femmes (il
avait entre-temps déménagé). Parmi celles-ci, une jeune
danseuse américaine de vingt-quatre ans qui visitait la
Suisse avec ses parents : Elizabeth Craig.
En septembre 1927, quatre mois de repos (diplomatique) lui furent
accordés, qui correspondirent précisément avec
l'expiration de son contrat, le 31 décembre 1927 -
contrat qui ne lui fut pas renouvelé, bien entendu.
Céline ne laissa à Genève que
quelques dettes (remboursées laborieusement par la suite
après avoir été couvertes par Ludwig Rajchman)... et le
souvenir d'un être fantasque, intelligent et désordonné.
Mais il emporta, hélas ! de Genève les ferments d'un
antisémitisme qui avait déjà hanté sa jeunesse.
L'ordre et la logique anonymes des appareils qu'il lui avait été donné
d'approcher là-bas, cet ordre dont il ne cessa plus tard
de stigmatiser l'inhumanité, la bonne conscience abêtie
ou criminelle, il l'assimila désormais - dans son délire
encore inavoué, par conviction autant que par
prudence - à une Internationale Juive dont il croyait
avoir surpris certains responsables.
 De retour de Genève, Louis Destouches s'installa à
Clichy, au 36, rue d'Alsace. Un appartement de trois
pièces, pauvrement meublé, où il comptait exercer la
médecine en clientèle privée.
De retour de Genève, Louis Destouches s'installa à
Clichy, au 36, rue d'Alsace. Un appartement de trois
pièces, pauvrement meublé, où il comptait exercer la
médecine en clientèle privée.
L'expérience de Bardamu revenu d'Amérique et devenant médecin de banlieue
dès la fin de ses études semble manifestement inspirée
de ce qu'il connut alors. Il n'est que de relire le
Voyage.
Ce n'est pas avec des vieillards cacochymes, des chômeurs syphilitiques,
des ouvriers alcooliques, des concierges tuberculeuses
ou des enfants typhoïdiques que Louis Destouches
risquait de faire fortune. (...) Son adhésion à la
Société de médecine de Paris ne modifia guère son statut
social. Bientôt, Louis Destouches se retrouva au bord de
la faillite (d'autant plus vite qu'il lui fallait
rembourser encore les dettes contractées à Genève). Il
appela à l'aide Ludwig Rajchman. Ce dernier le
recommanda à Léon Bernard, titulaire de la chaire
d'hygiène de Paris, qui l'accueillit dans son service de
l'hôpital Laennec. Louis n'avait plus qu'à fermer son
cabinet de Clichy.
Après ce stage à l'hôpital,
Céline se vit offrir par la Direction de la médecine
d'hygiène populaire une vacation quotidienne de médecine
générale de cinq heures à six heures et demie,
l'après-midi, au nouveau dispensaire du 10, rue Fanny à
Clichy. Il y entra en fonction au début de l'année 1929.
A Clichy, il se trouva placé sous les ordres d'un médecin juif né en
Lituanie : Grégoire Ichok. Il espérait être nommé sans
doute lui-même médecin-chef de ce dispensaire. Très
vite, sa jalousie envers Ichok se mua en franche
hostilité. Une hostilité et une méfiance réciproques du
reste. C'est une atmosphère empoisonnée qui régna
longtemps au dispensaire, son personnel prenant parti
pour ou contre l'un des deux hommes.
Est-ce pour échapper à un tel climat, est-ce parce que le goût des
voyages ne l'avait vraiment jamais abandonné ? Céline
s'efforça durant toutes les années qui précédèrent la
parution de Voyage au bout de la nuit (mais tout
aussi bien après) de dénicher le prétexte de missions
médicales pour s'enfuir à l'étranger, pour passer
quelques jours ou quelques semaines loin du dispensaire,
loin de Paris, loin des décors, des êtres et des métiers
qui se répètent.
Il n'avait pas rompu tous les
liens qui le rattachaient à la S.D.N. En février 1929,
il sollicita du bureau d'hygiène des subsides pour
effectuer en Angleterre une enquête sur la médecine de
dispensaire. Ludwig Rajchman lui donna satisfaction.
A la fin mars, Louis quittait Paris. Jamais il n'adressa de rapports à la
S.D.N.... Ce qui ne l'empêcha pas de réclamer une
nouvelle aide pour visiter cette fois les Pays-Bas, le
Danemark, la Suède et l'Allemagne, en novembre de la
même année.
(F. Vitoux, Céline, Dossiers Belfond,
1978).
L'AFRIQUE.
Le 14 mars 1926, départ
pour Dakar où l'attendait une nouvelle délégation de
médecins anglais, belges, espagnols, français, etc.,
qu'il avait pour mission de conduire, afin d'étudier les
systèmes d'organisation sanitaire de la côte Ouest de l'Afrique, du Sénégal au Nigéria, et de débattre de
l'opportunité pour la S.D.N. d'établir un bureau
d'hygiène en Afrique occidentale.
l'Afrique, du Sénégal au Nigéria, et de débattre de
l'opportunité pour la S.D.N. d'établir un bureau
d'hygiène en Afrique occidentale.
Le voyage se révéla décevant. Mal organisé, épuisant, inefficace, se
diluant en palabres inutiles et en susceptibilités
nationales mesquines, il accabla Céline et contribua
sans doute à le détacher de la S.D.N. et de sa lourdeur
bureaucratique.
AU DOCTEUR LUDWIG RAJCHMAN
Dakar, 12 avril 1926
Monsieur le
Directeur, je veux vous signaler que j'ai rencontré chez
Lasnet (échangiste mais aussi inspecteur des colonies)
un médecin susceptible d'être internationalisé, à tous
usages, Singapour ou autres.
C'est Lucas Championnière, le fils du grand savant. Ce garçon me
paraît avoir bien des qualités. Il connaît bien l' "
étranger ", parle anglais, allemand.
Je vous envoie un petit " curriculum vitae " de sa main, qui peut faire
aussi l'objet d'une analyse graphologique.
Votre bien dévoué.
L.F. Destouches.
(Lettres, Pléiade, Gallimard, 2009).
L'AMERIQUE.
(...) Du 14 février au 8
août 1925, il accompagna un groupe de médecins
d'Amérique latine dans un périple aux Etats-Unis, à
Cuba, au Canada, puis en Grande-Bretagne et en Europe
occidentale.
L'Amérique ! Il n'avait cessé d'en rêver... New-York ! On sait
l'image terrible et fascinée qu'il en donnera plus tard
dans le Voyage...
Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite.
New-York c'est une ville debout. On en avait déjà vu
nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des
ports et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas,
elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur
les fleuves, elles s'allongent sur le paysage, elles
attendent le voyageur, tandis que celle-là l'américaine,
elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide,
là, pas baisante du tout, raide à faire peur.
 Il importe assez peu de connaître les détails de ce
voyage au Nouveau Monde, les hôpitaux, les abattoirs ou
les nurseries visités à Baltimore ou à Montréal, à
Toronto ou à La Nouvelle-Orléans.
Il importe assez peu de connaître les détails de ce
voyage au Nouveau Monde, les hôpitaux, les abattoirs ou
les nurseries visités à Baltimore ou à Montréal, à
Toronto ou à La Nouvelle-Orléans.
Notons simplement deux brefs séjours à Détroit et à Pittsburgh, dont
Céline tira la matière de deux rapports sanitaires sur
l'organisation des usines Ford et Westinghouse (ces
mêmes usines Ford que l'on retrouvera dans Voyage au
bout de la nuit et où Céline prétendra avoir
travaillé).
Ensuite, ce fut Londres, La Haye, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Turin,
Ferrare, Ravenne et Rome.
Détour dans l'univers de la
construction automobile du début du siècle. Céline nous
décrit l'usine Ford de Détroit. Ce n'est pas n'importe
quelle usine ! Céline choisit un symbole Ford,
constructeur de la première voiture fabriquée en série,
la type T, est visé. C'est certain. On est très loin des
usines d'aujourd'hui, hyper modernes, automatisées, à
l'aspect parfois clinique.
" Et j'ai vu les grands bâtiments trapus et vitrés, des sortes de
cages à mouches sans fin, dans lesquelles on discernait
des hommes à remuer, mais remuer à peine, comme s'ils se
débattaient plus que faiblement contre je ne sais quoi
d'impossible. C'était donc ça Ford ? "
Il devient ouvrier pour vivre cet " enfer " de l'intérieur. " C'était
vrai, ce qu'il m'expliquait qu'on prenait n'importe qui
chez Ford. Il avait pas menti. "
Il se jette dans la machine de production complètement désespéré. "
Tout tremblait dans l'immense édifice et soi-même des
pieds aux oreilles possédé par le tremblement, il en
venait des vitres au plancher et de la ferraille, des
secousses, vibré de haut en bas.
On en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande
encore tremblante dans ce bruit de rage énorme qui vous
prenait le dedans et le tour de la tête et plus bas vous
agitant les tripes et remontait aux yeux par petits
coups précipités, infinis, inlassables.
A mesure qu'on avançait on les perdait les compagnons. On leur
faisait un petit sourire à ceux-là en les quittant comme
si tout ce qui se passait était bien gentil !
Alors à force de renoncer, peu à peu, je suis devenu comme un
autre. Un nouveau Ferdinand. Après quelques semaines.
Tout de même l'envie de revoir des gens du dehors me
revint. "
(F. Vitoux, Céline, 1978).
GENÈVE
et la S.D.N.
Le 1er mai 1924, la
thèse de médecine soutenue devant les professeurs
Brindeau et Follet, et le professeur Gunn de la
Fondation Rockefeller, avec la mention " très bien "
qu'allait devenir le docteur en médecine ?
 Louis, qui continuait d'aimer les voyages et les
bateaux, avait passé en juin 1924 ses examens de
médecine sanitaire maritime - mais il ne chercha pas
vraiment à devenir alors médecin de paquebot. Il restait
aussi un hygiéniste de goût et de formation (sa thèse en
apportait une preuve supplémentaire) - un hygiéniste qui
aurait gardé la nostalgie des départs. Pouvait-il rêver
mieux qu'un poste à la Société des Nations à Genève avec
ses promesses de nombreuses missions ?
Louis, qui continuait d'aimer les voyages et les
bateaux, avait passé en juin 1924 ses examens de
médecine sanitaire maritime - mais il ne chercha pas
vraiment à devenir alors médecin de paquebot. Il restait
aussi un hygiéniste de goût et de formation (sa thèse en
apportait une preuve supplémentaire) - un hygiéniste qui
aurait gardé la nostalgie des départs. Pouvait-il rêver
mieux qu'un poste à la Société des Nations à Genève avec
ses promesses de nombreuses missions ?
Le professeur Gunn l'avait mis
en rapport avec le Dr Ludwig Rajchman qui s'occupait
précisément de l'organisme international d'hygiène de la
S.D.N.. Sa candidature fut retenue.
A la fin juin, Céline était à Genève. Il s'installa dans un bel hôtel du
bord du lac. Sa femme plusieurs fois, vint le retrouver
- mais pour de brèves périodes. Manifestement, elle
était de trop - et Louis le lui fit bien sentir. Il ne
voulait plus renoncer à son indépendance...
Son activité professionnelle consista en premier lieu à rédiger des
dossiers et des mémorandums pour l'administration de la
S.D.N. Ces rapports, Ludwig Rajchman les lui faisait
réécrire plusieurs fois de suite, jusqu'à ce qu'ils
fussent dans le ton convenable, prudent et neutre des
rapports administratifs de la Société des Nations.
Heureusement, il ne resta pas
longtemps sédentaire. En janvier 1925, il accompagna
Rajchman à Paris pour régler, entre autres, des
problèmes de coordination sanitaire dans les colonies
africaines...
(F. Vitoux, Céline, Les dossiers
Belfond, 1978).
LES BELLES ANNEES RENNAISES
DE CELINE (1918-1924).
Gare de Rennes, mars
1918. La guerre bat son plein. Louis Destouches, un
parisien de 24 ans, débarque du train au milieu d'une
drôle d'équipe. Beau gosse, il pavoise en uniforme
d'officier américain dans une escouade de propagandistes
" qualifiés ". Tous appartiennent à la Mission
Rockefeller venue en France repousser le fléau de la
tuberculose.
Blessé en 1914, devenu
surveillant d'un entrepôt forestier au Cameroun, puis
rédacteur dans une revue scientifique (Euréka), le futur
Céline vient juste de se faire recruter par les
philanthropes américains. Cette mission le met en joie.
Lui, le sans diplôme, rêvait de médecine. Rêvait aussi
de connaître la Bretagne de ses ancêtres.
En ce printemps 1918, l'accueil des Rennais est triomphal. De la gare à
la mairie, la foule acclame les hygiénistes
franco-américains. Dès le lendemain 11 mars, conférence
inaugurale au théâtre de Rennes avec tout le ban et
l'arrière-ban des notables. Au premier rang des
orateurs, se trouve le Dr Athanase Follet. Président du
Comité départemental de lutte contre la tuberculose, il
est à l'origine de la venue de la Mission Rockefeller en
Bretagne.
Du bagout contre la
tuberculose.
S'inscrivant dans la litanie des
discours, le jeune orateur Destouches n'en mène pas
large. " Ce que j'ai pu bafouiller les premières fois
! Je revois avec terreur la grande séance dans le
théâtre de Rennes, tout illuminé, et c'est grand ce
machin-là ! Tout contre moi, le général D'Amade et puis
le docteur Follet, qui
devait devenir plus tard mon beau-père.
Ça a été épouvantable, et
puis, petit à petit, je me suis habitué à parler comme
on s'habitue à tout. "
Céline comme d'habitude en
rajoute dans ce témoignage tardif. Le journal
L'Ouest-Eclair ne le mentionne nullement parmi les
orateurs de la soirée. En revanche, oui, le jeune
Destouches se fit remarquer dès le lendemain 12 mars
pour sa première conférence. Au cinéma Omnia, face à un
public composé uniquement de filles du lycée et de
l'école normale, le " propagandiste " s'en donne à cœur
joie, s'exprimant " avec une grande science " et " un
art goûté des plus fins connaisseurs ", note le journal.
Le futur Céline enchaîne plusieurs interventions par
jour.
Au bout d'une semaine, le voici
parfaitement rodé sur la scène du Théâtre municipal
devant le maire Jean Janvier et les syndicats de la
Bourse du travail. " Dans un langage clair et précis ",
le jeune Destouches recommande " une lutte énergique
contre l'alcool, rappelant que c'est le lit où se couche
la tuberculose. " La presse souligne son langage " net
et saisissant ", ainsi que les applaudissements qui
ponctuent chacune de ses prestations.
Au moment de la mort de Céline
en 1961, les Petites Affiches de Bretagne prétendirent
que lors de la soirée inaugurale au théâtre de Rennes,
Destouches fit scandale en proclamant des opinions
politiques virulentes, ce qui eut pour conséquence que
l'archevêque, le préfet et les généraux quittèrent les
lieux avec éclat.
Photo: En tournée sur les routes
de Bretagne à bord de la " roulotte d'hygiène ".
(Georges Guitton, Place Publique Rennes n°5, mai-juin 2010, dans le
Petit Célinien, 2 août 2012).
L'AFRIQUE, LE
CAMEROUN.
En mars 1916, il
signa un contrat avec la Compagnie forestière
Sangha-Oubangui. Il était engagé comme stagiaire pour
une durée de six mois à compter de son arrivée à Douala.
Au terme de ce stage, il se trouverait lié pour deux ans
avec la compagnie.
Le Cameroun était avant la guerre une colonie allemande. Un corps
expéditionnaire français et anglais venait de l'occuper.
La France s'était appropriée la majeure partie de ce
territoire. Tout restait donc à faire pour encadrer la
nouvelle " colonie ". On recrutait à tour de bras dans
la métropole.
En mai 1916, Céline revint en
Angleterre. C'est de là qu'il embarqua - à Liverpool -
sur un petit cargo de la British Steam Navigation
Company, le R.M.S. Accra. Après deux escales à
Freetown et à Lagos, le cargo finit par toucher Douala.
Le voyage avait été épouvantable. Grelottant de fièvre,
abruti par des doses massives de quinine, Louis fut
achevé par la chaleur oppressante et une mer démontée.
Avec l'Amiral Bragueton du Voyage, il
immortalisa cette traversée cauchemardesque.
 Après quelques semaines passées à Douala (le " Fort-Gono " du
Voyage), il fut affecté à la plantation de
Bikobimbo d'où il rayonna aussi bien vers la côte, vers
Campo (le " Topo " du Voyage), que vers
l'intérieur. Après quelques semaines passées à Douala (le " Fort-Gono " du
Voyage), il fut affecté à la plantation de
Bikobimbo d'où il rayonna aussi bien vers la côte, vers
Campo (le " Topo " du Voyage), que vers
l'intérieur.
Rêvait-il de faire fortune ? Il encouragea son ami Milon à venir le
rejoindre, lui promettant monts et merveilles. En fait,
si l'on en croit Céline, son activité à Bikobimbo
consista surtout en un négoce élémentaire avec les
Noirs. A onze jours de marche du premier Européen, dans
un pays dévasté par des épidémies périodiques, la
malaria et la maladie du sommeil, il avait coutume de se
promener entouré de voiles épais contre les moustiques,
de s'intoxiquer à la quinine, de faire sa cuisine
lui-même, de peur d'être empoisonné, et de ne jamais se
séparer de son révolver, précieux pour régler ses
différents avec ses clients dans les yeux desquels il
surprenait parfois un éclair de vive convoitise... Tel
est du moins le portrait qu'il donnait de lui-même à son
amie Simone Saintu.
Dans l'une des ses lettres, il lui précisait ainsi ses activités :
" Le commerce que je fais est d'une simplicité angélique et consiste à
acheter des défenses d'éléphant pour du tabac.
" Vous ne sauriez imaginer combien le nègre préfère fumer une cigarette
que de toucher à l'argent en espèces dont il ne connaît
pas la valeur.
" C'était un spectacle rare pour moi dont j'ai vivement tiré parti à la
satisfaction de tous en leur vendant en moyenne
deux paquets de maryland pour une défense d'éléphant.
" Ces détails techniques vous intéressent sans doute fort peu, mais c'est
la seule raison qui m'incite à séjourner encore en ce
charmant pays, l'abreuvement de tabac jusqu'à la mort du
dernier éléphant. "
En septembre 1916, sa
position évolua. Il écrivit alors à Simone Saintu :
" Je vais changer de situation, je suis nommé directeur d'une grande
plantation de cacao et vais gagner pas mal d'argent.
" Ne me croyez pas en proie à un esprit de lucre qui ne m'a jamais
possédé. Je n'apprécie l'argent qu'autant qu'il nous
permet de s'occuper d'autres choses. "
Son absence d'esprit de lucre ne l'empêcha tout
de même pas de bénéficier quelques semaines plus tard de
près de 5 000 francs d'économies - somme assez fabuleuse
pour quelqu'un qui n'était censé gagner que 200 francs
par mois !
Que comprendre à cette lettre
adressée à Milon le 15 septembre 1916 ?
" Signe tout ce que l'on te montrera, ceci n'a aucune espèce
d'importance, ces contrats coloniaux sont léonins, n'ont
aucune valeur devant la loi et ne valent que le prix que
tu apportes à ta signature, ne t'arrête pas aux
questions d'appointements, je te dirai plus tard
pourquoi, surtout n'en parle pas à mon sujet.
" Tu vois que cela n'a pas été long. Tu peux en faire autant.
"
Sa famille eut-elle vent de ses indélicatesses
? François Gibault fait encore état du témoignage de sa
cousine Charlotte Robic et du silence réprobateur de
Georges Destouches aux incartades supposées de son
neveu... Une chose reste sûre : jamais Louis Destouches
ne fut inquiété ni même soupçonné de quoi que ce soit.
S'il regagna précipitamment la France, ce fut pour
raison de santé.
En janvier, ses crises de
dysenterie redoublèrent. Il sollicita son rapatriement
mais fut d'abord hospitalisé à Douala.
Le 10 mars 1917, le lieutenant-colonel Thomassin l'autorisa à rentrer en
France. Il embarqua finalement sur le R.M.S. Le
Tarquah.
Après escales au Nigéria, au Togo et en Sierra Leone, il arriva à
Liverpool. Au début du mois de mai, il s'installait chez
ses parents, rue Marsollier. Il était âgé de vingt-trois
ans...
Que retenait-il de son voyage en Afrique ? Ses lettres et écrits du
Cameroun permettent d'avancer une réponse assez précise.
Lui qui avouait sa bougeotte, son goût des voyages, il
découvrit là-bas la solitude et la liberté : "
L'absence absolue de commentaires sur ma conduite et la
grande, totale, absolue liberté. "
Ce thème revient du reste comme un leitmotiv dans presque toutes ses
lettres :
" Il me faut de temps en temps le contact bruyant de mes semblables
pour me faire apprécier la solitude et jouir de mon
isolement.
" Ne croyez pas que je professe une haine quelconque pour mes semblables,
j'aime au contraire les voir, les entendre, mais je fais
mon possible pour échapper à leur emprise - pour
entendre le son d'une cloche. il vaut mieux en être
éloigné, le bruit trop rapproché vous assourdit. "
(Frédéric Vitoux, Céline, Les dossiers Belfond, 1978).
VOYAGES en ANGLETERRE
ROCHESTER.
(...) En février 1909,
Fernand Destouches accompagna son fils à Rochester, dans
le Kent. Il l'avait inscrit à l'University School, une
bâtisse formée de deux maisons mitoyennes que tenait un
couple, M. et Mme Toukin.
Autant Céline n'évoqua jamais ses voyages d'enfant en Allemagne, autant
il donna de ses premiers séjours en Angleterre des
relations longues, passionnées et délirantes.
L'University Scool devint dans Mort à crédit le fameux " Meanwell
College ".
Le " Meanwell College " on ne pouvait pas désirer mieux comme air,
comme point de vue. C'était un site magnifique...
 Du
bout des jardins, et même des fenêtres de l'étude, on
dominait tout le paysage. Dans les moments d'éclaircie
on pouvait voir toute l'étendue, le panorama du fleuve,
les trois villes, le port, les docks qui se tassent
juste au bord de l'eau... Les lignes de chemin de fer...
tous les bateaux qui s'en vont... qui repassent encore
un peu plus loin... derrière
les collines après les prairies... vers la mer, après
Chatham... C'était unique comme impression... (Mort à
crédit, p.190). Du
bout des jardins, et même des fenêtres de l'étude, on
dominait tout le paysage. Dans les moments d'éclaircie
on pouvait voir toute l'étendue, le panorama du fleuve,
les trois villes, le port, les docks qui se tassent
juste au bord de l'eau... Les lignes de chemin de fer...
tous les bateaux qui s'en vont... qui repassent encore
un peu plus loin... derrière
les collines après les prairies... vers la mer, après
Chatham... C'était unique comme impression... (Mort à
crédit, p.190).
Le
fleuve, les bateaux, la mer qui entraîne... Cet endroit
ne pouvait que le faire rêver.
Le fantôme de Nora Merrywin qui tient avec son mari le " Meanwell College
", et dont l'enfant tombe éperdument amoureux, a-t-il
vraiment existé ? Une enseignante de l'University School
s'était-elle, comme Nora, suicidée ? Avait-elle
auparavant violé l'enfant ? La preuve n'en a jamais été
fournie. Reste que ce collège abrita sans doute la
sexualité solitaire, rêveuse, exténuante et insatisfaite
de Céline.
Louis avait alors quinze ans.
Au dortoir, ça continuait les grosses branlées... les suçades... Je
m'intriguais bien sur Nora... Mais toujours en
suppositions... (Mort à crédit, p.202).
L'enseignement était médiocre à l'University School, la discipline fort
relâchée et l'ordinaire insuffisant.
BROADSTAIRS.
Ferdinand Destouches avait bien
proposé à son fils de lui payer des suppléments de
nourriture. Louis s'y refusa par pudeur, pour ne pas
gêner ses camarades et ses maîtres. A Pâques, son père
prit la décision de le transférer dans une autre pension
qu'il avait dénichée à Broadstairs, sur la Manche : une
pension où l'enseignement était plus consciencieux,
l'ordinaire plus copieux, les locaux plus vastes, les
prix plus élevés et la responsable - Mme Farnfield -
plus gracieuse...
A son retour à Paris en
novembre 1909, Louis parlait et écrivait sans difficulté
l'anglais et l'allemand. Il était armé pour la vie...
De ses voyages à l'étranger, sans doute gardait-il la blessure des
premières séparations, l'habitude de la solitude
forgée dans un milieu hostile, le goût des situations
instables, mais d'abord une curiosité inépuisable pour
de nouveaux décors, de nouveaux paysages, de nouveaux
individus. A partir de cette date, Céline n'allait plus
rêver que de départs...
(Frédéric Vitoux, La vie de
Céline, Belfond, 1978).
Voyages en ALLEMAGNE
DIEPHOLZ.
(...) A la fin du mois d'août
1907, les Destouches envoyèrent donc Louis dans une
petite bourgade du Hanovre, Diepholz, où il suivit les
cours de la Mittelschule.
Le paysage était triste et maussade, l'enfant ne parlait au début pas un
seul mot d'allemand, il logeait en ville chez un
particulier, Hugo Schmidt.
On serait tenté d'imaginer par conséquent le jeune Céline abandonné à
lui-même, traînant sa misère et sa solitude
d'étranger au milieu d'une nature inhospitalière et
de camarades ou d'adultes indifférents. Ce serait une
erreur. Ses parents l'avaient accompagné à Diepholz. A
la Toussaint, sa mère vint le voir. A Noël, ce fut son
père qui fit le voyage.
Après une période d'acclimatation difficile, l'enfant s'adapta à son
nouveau milieu. Il suivit des cours de piano. Il s'i nitia
à l'anglais et pratiqua de nombreux sports. nitia
à l'anglais et pratiqua de nombreux sports.
" Hugo Schmidt quant à lui
fut frappé par la facilité avec laquelle Louis apprit
l'allemand, qu'il parlait assez couramment après
seulement quelques semaines passées à Diepholz. Il le
considérait comme un excellent garçon, louait sa gaieté,
sa bonne santé et son ardeur au travail. " (F. Gibault,
p.75).
Il remarqua encore que l'enfant écrivait longuement et fréquemment à ses
parents, n'hésitant pas à rédiger de véritables petites
chroniques qui parvenaient mal à contenir l'affection ou
la tendresse qu'il éprouvait pour son père et sa mère,
et que ceux-ci lui avaient appris justement à ne pas
extérioriser.
Il constata enfin à quel point Louis semblait obsédé par les
problèmes d'argent et d'économie. Ce souci ne devait
plus guère le quitter.
KARLSRUHE.
A Pâques 1908, il revint passer
quelques jours au passage Choiseul. Après les grandes
vacances, il repartit pour l'Allemagne, mais à Karlsruhe
cette fois, dans la famille d'un professeur : Rudolf
Bittrolff, chargé de l'éduquer, de le loger et de le
nourrir. Il y reprit non seulement ses études d'allemand
mais aussi ses exercices de piano.
Le 29 décembre, il débarquait à la gare de l'Est. Son premier séjour en
Allemagne s'achevait. Il fallait maintenant songer à
l'Angleterre.
(Frédéric Vitoux, La vie de Céline,
Belfond, 1978).
|