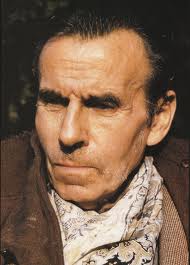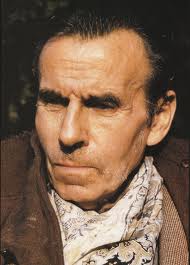|
LA
MORT
Jamais, en quelque circonstance, j'ai pu
me résigner à la mort... j'ai jamais pu abandonner
rien... la mort pour moi personnelle, serait une
aubaine, je serais bien content, mais la mort des autres
me vexe... [...] même les centenaires qui cassent leurs
pipes jamais été d'accord !... je suis pour le départ de
rien...
(Féerie pour une autre fois 2, p.393).
J'ai lutté gentiment contre elle, tant que
j'ai pu... cotillonnée, j'ai festoyée, rigodonnée,
ravigotée, et tant et plus... enrubannée, émoustillée à
la farandole tirelire... Hélas ! je sais bien que tout
se casse, cède, flanche un moment...
Je sais bien qu'un jour la main tombe, retombe, le long du corps... Et
tous les mensonges sont dits ! tous les faire-part
envoyés, les trois coups vont frapper ailleurs !...
d'autres comédies !...
(Le Pont de Londres).
Louis-Ferdinand CÉLINE : « je suis pour
le départ de rien... »
« " merde ! merde ! merde ! " la conscience c'est ça :
merde ! merde !... jamais, en quelque circonstance, j'ai
pu me résigner à la mort... j'ai jamais pu abandonner
rien... la mort pour moi personnelle, serait une
aubaine, je serais bien content, mais la mort des autres
me vexe... dans le fond du tréfonds de tout c'est pour
ça qu'on peut pas me piffrer, qu'on s'acharne à me
trouver mille crimes, parce que je râle à la mort des
autres... même les centenaires qui cassent leurs pipes
jamais j'ai été d'accord !... je suis pour le départ de
rien... merde ! merde ! merde ! »
(Louis-Ferdinand
Céline, Féerie pour une autre fois II, Romans IV,
Pléiade, p. 393. Le Petit Célinien, lundi 20 juin 2014).
*********
VOIR LA
DALLE OU REPOSE SA MERE
Les épreuves m'ont cassé,
j'avoue... tenez, je reviens à ma mère... je peux pas me
faire à cette tristesse... elle est enterrée
Père-Lachaise, allé 14, division 20... Je
voudrais bien
un " laissez-passer "... juste le temps d'aller voir la
dalle...
Tout est survenu d'une façon... elle a jamais su ce que j'étais devenu...
je lui porterais un pot de marguerites... c'était sa
fleur la marguerite... Marguerite Louise Céline
Guil lou... Elle est morte de chagrin de moi et
d'épuisement d'effort du cœur... des palpitations,
d'inquiétudes... de tout ce qu' " on " disait... pensez
les gens de l'avenue de Clichy !... les bancs...
l'opinion publique !... lou... Elle est morte de chagrin de moi et
d'épuisement d'effort du cœur... des palpitations,
d'inquiétudes... de tout ce qu' " on " disait... pensez
les gens de l'avenue de Clichy !... les bancs...
l'opinion publique !...
Elle a jamais su ce que j'étais devenu... nous l'avons vue partir un
soir, elle a pris la rue Durantin et puis la descente
vers Lamarck... et puis ce fut tout pour toujours...
elle dormait plus depuis des mois... Elle a jamais
beaucoup dormi... maintenant elle dort... Elle était
comme moi, soucieuse, trop consciencieuse... Elle avait
un petit rire en elle pourtant, moi je l'ai énorme... La
preuve dans ce fond de fosse, tenez, je peux rire quand
je veux, je pense à vous, magique, comment que vous
allez tortiller, gigoter, quand jouera la flûte, le
petit air d'en haut que vous connaissez pas encore... Le
rire c'est en soi ou y a rien...
Je l'ai vue rire, moi, sur des
dentelles, sur les " Malines ", les " Bruges ", des
finesses araignées, des petits nœuds, des
raccords, ma mère, surfils, qu'elle se
crevait les yeux... ça devenait des dessus de lit
immenses, de ces Paradis à coquettes, de ces
gracieusetés de dessin... de ces filigranes de
joliesse... que personne maintenant comprend plus !...
c'est en allé avec l'Epoque... c'était trop léger... la
Belle !... c'était des musiques sans notes, sans
bruit... pour l'ouvrière c'était ses yeux... ma mère
c'est ainsi... elle était aveugle pour finir... soixante
ans sur les dentelles !... J'ai hérité de ses yeux
fragiles, tout me fait pleurer, le gris, le rouge, le
froid... J'écris à grand'peine... oh, mais je dormirai
aussi moi ! ça viendra le moment du repos !... J'aurai
mérité... " Indigne ! " plus qu'indigne ! traître !
patati ! personne m'empêchera ma mort ! Saisi ! tout !
Dodo ! Je gagne !
Je voudrais bien un " laissez-passer " pour le Père-Lachaise, aller voir
la dalle, le nom... Oh ! l'impertinence ! qu'ils
suffoquent ! Excrément ! qu'ils hurlent, hors Patrie
!... A moi ? De Courbevoie ! eux qui viennent de replis
de fumiers qu'aucune carte mentionnera jamais ! de ces
désolations de sous-steppes qu'ont même pas de poteaux !
d'urinoirs ! de mares ! de grammaires ! c'est
l'outrecuidance qui me tuera ! vous verrez ! verrez les
cruautés de ces rebuts ! d'ébaubissement que je
mourrerai ! que tout est permis !... paillassons d'hier
!...
(Féerie pour une autre fois, Folio n° 918, Gallimard, 1985, p. 75).
********
Voyage
: un Culte du Moi paradoxal
Tout
commence avec la guerre, présentée comme une véritable
boucherie. C'est un abattoir dans lequel les hommes
ressemblent à des animaux que l'on sacrifie, d'où
l'expression " viande humaine ". Quant au champ
de bataille, il ressemble à un immense cimetière. Par
ailleurs, au retour des batailles, il ressemble à un
immense cimetière. Par ailleurs, au retour des
batailles, les soldats sont comparés à des fantômes, des
revenants tout juste sortis du tombeau. C'est-à-dire que
même ceux qui ne tombent pas sous les balles ennemis
sont marqués par la mort qui paraît inéluctable. Bardamu
se considère donc comme un " assassiné en sursis
", ce qui provoque chez lui un sentiment d'effroi contre
lequel il ne peut lutter. Effrayé, il ne veut pas mourir
et regrette de ne pas avoir commis un délit qui l'aurait
placé en sécurité, en prison. Après sa blessure et une
période de convalescence, la peur de retourner au front
le rend fou, ce qui lui vaut un nouveau séjour à
l'hôpital. Là, il explique à Lola qu'il s'interdit de
participer au carnage. Ce qui donne l'occasion à Céline
de signer un plaidoyer contre la guerre, voire toutes
les guerres, qui sont autant de vies perdues
inutilement, sans que personne ne s'en souvienne un
jour.
Mais c'est surtout en sa qualité de médecin que le personnage principal
se trouve souvent confronté à la mort. Et cela, qu'il le
veuille ou non, comme le montre l'exemple du père
Henrouille. Bardamu, qui souhaite avoir des nouvelles de
Robinson parti à Toulouse, se rend chez les Henrouille.
Arrivé devant leur pavillon, il désire repartir mais la
porte s'entrouvre et on l'invite à rentrer. Il se
retrouve alors au chevet du père Henrouille mourant, ce
qui lui fait dire : " [...] j'avais pour me trouver
dans des cas de ce genre une espèce de veine de chacal.
" Cela dit, même quand il ne la cherche pas, la mort se
présentait sur son chemin. Tenant à intensifier cette
atmosphère macabre, le narrateur nous propose ensuite
une description clinique de l'état du malade. Et, c'est
la mort dans toute son horreur, inéluctable, qui nous
est présentée dans ce passage. passage.
Céline utilise délibérément cet élément dans d'autres chapitres de son
roman ; et, c'est toujours à Rancy, qu'il situe le long
récit de l'agonie de la jeune femme ayant avorté, qui
s'étale sur plusieurs pages. Bardamu est complètement
impuissant, immobile, incapable de faire autre chose que
prendre le pouls de la mourante qui se vide de son sang.
La mort triomphe à nouveau comme ce sera encore avec le
personnage Bébert dans la suite du roman ; avec, en
outre, une réflexion sur l'incapacité de la médecine
pendant les semaines de souffrances endurées par
l'enfant. Du coup, la mort s'avère être également liée à
la banlieue, à la misère et le narrateur n'hésite pas à
comparer, dans cette vision lugubre, les murs des
immeubles à des cercueils.
Une des banalités ontologiques que Bardamu discerne, dans son voyage au
bout de la nuit, est que la mort ronge l'existence
humaine jour après jour. D'ailleurs la dissemblance
entre la vie et la mort n'est pas assez grande tel que
nous l'affirme le narrateur dans le passage suivant :
" [...] les vivants qu'on égare dans les cryptes du
temps dorment si bien avec les morts qu'une même ombre
les confond déjà. " Par conséquent, nous sommes tous
en sursis et ceux qu'on a oubliés sont considérés comme
trépassés. Notons que cette impression l'accable depuis
son séjour dans la chambre du père Henrouille agonisant.
Ainsi, les choses s'avèrent être beaucoup plus
supérieures à l'homme en ce qui concerne le fuite du
temps et la peur de la mort. Dans ce contexte, c'est
tout le roman qui est placé sous le signe de la mort et
pour Bardamu, " [...] toutes les pensées conduisent à
la mort. " Dans Voyage au bout de la nuit, la
mort est également présente dans son aspect le plus
sordide, dans l'épisode de Toulouse, quand Madelon fait
visiter le caveau rempli de cadavres à Bardamu. L'auteur
insiste sur la décomposition, la malpropreté et la
puanteur des corps.
Le roman commence sur les champs de
bataille et s'achève par la mort de Robinson.
Entre-temps, de nombreuses personnes ont péri. Ce sont
elles qui reviennent hanter Bardamu alors qu'il se
trouve dans un café de Montmartre avec Tania. Dans ce
long passage, le narrateur à l'impression de ne pas
pouvoir aller plus loin. Au cours de son hallucination
revoit ceux qu'il n'a pu sauver, Bébert, la jeune femme
qui avorte et d'autres encore. A la fin du passage, le
narrateur distingue un monde dans lequel " [...] tout
est presque fini " et où il n'y a " [...] presque
plus de vie [...] pour personne. " ; comme si la
terre vivait ses derniers instants. Tous les revenants
de toutes les époques se retrouvent là, ayant fait un
grand trou dans la nuit pour s'enfuir. Ils sont guidés,
par un grand voyageur, La Pérouse, comme si tous les
voyages, à l'image de celui de Bardamu, menaient à la
mort. En ce sens, dans l'œuvre de Céline, la quête
s'achève par la découverte de l'omnipotence de la mort,
qui est directement liée à la vérité prospectée par
Bardamu.
Ainsi, il n'est jamais aussi près de la vérité que quand il participe aux
combats durant la guerre : " J'étais dans la vérité
jusqu'au trognon, et même que ma propre mort me suivait
pour ainsi dire pas à pas. " Un peu plus loin, il
explique que pendant " ... cette espèce d'agonie
différée, lucide, bien portante... il est impossible de
comprendre autre chose que des vérités absolues. "
Aussi, c'est parce que la vérité est intimement liée à la mort en
Afrique, que Bardamu regrette de ne pas avoir regardé
les hyènes dans les yeux ; ces animaux qui aiment la
charogne et vivent de ce qui est inerte. Pareillement,
les cadavres qui sont dans la cave de la vieille
Henrouille à Toulouse s'avèrent être plus proches de la
connaissance que tous les vivants : " Ce n'est pas
tout à fait de la nuit qu'ils ont au fond des orbites,
c'est presque encore du regard, mais en plus doux, comme
en ont des gens qui savent. "
A ce niveau, il s'agit là aussi, d'une réflexion philosophique sur le sens
de la vie dont la conclusion réfute l'idée d'une
connaissance liée à la mort ; d'où le nihilisme
sous-tendu par les réflexions de l'auteur. Ce qui dénote
les lectures de Céline influencé doublement par
Nietzsche et Schopenhauer.
Dans son voyage intérieur, Bardamu doit faire face à ses propres démons.
Tout d'abord, sa peur est indéniablement liée aussi bien
à la guerre qu'à la mort. Certainement, Bardamu est
anxieux par lâcheté et le reconnaît volontiers, et cette
peur jouit d'une dimension romanesque bien plus large
dans la fiction de Céline. Effectivement, il est dans la
nature de l'homme d'être lâche, comme le montre par
exemple la cruauté des Blancs en Afrique ; et les
limites de Bardamu sont aussi celles du genre humain ;
ce qui pourrait s'apparenter aux propos de Freud pour
qui " dans les névroses de guerre, ce qui fait peur,
c'est bel et bien un ennemi intérieur. "
(Youssef Ferdjani, Voyage : un Culte du Moi paradoxal, BC n° 423, novembre
2019).
*********
JOUHANDEAU et la MORT de CELINE.
Le samedi 1er juillet 1961 mourait, dans son
pauvre pavillon des hauteurs de Meudon dans un décor de
terrain vague et de banlieue à la Marcel Carné, le
docteur Destouches - en littérature, Louis-Ferdinand
Céline - l'un des plus grands écrivains de notre temps.
Ce jour d'été d'il y a vingt ans, l'auteur du " Voyage au bout de la nuit
", revêtu de sa robe de chambre usée, incolore, et
chaussé de ses vieilles savates, avait dit à sa
 femme,
l'ancienne danseuse Lucette Almanzor : " Je voudrais
m'étendre un peu ". femme,
l'ancienne danseuse Lucette Almanzor : " Je voudrais
m'étendre un peu ".
Après avoir fermé les yeux quelques instants, il les rouvrit pour
murmurer ce qui reste ses dernières paroles : " Il
faudra penser à mettre les lettres à la poste... " Une
phrase de tous les jours, une réflexion de père
tranquille qui surprend dans la bouche d'un homme qui,
tant de fois dans tant de pages fameuses, hurla, injuria
et blasphéma avec son génie inégalé de pamphlétaire.
Pour le vingtième anniversaire de
la mort de cet écrivain ô combien non-conformiste et qui
eut le courage d'aller jusqu'au bout de son destin tout
en sachant qu'il avait choisi la mauvaise voie, la "
Revue célinienne " (Trolieberg 20, 3200 Kessel-Lo,
Belgique) a publié un numéro spécial de plus de 80
pages, illustré de plusieurs documents photographiques
inédits et composé de témoignages riches d'enseignement.
Les éditeurs ont eu l'excellente initiative de reproduire, en guise de
préface, ces propos de Marcel Jouhandeau : " Du moment
que nos erreurs ne reposent pas sur un intérêt, qu'elles
n'ont pas été dictées par un bon calcul, surtout si
elles n'ont réussi qu'à nous ruiner et à faire de nous
des martyrs, elles n'ont rien de regrettable.
" En politique, on ne peut guère que se tromper ou être trompé, tout n'y
étant que partis, partis pris qui aboutissent trop
souvent à des fanatismes opposés, aussi néfastes les uns
que les autres et à répandre le sang (on en pourrait
dire presque autant des religions).
" Ma conviction profonde à l'égard
de Ferdinand Céline, c'est qu'il n'avait pas plus
d'illusions sur les idées que sur les hommes et parce
qu'individu exceptionnel, comme son langage, il était
singulier, singulièrement impair, comparable et
réductible à rien d'autre qu'à lui-même, il me semble
mériter d'être respecté à l'égal de certans cyniques de
l'antiquité. Louis-Ferdinand Céline, c'est notre
Diogène. " (J.P.Tz).
(BC n° 1, Premier trimestre 1982, p. 2).
*********
LES MORTS DE CELINE.
Je leur ferai à tous... Hou
! rouh !... Hou !... rouh !... Ils crèveront de peur...
" Je suis de ces auteurs qui ont du souffle, du
répondant, du biscoto. J'emmerde le genre humain à cause
de mon répondant terrible, de ma paire de burnes
fantastiques (et bordel de dieu je le prouve !). Je
jute, je conclus, je triomphe, je trempe la page de
plein génie... De vous à moi, entre copains, c'est ce
qu'on me pardonne pas du tout, à la ronde, ce qu'on me
pardonnera jamais, jamais, la façon que je termine, que
j'achève les entreprises, que je vais au pied comme une
reine, à tous les coups 1.
"
Louis-Ferdinand Céline est-il mort
le 7 décembre 1932 quand le roman de Guy Mazeline,
Les Loups, remporta le prix Goncourt pourtant dû à
l'auteur de Voyage au bout de la nuit, " un récit
romancé, dans une forme assez singulière et dont je ne
vois pas beaucoup d'exemples dans la littérature en
général. [...] du pain pour un siècle entier de
littérature, [...] le prix Goncourt 1932 dans un
fauteuil 2 " ?
 Est-il mort quatre ans plus tard quand, en juin
1936, deux mois après la publication de Mort à crédit,
il écrivit à Charles Bonabel : " Quant à mon petit
établi il a été littéralement balayé par un flot
prodigieux de haine imbécile et bouillante. Echaudé je
le suis quant à la vente ! Ce pays n'a plus qu'une
ferveur, le dénigrement. Tout ce qui sape gagne
3 ! " ? Est-il mort quatre ans plus tard quand, en juin
1936, deux mois après la publication de Mort à crédit,
il écrivit à Charles Bonabel : " Quant à mon petit
établi il a été littéralement balayé par un flot
prodigieux de haine imbécile et bouillante. Echaudé je
le suis quant à la vente ! Ce pays n'a plus qu'une
ferveur, le dénigrement. Tout ce qui sape gagne
3 ! " ?
Est-il mort le 11 décembre 1937
lorsqu'il démissionna du dispensaire municipal de
Clichy, dirigé par le médecin juif et communiste
Grégoire Ichok, quelques mois après la publication de
Mea culpa, un court pamphlet qu'il rédigea après son
séjour dans l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques 4
?
Est-il mort à l'occasion du lancement de Bagatelles pour un massacre,
le 31 décembre 1937, pamphlet à l'origine de l'abandon
de l'écriture de Casse-pipe, et pour lequel il
écrivit à Marie Canavaggia, sa secrétaire : " Qui m'a
défendu pour M. à crédit ? Des tenants de la
haute littérature ? Qui ? Ce fut n'est-ce pas l'hallali
le plus lâche, le plus injuste, le plus écœurant...
Alors, je n'ai d'intention que du berger à la bergère...
Je me fous cosmiquement d'être impartial ou même
scrupuleux... Je suis en guerre contre tous. Comme tous
furent solidaires pour essayer de me réduire à rien.
Ceci est peut-être mesquin mais c'est solide et
pondérable. Ce n'est pas du vent. Tous ces " Soyez
noble... soyez au dessus... ne vous mêlez pas de ces
bassesses, etc... " sont des propos de juifs. Pour que
nous prenions les coups de pieds au cul avec le sourire
et que crevions en souplesse. [...] Ce livre est rédigé
sous le signe du plus grand désagrément. Il n'est
pas fait pour plaire - à personne
5. " ?
Est-il mort le 21 juin 1939 après
avoir été condamné par la 12e chambre correctionnelle à
4 400 francs d'amende de dommages et intérêts pour
injure et diffamation envers Pierre Rouquès, suite à la
publication, fin 1938, de L'Ecole des cadavres,
écrit polémique dans lequel il réclamait une alliance
militaire, politique et économique avec l'Allemagne,
alors que les armées d'Adolf Hitler venaient d'entrer à
Prague 6
?
Est-il mort en décembre 1941 quand Les Beaux Draps, ce manifeste de
l'utopie célinienne dédié " à la corde sans pendu ", fut
accueilli sans ferveur par la presse collaborationniste
et interdit par le ministère de l'Intérieur dans la zone
libre 7
?
Est-il mort en 1944 quand les journaux se montrèrent décontenancés
par Guignol's band, ce " kaléidoscope d'images
pénibles souvent ordurières
8 " publié le
15 mars et jugé en décalage avec ses prises de position
publiques depuis 1936
9 ?
Est-il mort en 1952 quand, deux ans après son retour d'exil, persuadé
qu'il suffirait de présenter sur les étalages le "
nouveau Céline " pour vendre les 33 000 exemplaires de l'édition courante, il accusa Gallimard d'organiser
la mévente de Féerie pour une autre fois
10 ?
de l'édition courante, il accusa Gallimard d'organiser
la mévente de Féerie pour une autre fois
10 ?
Est-il mort en janvier 1955 quand,
après avoir constaté que Normance ne serait pas
plus un succès de vente que le premier Féerie, il
se faisait traiter de " mufle " par Jean Paulhan
11, l'un des
fondateurs du Comité national des écrivains, l' "anémone
languide " qui avait pourtant fait les premières
approches pour une réédition de Voyage au bout de la
nuit chez Gallimard ?
Est-il mort en 1957 quand, fort des 23 000 exemplaires de D'un château
l'autre vendus en une année, il " rallie le fumier
(doré) du Système 13
" en faisant son grand retour sur la scène littéraire ?
Est-il mort en 1960 quand les Editions Gallimard durent retirer de la
vente Nord, ultime roman paru de son vivant, à la
suite de la plainte déposée par la propriétaire du
manoir de " Zornhof " qui s'y était jugée diffamée
13 ?
Est-il mort le 30 juin 1961 quand, exténué, il annonça à Lucette que
Rigodon était terminé et lui demanda d'acheter un
stylo avec lequel il fera sa copie de mise au net, avant
d'être emporté par une hémorragie cérébrale gauche le
1er juillet 1961 14,
laissant ainsi un texte complet, mais qui n'avait pas
reçu la dernière mise au point d'une copie définitive
15 ?
Céline n'est pas mort. " Pléiadisé
", objet d'un nombre incalculable d'études et de
publications en tous genres, présent dans les journaux,
à la radio, au cinéma, dans les postes télévisés, les
métros, dans les rayons des bibliothèques nationales,
municipales et privées, sur Internet et Facebook, dans
toutes les bouches (bienveillantes ou dédaigneuses,
instruites ou profanes), l'auteur de Mort à crédit
n'en finit pas d'exister et de se rappeler à notre bon -
ou mauvais - souvenir.
" Je veux passer fantôme ici, dans mon trou... dans ma tanière... Je leur
ferai à tous... Hou ! rouh !... Hou !... rouh !... Ils
crèveront de peur... Ils m'ont assez emmerdé du temps
que j'étais vivant... Ca sera bien mon tour...16
"
(Emeric Cian-Grangé, Spécial Céline n°28, avril-mai-juin 2018, P.33).
1. L'Ecole des cadavres, Denoël, 1938.
2. Lettre aux Editions de la NRF, peu avant le 14 avril 1932, (Lettres,
Gallimard, Pléiade, 2009).
3. Lettre à Charles Bonabel, juin 1936, (Lettres, Pléiade, 2009)
4. Lettre à Karen Marie Jensen, 6 février 1937, (Lettres, Pléiade, 2009).
5. Lettre à Marie Canavaggia, 26 octobre 1937, (Lettres, Pléiade, 2009).
6. Préface de la réédition de L'Ecole des cadavres, Denoël, 1942.
7. François Gibault, Céline : 1932-1944, délires et persécutions, Mercure
de France, 1985).
8. Jacques de Lesdain, Aspects, 2 juin 1944.
9. Georges Blond, L'Echo de Paris,15 avril 1944.
10. Lettre à Claude Gallimard, 12 septembre 1952,
(Lettres, Pléiade, 2009).
11. Lettre de Jean Paulhan à Céline, 14 janvier 1955,
(Lettres, Pléiade, 2009)
12. Pierre-Antoine Cousteau, Rivarol, 20 juin 1957.
13. Les Editions Gallimard publient au mois d'octobre
1964, une édition dite " définitive " de Nord, dans
laquelle tous les noms propres sont remplacés.
14. Certificat du Dr Willemin.
15. Le déchiffrement du manuscrit fut réalisé par Mme
Destouches, aidée de Me André Damien, puis de Me Gibault.
Le roman définitif paru en février 1969, sept ans et
demi après la mort de Céline.
16. Bagatelles pour un massacre, Denoël, 1937.
*********
TROIS CATEGORIES D'IMAGES DE MORT...
Dans tout texte célinien la
mort est là, injuste et absurde, elle guette les hommes
et la matière. Dans sa préface de 1932 au Voyage au
bout de la nuit, Céline écrit que
notre
voyage " va de la vie à la mort ". Dans Mort à crédit,
Ferdinand craint par anticipation pour des gens qu'on
perd " sur la route... des potes qu'on ne reverra
plus... plus jamais... qu'ils ont disparu comme des
songes... que c'est terminé... évanoui... qu'on s'en ira
soi-même se perdre aussi... [...] dans tout atroce
torrent des choses, c'est triste, c'est infâme -
Ferdinand crie son désespoir pour tous ces "
innocents qui défilent le long des vitrines " qui
passent, qui s'en vont, inexorablement.
Pour les besoins de notre analyse ,
nous distinguerons , suivant le critère de leur
dimension macabre et comique, trois catégories des
images de mort. Tout d'abord il y a des morts des
innocents, celles des enfants et des animaux, qui sont
pudiques, où l'on ne voit pas le cadavre et qui sont
exemptes d'éléments macabres. Un autre groupe constitue
les morts " méritées ", comme celle de Robinson ou de la
grand-mère Caroline, où l'on assiste à l'agonie et où le
macabre, biologique ou imaginatif apparaît mais reste
dans le registre de l'ordinaire. La troisième catégorie
enfin, apanage de Mort à crédit, constitue non
pas des images mais des visions de mort, de vraies
danses macabres où l'escalade des détails scabreux,
dégoûtants, terrifiants atteint son paroxysme.
Les représentants par excellence du
premier groupe nous paraissent le petit Bébert de
Voyage au bout de la nuit et la chienne Bessy
dans D'un château l'autre. Nous avons choisi ces
deux exemples parce qu'ils nous semblent
particulièrement impressionnants et riches en
connotations littéraires.
Bébert est le petit neveu de la concierge que le docteur Bardamu,
avec toutes ses connaissances médicales, n'arrive pas à
sauver de la mort. Emu, profondément bouleversé par son
impuissance de médecin, Bardamu cherche la consolation
dans la transcription en bas français de la célèbre
lettre de Montaigne à sa femme, ce qui confère à son
drame un air comique, hautement littéraire. Par contre
nous n'assistons ni à l'agonie de l'enfant ni ne voyons
son cadavre. Même ses funérailles nous sont
 épargnées. épargnées.
La mort " belle, discrète, fidèle ", émouvante, est celle de la chienne
Bessy. [...] Cette belle mort, sans " le tralala
" qui nuit aux hommes qui jouent leur agonie, rappelle
cependant de façon singulière le topoï de la mort
exemplaire remontant à la Chanson de Roland. Elle semble
calquée sur celle du fidèle chevalier qui expire la tête
tournée vers le nord, vers la douce France. Réminiscence
littéraire ou non, cette mort n'est qu'émouvante, sans
aucun trait macabre.
Le deuxième groupe des morts sont
les morts " méritées " selon l'idée de Céline
lui-même que la mort se mérite, irrévocable, atroce,
encore faut-il la payer. " C'est pas gratuit de
crever ! C'est un beau suaire brodé d'histoires qu'il
faut présenter à la Dame ". Si les deux morts du
premier groupe sont mineures dans le sens qu'elles
n'infligent pas directement sur l'intrigue, les morts de
Robinson et de la grand-mère Caroline ont un fort impact
sur l'avenir des protagonistes, Bardamu et Ferdinand.
Robinson, ce double maudit de Bardamu, meurt d'amour, il est blessé à mort
par la femme qui l'aime et qui refuse de tolérer le
manque d'amour de la part de son bien-aimé. Bardamu,
impuissant, assiste à l'agonie de son ami. Il est gêné :
en tant que médecin il ne peut pas l'aider et en tant
qu'ami il n'arrive pas à compatir. Ils étaient "
malins " tous les deux et quand on est " malin
" il est difficile d'éprouver du chagrin.
[...] Cette scène émotive (dans le sens que donne Céline à ce
qualificatif), avec ses détails de salle de dissection,
prolongée par celle du transport du corps sur une
civière au poste de police, clôt le roman et par le fait
même acquiert une importance capitale. Comique, elle ne
l'est sûrement pas, elle est paradoxale et dérisoire par
sa qualification du crime d'amour et la condition du "
malin " de l'agonisant - il a bien mérité sa mort,
absurde comme sa vie elle-même.
La mort de la grand-mère Caroline
dans Mort à crédit est plus complexe. La scène de la
mort, la nuit, précédée par la réunion de la famille et
la longue attente, présente plusieurs points communs
avec celle de la grand-mère de Proust dans Du côté
des Guermantes. Après les adieux, la famille attend,
" contractée " dans une pièce attenante. L'agonie est
pudique, l'on ne voit pas l'agonisante ; " une sorte
de hoquet " annonce la mort. La mère
s'évanouit. La description du deuil de la famille et de
l'enterrement est sobre. En somme une mort digne, bien
ancrée dans la tradition, inspirée de grande
littérature. Les éléments macabres et comiques
surviennent plus tard. La mère qui mène le grand deuil
fait amener les siens et son amie, Mme Divonne, au
cimetière. On visite le tombeau de Caroline, on apporte
les fleurs, toujours les roses, ses préférées, on change
les vases, on décore l'intérieur.
Ferdinand est sensible à la présence de sa grand-mère : " elle était
pas loin là-dessous ". Le caveau est propre et bien
entretenu. [...] Après être sortie du cimetière, Mme
Divonne annonce qu'elle a faim et qu'elle voudrait bien
manger de la galantine. L'idée même de galantine écœure
le garçon. " Je pensais plus qu'à vomir... Je pensais
à la galantine... A la tête que devait avoir là-dessous,
maintenant Caroline... à tous les vers... les bien
gras... des gros qu'ont des pattes... qui devaient
ronger... grouiller dedans ". Et effectivement il
vomit sur le pantalon de son père. Le père, furieux,
honteux, entre dans une de ses colères : il s'en va
feignant de ne plus connaître sa famille.
Le troisième groupe est constitué
des visions de mort situées sur la crête du registre du
macabre. Dès le début de Mort à crédit le délire
monte, atteignant le sommet de l'absurde et du dérisoire
avec les deux suicides : de Nora Merrywin et de Courtial
des Pereires. Le roman commence par la mort de la
vieille concierge du narrateur. La disparition de cette
" douce et gentille et fidèle amie " suscite la
révolte chez Ferdinand adulte. A qui en parler, à qui
écrire ? Il en éprouve de la haine pour ceux qui ont
disparu laissant le vide autour de lui. La mort se
mérite. Est-ce pour cela que les morts les plus
spectaculaires sont l'apanage des personnes les plus
spectaculaires, les plus hautes en couleurs comme Nora
ou Courtial ?
Madame Nora Merrywin exerçait sur Ferdinand un vrai sortilège. " Ses
mains... le visage, c'était une petite féerie rien que
de les regarder... C'étaient des ondes, des magies, au
moindre sourire... Ses cheveux aussi, dès qu'elle
passait devant la cheminée, devenaient tout lumière et
jeux !... Sa voix, c'était comme le reste, un sortilège
de douceur... " La faillite et la fermeture
imminente du collège poussent cette femme au suicide. La
description des derniers moments précédent le suicide et
la noyade elle-même, présentée dans le langage violent,
vulgaire, obscène, avec tous les détails pornographiques
des " adieux " de Nora et de Ferdinand provoque un
malaise profond. La longue scène, à la fois lyrique et
grossière, de la mort de Nora est d'une atrocité inouïe.
Le rapport de Ferdinand soulève le cœur.
Il regarde d'en haut " le petit carré blanc "
emporté par les vagues et entend même, par un effet
fantastique, ce dernier hoquet qui fait évacuer la vie. sortilège
de douceur... " La faillite et la fermeture
imminente du collège poussent cette femme au suicide. La
description des derniers moments précédent le suicide et
la noyade elle-même, présentée dans le langage violent,
vulgaire, obscène, avec tous les détails pornographiques
des " adieux " de Nora et de Ferdinand provoque un
malaise profond. La longue scène, à la fois lyrique et
grossière, de la mort de Nora est d'une atrocité inouïe.
Le rapport de Ferdinand soulève le cœur.
Il regarde d'en haut " le petit carré blanc "
emporté par les vagues et entend même, par un effet
fantastique, ce dernier hoquet qui fait évacuer la vie.
La mort de Courtial des Pereires,
personnage haut en couleur, atteint dans le paroxysme du
délire macabre de sa relation, la ligne de crête de
l'absurde, de la déraison et du comique. C'est la
faillite, comme dans le cas de Nora qui pousse Courtial
à se suicider. Il n'est pas comme la " fée " du Meanwell
College, la victime innocente de la ruine de son mari -
Courtial, inventeur fantasque, est homme de volonté,
c'est lui qui entraîne dans son désastre les autres.
Acculé au désespoir, il assume la catastrophe qu'il a
provoquée par sa mort qui, sous la plume de Céline,
devient une vraie apocalypse. L'histoire de son suicide
comprenant sa disparition, la découverte du corps, son
déplacement, l'arrivée des gendarmes, la veillée, la
visite du chanoine fou, jusqu'à l'enlèvement du corps
dans l'ambulance, compte plus de 45 pages (1036-1082).
[...] Les atrocités se superposent parce que le corps est gelé, il adhère
à la surface graveleuse de la route et il faut le
transporter. La description est détaillée : il faut
retirer le canon, mettre le cadavre sur la brouette. Le
sang gicle, il n'arrête pas de gicler. Tout le long
passage concernant les péripéties de la veuve et de
Ferdinand avec le cadavre est pénible à lire. Les images
macabres, atroces avec leurs scènes sanglantes, le
désespoir d'Irène, le traitement infligé au corps par le
chanoine fou atteignent un tel degré d'horreur qu'elles
deviennent comiques. C'est trop, c'est une vraie danse
macabre où l'épouvante se mêle au comique car son
illustration est folle et fausse.
[...] Le langage, lui aussi
imaginatif, permet à Céline de donner à ses écrits ce
ton violent et en même temps léger qui masque la
réalité. Il lui superpose sa propre réalité qui, quoique
calquée sur le réel, est imaginaire et illusoire. La
misère de Céline, et c'est dans sa présentation que la
griffe du génie se révèle dans toute sa puissance, est
une misère, somme toute, fantastique comme est
fantastique le cortège des morts dans Voyage au bout
de la nuit. Il est possible de se retrouver la nuit
place du Tertre, il est vrai que les gens meurent, nous
pouvons accorder que c'est absurde, nous pouvons croire
que leurs esprits vivent éternellement mais il ne nous
est pas possible de les voir cavaler dans le ciel
nocturne.
La vision célinienne de la misère est construite selon le même schéma,
tous les éléments sont ou peuvent être vrais, c'est leur
rassemblement qui est extravagant. L'absurde et la
dérision semblent venir de cette unification fallacieuse
: il y a toujours quelque détail qui détonne et qui
peut, à tout moment, dégénérer devenant monstrueux,
gigantesque.
Les images des morts, surtout
celles du troisième groupe ainsi que celles de la "
mistoufle ", paraissent l'œuvre
de cette imagination puissante qui, mariée à
l'humour noir, met en mouvement la spirale de l'absurde
qui transforme ce qui était réel en illusoire et ce qui
était terrifiant en burlesque ou tout simplement
comique. Et le rire est cette victoire de l'intellect
sur le mal dont parlait Rabelais.
(Anna, Kukulka-Wojtasik, BC n° 405, mars 2018).
*********
SOUDAIN, DANS UNE ENCOIGNURE, SON AILE DE
GOELAND VA FRAPPER LE DIEU DE DELPHES...
L'été a
surgi, torride. Il se retire sous la pierre de sa
maison, brûlante comme la Casbah. Il ne supporte plus le
soleil, sortant au crépuscule : " Je vais aux
commissions. " Il rapportait de Billancourt la viande
des bêtes, marcheur qui a perdu son ombre. Les gens de
Meudon en le croisant auraient pu dire, comme les
habitants de Vérone au sujet de Dante : " Eccovi l'uom
ch'è stato all Inferno " (Voyez, l'homme qui a été en
enfer).
C'en est fait de la nature. Le sacrifice commence. Le plumage doré des
tourterelles semble lever des soleils au couchant. La
nuit, la tempête est intolérable. Au-delà des jardins
fleuris, tout se consume, la ville ne dort pas, même
parmi le sommeil ; les jupes ne tiennent plus et
discrètement les receveurs d'autobus mettent leur
mouchoir sur la nuque. L'été pâle chauffe le dôme des
Invalides au milieu du désert, et toute la lumière
éclaire les ténèbres dans cette année 1961, qui ne sera
dans l'Histoire que celle de la mort de Céline.
Après bien
des allers et retours, il terminait. Hemingway fait
aussi le tour du cadran, tragédie du chasseur que ses
chevrotines vont répandre en lambeaux sur trois étages de façade.
étages de façade.
L'eau, les baigneurs, la pourriture extrême de l'été, la fumée des
sacrifices, quatre notes d'une péniche sur la Seine.
Table rase. Les mouches pullulent. On dort. Les
dentelles des vacances festonnent autour de la flamme du
Vésuve. Les matelots blancs pensent aux villages de la
Calabre, aux ânes des fermiers et les radars des navires
de guerre tournent sans bruit, le pape bâille, le bitume
fond. Tout est terni. La nuit porte à son paroxysme la
vision célinienne de la catastrophe présente, l'échec de
toute révolution vivante, en tant que poussée d'être et
de liberté face à la dialectique de l'histoire en marche
vers sa propre fin.
Et Céline,
dans une encoignure, frappe le Dieu de Delphes de son
aile de goéland, et le livre est écrit.
Aussitôt, il meurt.
La voie solaire s'est refermée.
Le 1er
juillet 1961, Louis-Ferdinand Céline est mort dans le
plus grand secret, terrassé, sur son couvre-lit
écarlate, d'une rupture d'anévrisme. La veille,
s'extirpant de ses catacombes, il était monté au balcon
boire aux glycines. Un instant, au milieu des éclairs de
chaleur, il était apparu comme un retraité sur la digue
du port, regardant sortir et entrer les navires, ce
monde, comme il disait, qui bagotte, s'en va, s'en
revient.
Et maintenant, malgré la clandestinité, malgré les quatre gerbes de
glaïeuls et de fleurs champêtres contrevenant à la
conspiration du silence, quel solennel apparat, quel
sombre mélancolie de l'être écartelé sur l'abîme de ses
plus secrets vertiges ornaient cette parole menaçante
contre laquelle on ne pourrait plus rien ?
Cependant, Lucette, danseuse de l'Opéra Comique, veuve de ce Convive de
pierre qui a fixé à jamais tout le drame de ce signe
bipolaire Hitler-Staline, fermait, du médius droit, les
paupières de l'homme seul.
C'était il y
a cinq ans. Humainement parlant, on enterrait Céline,
non comme Marlborough, dont on pouvait évaluer les
victoires ; on le portait en terre dans l'horreur de ce
jour sans ombre, comme le Juif au visage de supplicié
sur le chemin de sa libération. Et dans l'apaisement des
condoléances distraites, sous la dalle marquée d'un
voilier, Destouches, exclu de la horde, devenait à
jamais l'oiseau bizarre au-dessus des Totems, ses livres
eux-mêmes.
(Dominique de Roux, La mort de L.F. Céline, la petite vermillon,
octobre 2007, p.190).
*********
Pas d'église, pas de discours.
L'enterrement de Céline est prévu
pour le mardi 4 juillet. A 8 heures du matin, le corps
est mis en bière. Lucien Rebatet et quelques intimes
saluent une dernière fois la dépouille : " Le cercueil
était posé dans sa chambre à coucher, à côté de la porte
de la salle de bains grande ouverte. On voyait le
lavabo, les serviettes, et en tournant la tête de
l'autre côté, les hardes de Louis-Ferdinand, ses cinq ou
six canadiennes élimées, accrochées en tas au
portemanteau. " (Lucien Rebatet, Journal).
Sur le cercueil en chêne verni, une simple plaque : " Louis-Ferdinand
Destouches (1894-1961) ". Exécuteur testamentaire des
dernières volontés de Céline, Roger Nimier est arrivé à
Meudon au volant de sa vrombissante Aston Martin avec
deux journalistes pour que l'évènement soit relaté dans
la presse.
Ils rendront
compte du dernier voyage de Louis-Ferdinand Céline dans
leurs journaux respectifs. André Halphen dans
Paris-Presse-L'Intransigeant, et Roger Grenier dans
France-Soir. Un photographe, Claude Lechevalier,
immortalise la cérémonie pour le compte de
France-Soir. A 8 h 45, au moment où le corps quitte
la " ville Maïtou ", une pluie fine se met à tomber.
Roger Grenier évoque la scène: " Suivi de quelques
voitures, le corbillard entama la montée, à travers les
rues de Meudon, vers le cimetière des Longs-Réages. Il
continuait à pleuvoir. Le convoi n'est pas passé par
l'église, et il n'y a pas eu de discours. "
André Halphen, plus lyrique : " La pluie à commencé à tomber, fine, à
l'instant où les croque-morts ont sorti du pavillon de
la route des Gardes, à Meudon, la bière en chêne verni.
Il était 8 h 45 ce matin. Vingt et une minutes plus
tard, au moment précis où le dernier des trente intimes
a quitté l'ancien cimetière de Bellevue, le soleil est revenu [...]. La cérémonie avait été simple, rapide,
sans aucun apparat. Telle qu'il l'avait souhaitée.
Quelques couronnes de fleurs rouges : roses, glaïeuls,
œillets. Un caveau
provisoire dans le coin du vieux cimetière. A trois
mètres d'un dolmen. "
revenu [...]. La cérémonie avait été simple, rapide,
sans aucun apparat. Telle qu'il l'avait souhaitée.
Quelques couronnes de fleurs rouges : roses, glaïeuls,
œillets. Un caveau
provisoire dans le coin du vieux cimetière. A trois
mètres d'un dolmen. "
Une vingtaine
de personnes sont présentes pour un dernier adieu.
Lucette Destouches, Colette Turpin, Serge Perrault,
Roger Nimier, Gaston Gallimard, venu avec un prêtre pour
bénir le corps, Claude Gallimard, Marcel Aymé et ses
éternelles lunettes fumées, Lucien Rebatet, Robert
Poulet, l'acteur Jean-Roger Caussimon, le metteur en
scène Max Revol, et Renée Cosima, l'épouse de Gwenn-Aël
Bolloré, Arletty, retenue à Belle-Ile s'est excusée,
mais sera présente à l'inhumation définitive en octobre.
Selon certains témoins, Gen Paul se serait rendu au
cimetière, mais aurait été éconduit par le personnel
funéraire. L'enterrement est bref : " A peine au
cimetière, le cercueil a été glissé dans la fosse.
Quelques fleurs et c'en fut fini à jamais du docteur
Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, dont la vie
fut si longtemps pleine de bruit et de fureur. Il était
à peine neuf heures du matin. " (Roger Grenier, D'un
enterrement, l'autre).
Une photographie publiée dans France-Soir représente Lucette
Destouches et Colette Turpin côte à côte. Lucien Rebatet
commentera ironiquement la cérémonie : " Nous avons tous
jugé qu'il était parfaitement dans l'ordre de ce temps
que le plus grand écrivain français d'aujourd'hui fût
enterré ainsi, à la sauvette, par une poignée de
copains, beaucoup plus pauvrement qu'un concierge. " (Lucien
Rebatet, Journal).
Le lendemain,
5 juillet 1961,un communiqué diffusé par l'agence
France-Presse officialise la disparition de l'écrivain :
" La mort de Louis-Ferdinand Céline - survenue samedi
dernier, à 18 heures - avait été soigneusement cachée
par sa femme et ses amis. Les obsèques ont eu lieu hier
matin dans la plus stricte intimité. C'est à 8 h 45,
sous une pluie fine, que le fourgon mortuaire a quitté
la villa de Meudon pour gagner directement le cimetière.
Une cinquantaine d'amis entouraient Madame Lucette
Almanzor, veuve de l'écrivain. "
La nouvelle est diffusée à la radio. Ultime visiteur connu à Meudon,
Christian Dedet se rappelle le choc en entendant la
nouvelle de la mort de l'écrivain à la radio : "
Quelques instants plus tard, je reçois un coup de
téléphone. C'est Henny Dory : " Tu vois Christian, je te
l'avais bien dit qu'il allait mourir ! " (Témoignage
de Ch. Dedet à l'auteur).
Avec des
degrés divers, la presse rendra compte de la disparition
de l'écrivain. Mais de tous ces hommages, c'est Roger
Nimier qui écrira le plus beau texte sur la mort de
Céline. Texte d'autant plus beau qu'il est sobre et bref
: " Le Voyage est fini. Louis-Ferdinand Céline
est arrivé devant la nuit. Tant de guerres, tant de
misères, tant de haines traînées après soi, tant de
génie, tant de douceur secrète, c'est un mort bien
lourd, sur des jambes fragiles. Le siècle lui avait fait
l'honneur d'une trépanation et d'une médaille militaire.
Il le laissera partir comme il l'avait reçu. On ne
l'enfermera pas dans un Panthéon ou dans quelque
nécropole littéraire. Il est parti tout seul dans la
grande banlieue des morts. Il va peut-être retrouver
Robinson, bien changé lui aussi, comme on se retrouvait
au hasard d'une bataille.
Céline est mort comme Proust, acharné à finir son dernier livre,
Rigodon. Il est mort de fatigue, après avoir trop
donné de lui, partout, par la sympathie des animaux
souffrants les uns pour les autres. Mourir, quand on
n'a pas d'imagination, ce n'est rien. Quand on en a,
c'est trop. "
(David Alliot, Madame Céline, Tallandier, janvier 2018, p.210).
*********
La
mort de Courtial des Pereires.
La matinée
allait finir, il devait être à peu près onze heures...
Le vache facteur réapparaît... C'est moi qui l'aperçois
le premier... Je regardais un peu par la fenêtre... Il
se rapproche... Il rentre pas... Il reste planté là
devant la porte... Il me fait signe à moi de sortir...
qu'il veut me causer... que je fasse vite... Je
bondis... Il me rejoint sous le porche, il me chuchote,
il est en émoi...
- Dépêche-toi ! Cavale voir ton vieux !... Il est là-bas sur la route,
après le passage de la Druve... à la remontée de
Saligons !... Tu sais la petite passerelle en bois ?...
C'est là qu'il s'est tué !... Les gens des " Plaquets "
ils l'ont entendu... Le fils Arton et la mère Jeanne...
Il était juste après six heures... Avec son fusil... le
gros... Ils m'ont dit de vous dire... Que tu l'enlèves
si tu veux... Moi j'ai rien vu... t'as compris ?... Eux
ils savent rien non plus... Ils ont entendu que le
pétard... Et puis tiens voilà deux lettres... Elles sont
toutes les deux pour lui...
Il a même pas fait un " au-revoir "... Il est reparti le long du mur...
Il avait pas pris son vélo, il a coupé à travers
champs... Je l'ai vu rejoindre la route en haut, celle
de Brion, par la forêt.
(...) Après une
grande traite en plat... à travers les molles cultures
c'était une raide escalade à flanc de colline... Arrivés
là, tout là-haut, on
 découvrait
bien par exemple !... pour ainsi dire tout le paysage
!... On soufflait pire que des bœufs avec la patronne...
On s'est assis une seconde, au revers du remblai pour
mieux dominer... Elle avait pas très bonne vue la pauvre
baveuse... Mais moi je biglais de façon perçante... On
me cachait absolument rien à vingt kilomètres
d'oiseau... De là, du sommet, après la descente et la
Druve qui coulait en bas... le petit pont et puis le
petit crochet de la route... Là j'ai discerné alors en
plein... au beau milieu de la chaussée, une espèce de
gros paquet... Y avait pas d'erreur !... A peut-être
trois kilomètres ça ressortait sur le gravier... Ah ! Et
puis à l'instant même... Au coup d'œil... j'ai su qui
c'était... A la redingote !... au gris... et puis au
jaune rouille du grimpant... On s'est dépêché
dare-dare... On a dévalé la côte... " Marchez toujours !
marchez toujours ! que j'ai dit... Suivez ! vous ! tout
droit !... Moi je pique par là... par le sentier !... "
Ça me coupait énormément ... J'étais en bas à la
minute... Juste sur le tas... Juste devant... découvrait
bien par exemple !... pour ainsi dire tout le paysage
!... On soufflait pire que des bœufs avec la patronne...
On s'est assis une seconde, au revers du remblai pour
mieux dominer... Elle avait pas très bonne vue la pauvre
baveuse... Mais moi je biglais de façon perçante... On
me cachait absolument rien à vingt kilomètres
d'oiseau... De là, du sommet, après la descente et la
Druve qui coulait en bas... le petit pont et puis le
petit crochet de la route... Là j'ai discerné alors en
plein... au beau milieu de la chaussée, une espèce de
gros paquet... Y avait pas d'erreur !... A peut-être
trois kilomètres ça ressortait sur le gravier... Ah ! Et
puis à l'instant même... Au coup d'œil... j'ai su qui
c'était... A la redingote !... au gris... et puis au
jaune rouille du grimpant... On s'est dépêché
dare-dare... On a dévalé la côte... " Marchez toujours !
marchez toujours ! que j'ai dit... Suivez ! vous ! tout
droit !... Moi je pique par là... par le sentier !... "
Ça me coupait énormément ... J'étais en bas à la
minute... Juste sur le tas... Juste devant...
Il était tout
racorni le vieux... ratatiné dans son froc... Et puis
alors c'était bien lui !... Mais la tête était qu'un
massacre !... Il se l'était tout éclatée... Il avait
presque plus de crâne... A bout portant quoi !... Il
agrippait encore le flingue... Il l'étreignait dans ses
bras... Le double canon lui rentrait à travers la
bouche, lui traversait tout le cassis... Ca embrochait
toute la compote... Toute la barbaque en hachis !...
(...) Le vieille elle a bien regardé tout... Elle restait là plantée
devant... Elle a pas fait ouf !... Alors je me suis
décidé... " On va le porter sur le remblai... " que j'ai
dit comme ça... On s'agenouille donc tous les deux... On
ébranle un peu d'abord tout le paquet... On essaye de
décoller... On fait un peu de force... Je tiraille moi
sur la tête... Ça se détache pas du tout !... On a
jamais pu !... C'était adhérent bien de trop... Surtout
des oreilles qu'étaient toutes soudées !... C'était pris
comme un seul bloc avec les graviers et la glace...
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.619).
*********
La mort de sa
concierge.
Tout le chagrin des lettres, depuis vingt ans bientôt,
s’est arrêté chez elle. Il est là dans l’odeur de la
mort récente, l’incroyable aigre goût… Il vient
d’éclore… Il est là… Il rôde… Il nous connaît, nous le
connaissons à présent. Il ne s’en ira plus jamais. Il
faut éteindre le feu dans la loge. A qui vais-je
écrire ? Je n’ai plus personne. Plus un être pour
recueillir doucement l’esprit gentil des morts… pour
parler après ça plus doucement aux choses… Courage pour
soi tout seul !
Sur la fin ma vieille bignolle, elle ne pouvait plus
rien dire. Elle étouffait, elle me retenait par la main…
Le facteur est entré. Il l’a vue mourir. Un petit
hoquet. C’est tout. Bien des gens sont venus chez elle
autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très
loin dans l’oubli, se chercher une âme. Le facteur a ôté
son képi. Je pourrais moi dire toute ma haine. Je sais.
Je le ferai plus tard s’ils ne reviennent pas. J’aime
mieux raconter des histoires. J’en raconterai de telles
qu’ils reviendront, exprès, pour me tuer, des quatre
coins du monde. Alors ce sera fini et je serai bien
content.
(Mort à crédit, Gallimard, 1952, p.12).
*********
La mort de Gwendor
le Magnifique.
Il
restait là Gustin, assoupi sur son escabeau, devant les
échantillons, le placard béant… Il ne pipait plus… il ne
voulait pas m’interrompre…
- Il s’agit, que je l’ai prévenu, de Gwendor le
Magnifique, Prince de Christianie… Nous arrivons… Il
expire… au moment même où je te cause… Son sang
s’échappe par vingt blessures… L’armée de Gwendor vient
de subir une abominable défaite… Le Roi Krogold lui-même
au cours de la mêlée a repéré Gwendor… Il l’a pourfendu…
Il n’est pas fainéant Krogold… Il fait sa justice
lui-même… Gwendor a trahi… La mort arrive sur Gwendor et
va terminer son boulot… Ecoute un peu !
« Le tumulte du combat s’affaiblit avec les dernières
lueurs du jour… Au loin disparaissent les derniers
Gardes du Roi Krogold… Dans l’ombre montent les râles de
l’immense agonie d’une armée… Victorieux et vaincus
rendent leurs âmes comme ils peuvent… Le silence étouffe
tour à tour cris et râles, de plus en plus faibles, de
plus en plus rares…
- As-tu compris Gwendor ?
- J’ai compris, ô Mort ! J’ai compris dès le début de
cette journée… J’ai senti dans mon cœur, dans mon bras
aussi, dans les yeux de mes amis, dans le pas même de
mon cheval, un charme triste et lent qui tenait du
sommeil… Mon étoile s’éteignait entre tes mains
glacées… Tout se mit à fuir ! O Mort ! Grands remords !
Ma honte est immense !... Regarde ces pauvres corps !...
Une éternité de silence ne peut l’adoucir !...
- Il n’est point de douceur en ce monde Gwendor ! rien
que de légende ! Tous les royaumes finissent dans un
rêve !...
- O Mort ! Rends-moi un peu de temps… un jour ou deux !
Je veux savoir qui m’a trahi…
- Tout trahit Gwendor… Les passions n’appartiennent à
personne, l’amour, surtout, n’est que fleur de vie dans
le jardin de la jeunesse.
Et la mort tout doucement saisit le prince… Il ne se
défend plus… Son poids s’est échappé… Et puis un beau
rêve reprend son âme… Le rêve qu’il faisait souvent
quand il était petit dans son berceau de fourrure, dans
la chambre des Héritiers, près de sa nourrice la morave,
dans le château du Roi René… »
Gustin il avait les mains qui lui pendaient entre les
genoux…
- C’est pas beau ? que je l’interroge.
(Mort à crédit, Gallimard, 1952, p.23).
*********
La mort de Bébert.
Elle a duré des semaines la
maladie de Bébert. J'y allais deux fois par jour pour le
voir. Les gens du quartier m'attendaient devant la loge,
sans en avoir l'air et sur le pas de leurs maisons, les
voisins aussi. C'était comme une distraction pour
eux. On venait pour savoir de loin si ça allait plus mal
ou mieux. (...) Des conseils, j'en ai reçu beaucoup à
propos de Bébert. Tout le quartier en vérité,
s'intéressait à son cas. On parlait pour et puis contre
mon intelligence. Quand j'entrais dans la loge, il
s'établissait un silence critique et assez hostile,
écrasant de sottise surtout. Elle était toujours remplie
par des commères amies la loge, les intimes, et elle
sentait donc fort le jupon et l'urine de lapin. Chacun
tenait à son médecin préféré, toujours plus subtil, plus
savant. Je ne présentais qu'un seul avantage moi, en
somme, mais alors celui qui vous est difficilement
pardonné, celui d'être presque gratuit, ça fait tort au
malade et à sa famille un médecin gratuit, si pauvre
soit-elle.
Bébert ne délirait pas encore, il n'avait seulement plus du tout envie de
bouger. Il se mit à perdre du poids chaque jour. Un peu
de chair jaunie et mobile lui tenait encore au corps en
tremblotant de haut en bas à chaque fois que son cœur
battait. On aurait dit qu'il était partout son cœur
sous sa peau tellement qu'il était devenu mince Bébert
en plus d'un mois de maladie. Il m'adressait des
sourires raisonnables quand je venais le voir. Il
dépassa ainsi très aimablement les 39 et puis les 40 et
demeura là pendant des jours et puis des semaines,
pensif.
Il fallait pressentir que cette maladie tournerait mal. Une espèce de
typhoïde maligne c'était, contre laquelle tout ce que je
tentais venait buter, les bains, le sérum... le
régime sec... les vaccins... Rien n'y faisait. J'avais
beau me démener, tout était vain. Bébert passait,
irrésistiblement emmené, souriant. Il se tenait tout en
haut de sa fièvre comme en équilibre, moi en bas à
cafouiller. Bien entendu, on conseilla un peu partout et
impérieusement encore à la tante de me liquider sans
ambages et de faire appeler en vitesse un autre médecin,
plus expérimenté, plus sérieux. emmené, souriant. Il se tenait tout en
haut de sa fièvre comme en équilibre, moi en bas à
cafouiller. Bien entendu, on conseilla un peu partout et
impérieusement encore à la tante de me liquider sans
ambages et de faire appeler en vitesse un autre médecin,
plus expérimenté, plus sérieux.
(...) Passant devant la maison le soir j'entrais pour
voir si tout ça n'était pas fini des fois. " Vous croyez
pas que c'est avec la camomille au rhum qu'il a voulu
boire chez la fruitière le jour de la course cycliste
qu'il l'a attrapée sa maladie ? " qu'elle supposait tout
haut la tante. Cette idée la tracassait depuis le début.
Idiote. " Camomille ! " murmurait faiblement Bébert, en
écho perdu dans la fièvre. A quoi bon la dissuader ?
(...) Vers le dix-septième jour je me suis dit tout de
même que je ferais bien d'aller demander ce qu'ils en
pensaient à l'Institut Bioduret Joseph, d'un cas de
typhoïde de ce genre, et leur demander en même temps un
petit conseil et peut-être même un vaccin qu'ils me
recommanderaient. Ainsi, j'aurais tout fait, tout tenté,
même les bizarreries et s'il mourrait Bébert, eh bien,
on n'aurait peut-être rien à me reprocher.
(...) Pendant mon stage dans les écoles pratiques de la Faculté, Parapine
m'avait donné quelques leçons de microscope et témoigné
en diverses occasions de quelque réelle bienveillance.
J'espérais qu'il ne m'avait depuis ces temps déjà
lointains tout à fait oublié et qu'il serait à même de
me donner peut-être un avis thérapeutique de tout
premier ordre pour le cas de Bébert qui m'obsédait en
vérité.
Décidément, je me découvrais beaucoup plus de goût à empêcher Bébert de
mourir qu'un adulte. On n'est jamais très mécontent
qu'un adulte s'en aille, ça fait toujours une vache de
moins sur la terre, qu'on se dit, tandis que pour un
enfant, c'est tout de même moins sûr. Il y a l'avenir.
(...) Tout de même, j'aurais bien voulu être ailleurs et
loin. J'aurais aussi voulu avoir des chaussons pour
qu'on m'entende pas du tout rentrer chez moi. J'y étais
cependant pour rien, moi, si Bébert n'allait pas mieux
du tout. J'avais fait mon possible. Rien à me reprocher.
C'était pas de ma faute si on ne pouvait rien dans des
cas comme ceux-là. Je suis parvenu jusque devant sa
porte, et je le croyais, sans avoir été remarqué. Et
puis, une fois monté, sans ouvrir les persiennes j'ai
regardé par les fentes pour voir s'il y avait toujours
des gens à parler devant chez Bébert. Il en sortait
encore quelques-uns des visiteurs de la maison, mais ils
n'avaient pas le même air qu'hier les visiteurs. Une
femme de ménage des environs, que je connaissais bien,
pleurnichait en sortant.
" On dirait décidément que ça va encore plus mal, que je me disais. En
tout cas, ça va sûrement pas mieux... Peut-être qu'il
est déjà passé ? que je me disais. Puisqu'il y en a une
qui pleure déjà !... " La journée était finie.
Je cherchais quand même si j'y étais pour rien dans tout ça. C'était
froid et silencieux chez moi. Comme une petite nuit dans
un coin de la grande, exprès pour moi tout seul. De
temps en temps montaient des bruits de pas et l'écho
entrait de plus en plus fort dans ma chambre,
bourdonnait, s'estompait... Silence. Je regardais encore
s'il se passait quelque chose dehors, en face. Rien
qu'en moi que ça se passait, à me poser toujours la même
question.
J'ai fini par m'endormir sur la question, dans ma nuit à moi, ce
cercueil, tellement j'étais fatigué de marcher et de ne
trouver rien.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956, p. 277).
*********
La mort
d'Henrouille.
Il était couché justement dans le même lit où j'avais
soigné Robinson après son accident, quelques mois
auparavant. En quelques mois ça change une chambre, même
quand on n'y bouge rien. (...) La femme nous laissa
seuls avec le mari. Il n'était pas brillant le mari. Il
n'avait plus beaucoup de circulation. C'est au cœur
que ça le tenait.
- Je vais mourir, qu'il répétait, bien simplement, d'ailleurs. J'avais
pour me trouver dans des cas de ce genre une espèce de
veine de chacal. Je l'écoutais battre son cœur,
question de faire quelque chose dans la circonstance,
les quelques gestes qu'on attendait. Il courait son cœur,
on pouvait le dire, derrière ses côtes, enfermé, il
courait après la vie, par saccades, mais il avait beau
bondir, il ne la rattraperait pas la vie. C'était cuit.
Bientôt à force de trébucher, il chuterait dans la
pourriture, son cœur,
tout juteux, en rouge et bavant telle une vieille
grenade écrasée. C' est ainsi qu'on le verrait son cœur
flasque, sur le marbre, crevé au couteau après
l'autopsie, dans quelques jours.
(...) On l'attendait au détour, dans le quartier sa femme avec tous les
cancans accumulés de l'affaire précédente qui restaient
sur le carreau. Ça
serait pour un peu plus tard. Pour l'instant, le mari
il ne savait
pas comment se tenir, ni mourir. Il en était déjà comme
un peu sorti de la vie, mais il n'arrivait pas tout de
même à se défaire de ses poumons. Il chassait l'air,
l'air revenait. Il aurait bien voulu se laisser aller,
mais il fallait qu'il vive quand même jusqu'au bout.
C'était un boulot bien atroce, dont il louchait.
- Je sens plus mes pieds, qu'il geignait... J'ai froid jusqu'aux genoux...
Il voulait se les toucher les pieds, il pouvait plus.
Pour boire, il n'arrivait pas non plus. C'était presque fini. En lui
passant la tisane préparée par sa femme, je me demandais
ce qu'elle pouvait y avoir mis dedans. Elle ne sentait
pas très bon la tisane, mais l'odeur n'est pas une
preuve, la valériane sent très mauvais par elle-même. Et
puis à étouffer comme il étouffait le mari, ça n'avait
plus beaucoup d'importance qu'elle soye bizarre la
tisane. Il se donnait pourtant bien de la peine, il
travaillait énormément, avec tout ce qui lui restait de
muscles sous la peau, pour arriver à souffrir et
souffler davantage. Il se débattait autant contre la vie
que contre la mort.
Ça
serait juste d'éclater dans ces cas-là.
Quand la nature se met à s'en foutre on dirait qu'il n'y
a plus de limites.
Derrière la porte,
sa femme écoutait la consultation que je lui donnais,
mais je la connaissais bien moi, sa femme. En douce,
j'ai été la surprendre.
" Cuic ! Cuic ! " que je lui ai fait. Ça l'a pas vexée du tout et elle est
même venue alors me parler à l'oreille :
- Faudrait, qu'elle me murmure, que vous lui fassiez enlever son
râtelier... Il doit le gêner pour respirer son
râtelier... - Moi je voulais bien qu'il l'enlève en
effet son râtelier.
- Mais dites-le lui donc vous-même ! que je lui ai conseillé. C'était
délicat comme commission à faire dans son état.
- Non ! non ! ça serait mieux de votre part ! qu'elle insiste. De moi, ça
lui ferait quelque chose que je sache...
- Ah ! que je m'étonne, pourquoi ?
- Y a trente ans qu'il en porte un et jamais il m'en a parlé...
- On peut peut-être le lui laisser alors ? que je propose. Puisqu'il a
l'habitude de respirer avec...
- Oh ! non, je me le reprocherais ! qu'elle m'a répondu avec comme une
certaine émotion dans la voix...
Je retourne en douce alors dans la chambre. Il m'entend revenir près de
lui le mari. Ça lui fait plaisir que je revienne. Entre
les suffocations il me parlait encore, il essayait même
d'être un peu aimable avec moi. Il me demandait de mes
nouvelles, si j'avais trouvé une autre clientèle... "
Oui, oui " que je lui répondais à toutes ces questions.
Ça aurait été bien trop long et trop compliqué pour lui
expliquer les détails. C'était pas le moment.
Dissimulée par
le battant de la porte, sa femme me faisait des signes
pour que je lui redemande encore d'enlever son râtelier.
Alors je m'approchai de son oreille au mari et je lui
conseillai à voix basse de l'enlever. Gaffe ! " Je l'ai
jeté aux cabinets !... " qu'il fait alors avec des yeux
plus effrayés encore. Une coquetterie en somme. Et il
râle un bon coup après ça.
On est artiste avec ce que l'on trouve. Lui c'était à propos de son
râtelier qu'il s'était donné du mal esthétique pendant
toute sa vie. Le moment des confessions. J'aurai voulu
qu'il en profite pour me donner son avis sur ce qui
était arrivé à propos de sa mère. Mais il pouvait plus.
Il battait la campagne. Il s'est mis à baver énormément.
La fin. Plus moyen d'en sortir une phrase. Je lui
essuyai la bouche et je redescendis. Sa femme dans le
couloir en bas n'était pas contente du tout et elle m'a
presque engueulé à cause du râtelier, comme si c'était
ma faute.
- En or ! qu'il était Docteur... Je le sais ! Je sais combien il l'a payé
!... On n'en fait plus des comme ça !... Toute une
histoire. " Je veux bien remonter essayer encore " que
je lui propose tellement j'étais gêné. Mais alors
seulement avec elle !
Cette fois-là, il ne nous reconnaissait presque plus le mari. Un petit
peu seulement. Il râlait moins fort quand on était près
de lui, comme s'il avait voulu entendre tout ce qu'on
disait ensemble, sa femme et moi.
Je ne suis pas venu à l'enterrement. Y a pas eu d'autopsie comme je
l'avais redouté un peu. Ça s'est passé en douce. Mais
n'empêche qu'on s'était fâchés pour de bon tous les
deux, avec la veuve Henrouille, à propos du râtelier.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956, p. 371).
*********
La mort de Robinson.
Et
puis elle a essayé le grand jeu : " Tu viens ? qu'elle
lui a fait. Tu viens Léon ? Un ?... Tu viens-t-y ? Deux
?... " Elle a attendu. " Trois ?... Tu viens pas alors
?... " " Non ! " qu'il lui a répondu, sans bouger d'un
pouce. " Fais comme tu veux ! " qu'il a même ajouté.
C'était une réponse.
Elle a dû se reculer un peu sur la banquette, tout au fond. Elle devait
tenir le révolver à deux mains parce que quand le feu
lui est parti c'était comme tout droit de son ventre et
puis presque ensemble encore deux coups, deux fois de
suite... De la fumée poivrée alors qu'on a eue plein le
taxi.
On roulait encore quand même. C'est sur moi qu'il est retombé Robinson,
sur le côté, par saccades, en bafouillant. " Hop ! et
Hop ! " Il arrêtait pas de gémir " Hop ! et Hop ! " Le
chauffeur avait sûrement entendu.
(...) Dans le ventre qu'il avait reçu les deux balles Robinson, peut-être
les trois, je ne savais pas encore au juste combien.
Elle avait tiré droit devant elle ça je l'avais vu.
Ça ne saignait pas, les
blessures. Entre Sophie et moi malgré qu'on le retienne,
il cahotait tout de même beaucoup, sa tête baladait. Il
parlait, mais c'était difficile de le comprendre.
C'était déjà du délire. " Hop ! et Hop ! " qu'il
continuait de chantonner. Il aurait eu le temps de
mourir avant qu'on arrive. devant elle ça je l'avais vu.
Ça ne saignait pas, les
blessures. Entre Sophie et moi malgré qu'on le retienne,
il cahotait tout de même beaucoup, sa tête baladait. Il
parlait, mais c'était difficile de le comprendre.
C'était déjà du délire. " Hop ! et Hop ! " qu'il
continuait de chantonner. Il aurait eu le temps de
mourir avant qu'on arrive.
La rue était nouvellement pavée. Dès que nous fûmes devant notre grille,
j'ai envoyé la concierge chercher Parapine dans sa
chambre, en vitesse. Il est descendu tout de suite et
c'est avec lui et un infirmier que nous avons pu monter
Léon jusque dans son lit. Une fois déshabillé on a pu
l'examiner et tâter la paroi du ventre. Elle était déjà
bien tendue la paroi sous les doigts, à la palpation et
même mat par endroits. Deux trous l'un au-dessus de
l'autre que j'ai retrouvés, pas de troisième, l'une des
balles avait dû se perdre.
Si j'avais été à la place à Léon, j'aurais préféré pour moi une
hémorragie interne, ça vous inonde le ventre, c'est
rapidement fait. On se remplit le péritoine et on n'en
parle plus. Tandis que pour une péritonite, c'est de
l'infection en perspective, c'est long.
(...)
Il a repris un peu de ses sens quand Parapine lui a eu
fait sa piqure de morphine. Il nous a même raconté des
choses alors à propos de ce qui venait d'arriver. "
C'est mieux que ça se finisse comme ça... " qu'il a dit,
et puis : " Ça fait pas si
mal que j'aurais cru... "
(...) C'est comme s'il essayait de nous aider à vivre à présent nous
autres. Comme s'il nous avait cherché à nous des
plaisirs pour rester. Il nous tenait par la main. Chacun
une. Je l'embrassai. Il n'y a plus que ça qu'on puisse
faire sans se tromper dans ces cas-là. On a attendu. Il
a plus rien dit. Un peu plus tard, une heure peut-être,
pas davantage, c'est l'hémorragie qui s'est décidée,
mais alors abondante, interne, massive. Elle l'a emmené.
Son cœur s'est mis à battre
de plus en plus vite et puis tout à fait vite. Il
courait son cœur après son
sang, épuisé, là-bas, minuscule déjà, tout à la fin des
artères, à trembler au bout des doigts. La pâleur lui
est montée du cou et lui a pris toute la figure. Il a
fini en étouffant. Il est parti d'un coup comme s'il
avait pris son élan, en se resserrant sur nous deux, des
deux bras.
Et puis il est revenu là, devant nous, presque tout de suite, crispé,
déjà en train de prendre tout son poids de mort. On
s'est levé nous, on s'est dégagé de ses mains. Elles
sont restées en l'air ses mains, bien raides, dressées
toutes jaunes et bleues sous la lampe.
Dans la chambre ça faisait comme un étranger à présent Robinson, qui
viendrait d'un pays atroce et qu'on n'oserait plus lui
parler.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956, p. 489).
*********
Celle de
Metitpois.
A
la manière qu'il a, Gustin, de retourner les mains quand
il pionce c'est facile de lui voir l'avenir. Y a le poil
et tout l'homme dans les poignes. Chez Gustin c'est sa
ligne de vie qu'est plutôt en force. Chez moi, ça serait
plutôt la chance et la destinée. Je suis pas fadé
question longueur d'existence... Je me demande pour
quand ça sera ? J'ai un sillon au bas du pouce...
Ça
sera-t-il une artériole qui pétera dans l'encéphale ? Au
détour de la Rolandique ?... Dans le petit repli de la "
troisième " ?... On l'a souvent regardé avec Metitpois à
la Morgue cet endroit-là...
Ça
fait minuscule un ictus... Un petit cratère comme une
épingle dans le gris des sillons... L'âme y a passé, le
phénol et tout. Ça
sera peut-être hélas un néo-fongueux du rectum... Je
donnerais beaucoup pour l'artériole... A la bonne vôtre
!... Avec Metitpois, un vrai maître, on y a passé bien
des dimanches à fouiller comme ça les sillons... pour
les manières qu'on a de mourir...
Ça
le passionnait ce vieux daron... Il voulait se faire une
idée. Il faisait tous les vœux
personnels pour une inondation pépère des deux
ventricules à la fois quand sa cloche sonnerait... Il
était chargé d'honneurs !... " Les morts les plus
exquises, retenez bien ceci Ferdinand, ce sont celles
qui nous saisissent dans les tissus les plus
sensibles... "
Il
parlait précieux, fignolé, subtil, Metitpois, comme les
hommes des années Charcot.
Ça
lui a pas beaucoup servi de prospecter la Rolandique, la
" troisième " et le noyau gris... Il est mort du cœur
finalement, dans des conditions pas pépères... d'un
grand coup d'angine de poitrine, d'une crise qu'à duré
vingt minutes. Il a bien tenu cent vingt secondes avec
tous ses souvenirs classiques, ses résolutions,
l'exemple à César... mais pendant dix-huit minutes il a
gueulé comme un putois... Qu'on lui arrachait le
diaphragme, toutes les tripes vivantes... Qu'on lui
passait dix mille lames ouvertes dans l'aorte... Il
essayait de nous les vomir... C'était pas du charre. Il
rampait pour ça dans le salon... Il se défonçait la
poitrine... Il rugissait dans son tapis... Malgré la
morphine. Ça
résonnait dans les étages jusque devant sa maison... Il
a fini sous le piano. Les artérioles du myocarde quand
elles éclatent une par une, c'est une harpe pas
ordinaire... C'est malheureux qu'on revienne jamais de
l'angine de poitrine. Y aurait de la sagesse et du génie
pour tout le monde.
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.26).
*********
Des
pigeons.
(...)
Mais nos pauvres pigeons voyageurs, à partir de ce
moment-là, ils avaient plus bien raison d'être... On les
nourrissait pas beaucoup depuis déjà plusieurs mois...
parfois seulement tous les deux jours... et ça revenait
quand même très cher !... Les graines, c'est toujours
fort coûteux, même achetées en gros... Si on les avait
revendus... sûrement qu'ils auraient rappliqué comme je
les connaissais... Jamais ils se seraient accoutumés à
des autres patrons... C'était des braves petites bêtes
loyales et fidèles... Absolument familiales... Ils
m'attendaient dans la soupente... Dès qu'ils
m'entendaient remuer l'échelle... ils roucoulaient
double !... Courtial il nous parlait déjà de se les
taper à la " cocotte "... Mais je ne voulais pas les
donner à n'importe qui... Tant qu'à faire de les occire,
j'aimais mieux m'en charger moi-même !...
J'ai réfléchi
à un moyen... J'ai pensé comme si c'était moi... Moi
j'aimerais pas au couteau... non !... j'aimerais pas à
être étranglé... non... ! J'aimerais pas être
écartelé... détripé... fendu en quatre !...
Ça
me faisait quand même un peu de peine !... Je les
connaissais extrêmement bien... Mais y avait plus à
démordre... Il fallait se résoudre à quelque chose...
J'avais plus de graines depuis quatre jours... Je suis
donc monté un tantôt comme ça vers quatre heures. Ils
croyaient que je ramenais de la croûte... Ils avaient
parfaitement confiance... Ils gargouillaient à toute
musique... Je leur fais : " Allez ! radinez-vous, les
glouglous ! C'est la foire qui continue. Pour la balade,
en voiture !... " Ils connaissaient ça fort bien...
J'ouvre tout grand leur beau panier, le rotin des
ascensions... Ils se précipitent tous ensemble... Je
ferme bien la tringle... Je passe encore des cordes dans
les anses... Je ligote en large, en travers... Ainsi
c'était prêt... Je laisse le truc d'abord dans le
couloir. Je redescends un peu... Je dis rien à Courtial...
J'attends qu'il s'en aille prendre son dur... J'attends
encore après le dîner... La Violette me tape au
carreau... Je lui réponds : " Reviens donc plus tard...
gironde... Je pars en course dans un moment !... " Elle
reste... elle rouscaille...
- Je veux te dire quelque chose, Ferdinand ! qu'elle insiste comme ça...
- Barre ! que je lui fais...
Alors je monte chercher mes bestioles... Je les
redescends de la soupente. Je me mets le panier sur la
tête... et je m'en vais en équilibre... Je sors par la
rue Montpensier... Je traverse tout le Carroussel...
Arrivé au quai Voltaire, je repère bien l'endroit... Je
vois personne du tout... Sur la berge, en bas des
marches... J'attrape un pavé, un gros... Je l'amarre à
mon truc... Je regarde bien encore autour... J'agrafe
tout le fourbi à deux poignes et je le balance en plein
jus... Le plus loin que je peux...
Ça
a pas fait beaucoup de bruit... J'ai fait ça
automatique...
Le lendemain matin, Courtial, je lui ai cassé net le morceau... J'ai pas
attendu... J'ai pas pris trente-six tournures... Il a
rien eu à répondre... Elle non plus d'ailleurs, la
chérie, qu'était aussi dans le magasin... Ils ont bien
vu à mon air que c'était pas du tout le moment de venir
me faire chier la bite.
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.490).
*********
De
sa grand'mère Caroline.
En
arrivant au guichet, elle a eu un étourdissement
Grand'mère Caroline, elle s'est raccrochée à la rampe...
C'était pas dans ses habitudes... Elle a ressenti plein
de frissons... On a retraversé la place, on est entré
dans un café... En attendant l'heure du train, on a bu
un grog à nous deux... En arrivant à Saint-Lazare, elle
est allée se coucher tout de suite, directement... Elle
en pouvait plus... La fièvre l'a saisie, une très forte,
comme moi j'avais eu au Passage, mais elle alors c'était
la grippe et puis ensuite la pneumonie... Le médecin
venait matin et soir... Elle est devenue si malade qu'au
Passage, nous autres, on ne savait plus quoi répondre
aux voisins qui nous demandaient.
L'oncle Edouard faisait la navette entre la boutique et chez elle...
L'état s'est encore aggravé... Elle voulait plus du
thermomètre, elle voulait même plus qu'on sache combien
ça faisait... Elle a gardé tout son esprit. Tom, il se
cachait sous les meubles, il bougeait plus, il mangeait
à peine... Mon oncle est passé à la boutique, il
remportait de l'oxygène dans un grand ballon.
Un soir, ma mère est même pas revenue pour dîner... Le lendemain, il
faisait nuit encore quand l'oncle Edouard m'a secoué au
plume pour que je me rhabille en vitesse. Il m'a
prévenu... C'était pour embrasser Grand'mère... Je
comprenais pas encore très bien... J'étais pas très
réveillé... On a marché vite... C'est rue du Rocher
qu'on allait... à l'entresol... La concierge s'était pas
couchée... Elle arrivait avec une lampe exprès pour
montrer le couloir... En haut, dans la première pièce, y
avait maman à genoux, en pleurs contre une chaise. Elle
gémissait tout doucement, elle marmonnait de la
douleur... Papa, il était resté debout... Il disait plus
rien... Il allait jusqu'au palier, il revenait encore...
Il regardait sa montre... Il trifouillait sa
moustache... Alors j'ai entrevu Grand'mère dans son lit
dans la pièce plus loin... Elle soufflait dur, elle
raclait, elle suffoquait, elle faisait un raffut
infect... Le médecin juste, il est sorti... Il a serré
la main de tout le monde... Alors moi, on m'a fait
entrer... Sur le lit, j'ai bien vu comme elle luttait
pour respirer. Toute jaune et rouge qu'était maintenant
sa figure avec beaucoup de sueur dessus, comme un masque
qui serait en train de fondre...
Elle m'a
regardé bien fixement, mais encore aimablement
Grand'mère... On m'avait dit de l'embrasser... Je
m'appuyais déjà sur le lit. Elle m'a fait un geste que
non... Elle a souri encore un peu... Elle a voulu me
dire quelque chose...
Ça
lui râpait le fond de la gorge, ça finissait pas... Tout
de même elle y est arrivée... le plus doucement qu'elle
a pu... " Travaille bien mon petit Ferdinand ! " qu'elle
a chuchoté... J'avais pas peur d'elle... On se
comprenait au fond des choses... Après tout c'est vrai
en somme, j'ai bien travaillé...
Ça
regarde personne...
A ma mère, elle voulait aussi dire quelque chose. " Clémence ma petite
fille... fais bien attention... te néglige pas... je
t'en prie... " qu'elle a pu prononcer encore... Elle
étouffait complètement... Elle a fait signe qu'on
s'éloigne... Qu'on parte dans la pièce à côté... On a
obéi... On l'entendait...
Ça
remplissait l'appartement... On est restés une heure au
moins comme ça contractés... L'oncle il retournait à la
porte... Il aurait bien voulu la voir. Il osait pas
désobéir. Il poussait seulement le battant, on
l'entendait davantage... Il est venu une sorte de
hoquet... Ma mère s'est redressée d'un coup... Elle a
fait un ouq ! Comme si on lui coupait la gorge. Elle est
retombée comme une masse, en arrière sur le tapis entre
le fauteuil et mon oncle... La main si crispée sur sa
bouche, qu'on ne pouvait plus la lui ôter...
Quand elle est revenue à elle : " Maman est morte !... " qu'elle arrêtait
pas de hurler... Elle savait plus où elle se trouvait...
Mon oncle est resté pour veiller... On est repartis,
nous, au Passage, dans un fiacre...
On a
fermé notre boutique. On a déroulé tous les stores... On
avait comme une sorte de honte... Comme si on était des
coupables... On osait plus du tout remuer, pour mieux
garder notre chagrin... On pleurait avec maman, à même
sur la table... On n'avait pas faim... Plus envie de
rien... On tenait déjà pas beaucoup de place et pourtant
on aurait voulu pouvoir nous rapetisser toujours...
Demander pardon à quelqu'un, à tout le monde... On se
pardonnait les uns aux autres... On suppliait qu'on
s'aimait bien... On avait peur de se perdre encore...
pour toujours... comme Caroline...
Et l'enterrement est arrivé... L'oncle Edouard, tout seul, s'était appuyé
toutes les courses. Il avait fait toutes les
démarches... Il en avait aussi de la peine... Il la
montrait pas... Il était pas démonstratif... Il est venu
nous prendre au Passage, juste au moment de la levée du
corps...
Tout le monde... les voisins... des curieux... sont venus pour nous dire
: " Bon courage ! " On s'est arrêtés rue Deaudeville
pour chercher nos fleurs... On a pris ce qu'il y avait
de mieux... Rien que des roses... C'étaient ses fleurs
préférées...
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.109).
*********
La mort
de Nora Merrywin.
Je
me trouve étreint dans l'élan !... congestionné, raplati
sous les caresses... Je suis trituré, je n'existe
plus... C'est elle, toute la masse qui me fond sur la
pêche... ça glue... J'ai la bouille coincée,
j'étrangle... Je proteste... j'implore... J'ai peur de
gueuler trop fort... Le vieux peut entendre !... (...)
C'est une avalanche de tendresses... Je m'écroule sous
les baisers fous, les liches, les saccades... J'ai la
figure en compote... (...) J'ai les mains qui enflent
tellement je lui cramponne les fesses ! Je veux
l'amarrer ! qu'elle bouge plus ! C'est fait ! Voilà !
Elle parle plus alors ! Putain de Dieu ! J'enfonce ! Je
rentre dedans comme un souffle ! Je me pétrifie d'amour
!... Je ne fais plus qu'un dans sa beauté !... Je suis
transi, je gigote... Je croque en plein dans son nichon
! Elle grogne... elle gémit... Je suce tout... Je lui
cherche dans la figure l'endroit précis près du blaze,
celui qui m'agace, de sa magie du sourire... Je vais lui
mordre là aussi... surtout... Une main, je lui passe
dans l'oignon, je la laboure exprès... j'enfonce... je
m'écrabouille dans la lumière et la bidoche... Je jouis
comme une bourrique... Je suis en plein dans la sauce...
Elle me fait une embardée farouche... Elle se dégrafe de
mes étreintes, elle s'est tirée la salingue !... elle a
rebondi pile en arrière... Ah merde ! Elle est déjà
debout !... Elle est au milieu de la pièce !... Elle me
fait un discours !... Je la vois dans le blanc du
réverbère !... en chemise de nuit... toute redressée
!... ses cheveux qui flottent... Je reste là, moi, en
berloque avec mon panais tendu...
Je lui fais : " Reviens donc !... " J'essaye comme ça de l'amadouer. Elle
semble furieuse d'un seul coup ! Elle crie, elle se
démène... Elle recule
 encore
vers la porte... Elle me fait des phrases, la charogne
!... " Good-bye, Ferdinand ! qu'elle gueule, Good-bye !
Live well, Ferdinand ! Live well !... " C'est pas des
raisons... encore
vers la porte... Elle me fait des phrases, la charogne
!... " Good-bye, Ferdinand ! qu'elle gueule, Good-bye !
Live well, Ferdinand ! Live well !... " C'est pas des
raisons...
J'entends la porte en bas qui s'ouvre et qui reflanque
brutalement... ! Je me précipite ! Je soulève la
guillotine... J'ai juste le temps de l'apercevoir
qui dévale au
bord de l'impasse... sous les becs de gaz... Je vois ses
mouvements, sa liquette qui frétille au vent... Elle
débouline les escaliers... La folle ! Où qu'elle trisse
? (...) " Elle va se foutre à présent au jus !... " Je
regarde par la lourde du couloir... si je l'aperçois pas
sur les quais... Elle doit être parvenue en bas...
Encore un coup ! encore des cris !... et puis des "
Ferdinand " !... des autres... des clameurs qui
traversent le ciel !...
(...) Une fois dehors, dans l'impasse, je me penche au-dessus des
rocailles, j'essaye de revoir jusqu'au pont, dessous les
lumières...Où ça qu'elle peut bagotter ? En effet ! je
l'aperçois bien... c'est une tache...
Ça
vacille à travers les ombres... Une blanche qui
virevolte... C'est la môme sûrement, c'est ma folle !
Voltige d'un réverbère à l'autre...Ça
fait papillon la charogne !... Elle hurle encore par-ci
par-là, le vent rapporte les échos... Et puis un instant
c'est un cri inouï, alors un autre, un atroce qui monte
dans toute la vallée... " Magne enfant ! que je rambine
le gniard ! Elle a sauté notre Lisette ! Jamais qu'on y
sera ! C'est nous les bons pour la mouillette ! Ta vas
voir Toto ! Tu vas voir ! "
Je
m'élance, je déferle à travers les marches, les
espaces... Flac ! Comme ça ! D'un coup pile !... En
plein au milieu de l'escalier ! Mon sang fait qu'un tour
!... La réflexion qui me saisit. Je bloque ! Je
trembloche ! Ça
va ! Ça
suffit ! J'avance plus d'un pas !... Des clous ! Je me
ravise ! Je gafe !... Je me repenche un coup sur la
rampe ! J'aperçois... C'est plus très bas l'endroit du
quai d'où ça venait...
Ça
grouille à présent tout autour !... Le monde rapplique
de partout !...
(...) Le petit carré blanc dans les vagues... il est emporté toujours
plus... Je la vois, moi, encore, d'où je suis, très bien
dans le milieu des eaux... elle passe au large des
pontons... J'entends même comme elle suffoque...
J'entends bien son gargouillis... J'entends encore les
sirènes... Je l'entends trinquer à travers... Elle est
prise par la marée... Elle est emmenée dans les
remous...Ce petit bout de blanc dépasse le môle ! O ma
tante ! O merde afur ! Elle a sûrement tout trinqué !...
Accélère que je rambine le fiotte ! que je lui bourre le
train au mignard ! Faut pas qu'on nous retrouve dehors
!... Qu'on soye planqués quand ils reviennent... Ah dis
donc !
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.315).
*********
Ce 1er
juillet 1961...
Chaleur
d’été. Paris en stagnation : presque une nécropole où ne
viennent que les étrangers. Des boulangeries fermées
d’où l’odeur du pain s’est envolée et des canalisations
éventrées par les travaux. Tous les habitants sont
partis pour célébrer l’exode annuel à la campagne ou à
la mer. La route des Gardes se déploie au soleil, plonge
dans la brume, serpente depuis Versailles jusqu’au
lointain palais du Louvre. Ancienne route des rois de
France. Flanquée à présent de modestes pavillons, avec
les usines Renault en bas. Seuls les pavés d’autrefois
demeurent et aussi la splendeur continue de la vallée de
la Seine. La route se traîne le long de clôtures de
maçonnerie et de villas en mauvais état, puis s’élève à
un sentier étroit, presque dissimulé à la vue.
Une rude
montée conduit à trois maisons identiques. Style
Louis-Philippe, séparées par des jardins et de vieux
arbres. Elles dominent le paysage au-dessous d’elles.
Rappel de la noblesse d’antan. La dernière (« Villa
Maïtou ») est fermée par de hautes portes jaunes.
Elle est haute et crépie sur un soubassement de pierre.
Une allée pavée de dalles de ciment rose contourne le
gazon par la droite. Ce qui frappe le plus, en montant
cette allée, c’est le contraste entre le style du
pavillon Louis-Philippe et les peintures bleu piscine
des barrières. C’est là que vivent depuis dix ans
Louis-Ferdinand Destouches et son épouse Lucette.
La vue sur Paris et la Seine a emporté
un choix qui par ailleurs déroute. La cuisine est à
l’entresol, Céline travaille et dort au rez-de-chaussée,
Lucette a aménagé les deux étages supérieurs pour la
danse. La vue profite surtout au studio. Le confort est
très relatif, le chauffage central existe mais
l’installation est ancienne et on ne l’allume pas
souvent. On a ajouté des chauffages au gaz.
Nul chauffage
nécessaire en ce 1er juillet 1961 : une vague
de chaleur submerge la France. La veille, il a fait plus
de 32° à Paris et la météo annonce qu’il fera encore
plus chaud aujourd’hui, avec une tendance orageuse
accrue. Ce temps est dû à la présence d’un anticyclone,
solidement ancré sur l’Europe centrale et qui commande
sur l’hexagone un chaud flux du sud.
Le grand soleil de la veille ramène
une aurore presque incandescente. Villa Maïtou, les
chiens, les chats, le perroquet s’ébrouent déjà dans
l’ombre de la maison. Les journaux du matin regorgent
de publicités pour les boissons rafraîchissantes – le ¼
Ricqlès ou le « Tonic Water » de Perrier – et les glaces
Motta à la crème fraîche, « désormais fabriquées en
Normandie ».
À propos de l’Algérie, De Gaulle
confie en privé que « la seule solution raisonnable
reste l’association. » Et d’ajouter : « Si tout
accord avec le GPRA (= Gouvernement provisoire de la
République algérienne) est impossible, nous
regrouperons les Français autour d’Alger et d’Oran. »
Céline a fini par considérer la guerre d’Algérie comme
un événement mineur en comparaison des problèmes
Est-Ouest et surtout de celui posé par la Chine. Dixit
un confrère, le docteur Robert Brami, familier du 25ter
route des Gardes. Dans quelques jours, trois mois après
les accords d’Evian et deux jours après le référendum
d’autodétermination en Algérie, le président de la
République annoncera officiellement la reconnaissance
par la France de l’indépendance de l’Algérie. Si les
attentats au plastic se multiplient à Alger, le pire est
encore à venir… En métropole, la majorité des Français
n’en ont cure. Le grand rush des vacances a commencé en
ce premier week-end de juillet. Les citadins s’en vont,
sous la chaleur, à la recherche du calme, de la
fraîcheur, de l’eau… C’est le Tour de France qui
passionne les foules. La veille, le Belge Planckaert a
fait cavalier seul au Ballon d’Alsace et a gagné,
détaché, à Belfort.
Oui, l’été a surgi, torride. Depuis
quelques jours, Céline se retire sous la pierre de sa
maison, brûlante comme la Casbah. Il ne supporte plus le
soleil, sortant au crépuscule : « Je vais aux
commissions. » Il rapporte la viande des bêtes,
marcheur qui a perdu son ombre. Les gens de Meudon en le
croisant auraient pu dire, comme les habitants de Vérone
au sujet de Dante : « Eccovi l’uom ch’è stato all
Inferno » (Voyez, l’homme qui a été en enfer).
Un autre médecin, André Willemin, lui rend régulièrement
visite : « Il s’est enfermé dans cette villa de Meudon
comme dans un fortin… Sa carcasse ne l’intéresse plus,
lui qui a été un athlète et un cuirassier héroïque de
14. Il l’abandonne aux intempéries… Il ne trouve jamais
plus de deux à trois heures d’un sommeil constamment
interrompu. Après minuit, il erre dans la maison... »
« Quand il s’arrête de travailler, dit
Lucette, il a le sang à la tête, les mains qui
tremblent, les jambes qui flageolent, il me fait peur. »
— « Je te dis que je vais crever ! » ré pète
Céline… pète
Céline…
Chaleur étouffante dès le matin de ce
samedi 1er juillet. Lucette, levée à six
heures, trouve Louis à la cave, à la recherche d’un peu
de fraîcheur, l’air absent. Il accepte de remonter dans
sa chambre et de s’allonger. Il lui dit : « Ferme
tout. Je ne peux pas supporter la lumière ». Cette
photophobie annonce l’hémorragie cérébrale qui va le
foudroyer quelques heures plus tard…
En fin de matinée, Serge Perrault
passe, comme il le fait souvent, mais Céline refuse de
le voir. Il ne veut voir personne. Au tout début de
l’après-midi, Marie-Claude et Rose de France viennent
travailler avec Lucette au premier étage. Vers quinze
heures, Marie-Claude descend dans la chambre de Céline
pour boire une tasse de thé. Il se sent un peu mieux et
plaisante gentiment.
« Ce jour-là, il se plaignit de la
tête plus que d’habitude. Je lui ai appliqué des
compresses. Il s’est allongé, nu, tellement il avait
chaud. Et son bras droit est devenu glacé, ce qui était
étonnant par une journée aussi caniculaire. Le sang n’y
circulait plus. Je pense que l’hémorragie cérébrale du
côté gauche était déjà commencée. Tout de suite, j’ai
deviné que la crise était anormale. J’ai voulu appeler
un médecin mais son médecin traitant n’était pas là.
J’ai pensé à Willemin. Louis m’a dit : “Je te défends
de l’appeler, je ne veux pas, je veux qu’on me laisse
crever tranquille, je ne veux ni piqûre ni médecin, je
ne veux plus rien ” ». Tout devait suivre la nature
jusqu’au
bout.
À la fin de l’après-midi, sa poitrine
se soulève douloureusement pour des inspirations de plus
en plus saccadées et courtes. Il suffoque. Vers dix-huit
heures, sa poitrine se soulève une dernière fois.
Au-dehors, un soleil toujours éclatant, et, dans la
maison, une étrange impression de silence et
d’apaisement. Étrange ? Pourquoi ?... Au bout d’un
moment, on comprend que les animaux se sont tus. Il n’y
a plus un aboiement, les chats sont invisibles, cachés,
il n’y a plus un pépiement d’oiseaux. Toto le perroquet
ne parle plus… Il va rester des mois sans parler…
Quelques jours auparavant, Christian
Dedet, jeune confrère et romancier comme lui, est l’un
des derniers à avoir une vraie conversation avec Céline
:
« Je lui ai rendu visite vingt-quatre
heures avant sa mort. J’ai été frappé parce qu’il
faisait une canicule épouvantable ce jour-là et lui, il
avait plusieurs tricots de laine. En plus de tout ça, il
grelottait, il avait froid. Il s’asseyait, il se levait
parce qu’il tenait en place nulle part, il avait des
douleurs partout, il était très arthrosique, et en plus
il avait des sifflements dans l’oreille, des maux de
tête. J’ai pensé qu’il avait le centre de la régulation
thermique atteint, peut-être par une tumeur du cerveau,
peut-être par l’évolution en sclérose de son
artério-sclérose cérébrale dont officiellement il est
mort mais je me demande s’il n’avait pas une tumeur au
cerveau. »
« La mort, disait Céline à la
fin de sa vie, m’est toujours présente. À chaque
seconde de ma vie, je l’ai vue et je la vois, en moi, en
face de moi. Tout homme qui me parle est à mes yeux un
mort ; un mort en sursis, si vous voulez ; un vivant par
hasard et pour un instant. Quant à ma mort à moi, c’est
ce que j’ai de plus présent, de plus conscient. Ma
grande préoccupation, pour le moment, n’est-elle pas de
protéger ma femme, autant que possible, contre les
désagréments qui peuvent l’atteindre quand je ne serai
plus ? Travaillant, écrivant, je poursuis cette idée, je
m’installe donc continuellement par l’esprit dans
l’avenir proche pour moi comme pour nous tous, où je
serai mort et enterré. À cette seconde où je vous parle,
j’ai la cervelle occupée à la fois par les choses dont
nous parlons et par la conviction que maintenant, tout
de suite, je peux m’affaisser et rendre mon dernier
souffle. Mais cette hantise ne m’attriste pas, ne me
paralyse pas, comme tant de morts-vivants qui jouent à
cache-cache avec la pourriture. »
Pour conclure, donnons la parole à un
quatrième médecin, André Jacquot, qui délivra cette
manière d’épitaphe : « C’était un esprit curieux de
tout, lisant énormément, s’intéressant aux problèmes les
plus complexes comme aux choses les plus banales. Il
aimait s’entretenir avec les gens les plus simples et il
les écoutait avec patience et attention. Servi par une
prodigieuse mémoire, il possédait une érudition
extraordinaire qui lui permettait de traiter avec
compétence n’importe quel sujet… Malgré la vigueur de
ses écrits, il s’est toujours défendu d’être un
doctrinaire, encore moins un chef de file… La seule
création originale qu’il revendiquait avec véhémence
parfois, c’était son style si particulier… Par ailleurs,
sa règle de vie était : ne rien devoir à personne. Son
esprit d’indépendance était poussé à tel point qu’il
n’accepta aucune aide matérielle dans ses moments de
grande détresse… Il avait horreur de l’embrigadement et
détestait l’esprit de système… Avec cela, il était un
confrère excellent, sans prétention, ignorant la
jalousie. »
Cinquante ans
après, un tel diagnostic est-il encore admis par la
bien-pensance qui le voit résolument en grand écrivain
ennemi du genre humain ?
Évocation composée à partir des textes
suivants : Philippe Alméras, Céline entre haines et
passion, Robert Laffont, 1994 ; François Gibault, Céline, 1944-1961. Cavalier de l’Apocalypse, Mercure
de France, 1981 ; Jean Guenot, Louis-Ferdinand Céline
damné par l’écriture, Chez l’auteur, 1973 ; Pierre
Monnier, Ferdinand furieux, L’Age d’Homme, 1979 ;
Erika Ostrovsky, Céline, le voyeur-voyant, Éd.
Buchet-Chastel, 1972 ; Paul del Perugia, Céline,
Nouvelles Éditions Latines, 1987 ; Robert Poulet, Mon
ami Bardamu, Plon, 1971 ; Dominique de Roux, La
mort de L.-F. Céline, Christian Bourgois, 1966 ;
Frédéric Vitoux, La vie de Céline, Grasset, 1988.
(Marc Laudelout, envoyé le 1er juillet 2019).
|