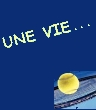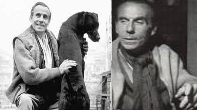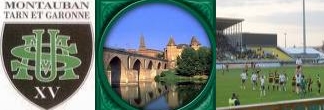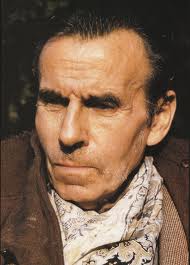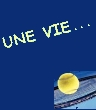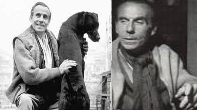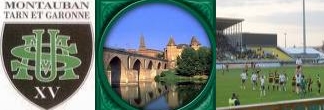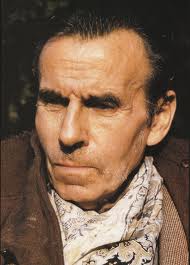|
En
avant-première du
XXII ème Colloque
de la
Société des
Etudes céliniennes
qui se tiendra sur le thème
CELINE et le
POLITIQUE
dans les locaux de
SCIENCES PO
27 rue
Saint-Guillaume, 75007 PARIS
du mercredi
4 au samedi 7 juillet 2018
  
Mardi 3 juillet : 14h -16h.
TABLE RONDE
Faut-il rééditer les pamphlets de Céline ?
Modérateurs :
Emile BRAMI et David
FONTAINE
L'heure prévue est à peine
dépassée quand les prestigieux invités prennent place à
la tribune devant environ une soixantaine d'auditeurs.
On y voit Pierre ASSOULINE, Pascal ORY, Régis TETTAMANZI, Antoine
GALLIMARD, Henri GODARD, Philippe ROUSSIN et Denis
SALAS. Alors que François GIBAULT, le président de la S.E.C., venait-il de présenter les invités et de
regretter que, pour le débat, une large majorité soit
favorable à la réédition, ce qui n'était pas de son fait
puisque notamment Serge KLARSFELD avait été invité, que
trois jeunes gens antiracistes militants, sont intervenus
pour dénoncer les intentions de la maison Gallimard.
Dans
une déclaration très agressive de trois minutes trente
environ, émaillée de propos injurieux et ad hominem
envers Antoine GALLIMARD, le trio composé de deux
garçons et d'une jeune femme (un récitant, l'autre
filmant), s'est finalement retiré sur un dernier mot : "
A bientôt ! "


La
table ronde pouvait commencer. David FONTAINE donne la
parole à Antoine GALLIMARD qui tient à préciser
d'entrée, que c'est à partir du moment où Lucette ne s'y
opposait plus, qu'ils ont préparé, avec François GIBAULT
la réédition des pamphlets. Il ajoute avoir été
douloureusement surpris, alors que rien n'était encore
publié, de voir un tel " ouragan " se propager dans la
presse et regrette amèrement de n'avoir pas été soutenu
par celle-ci. Il déplore et qualifie de calomnie et de "
honte " le fait de venir " lâchement attaquer " son
grand-père et sa maison.
Le modérateur poursuit en lui demandant s'il était en mesure d'avancer
une éventuelle date ? Echaudé : " Je m'en garderai bien
!... " Et d'ajouter pour appuyer son argumentation qu'il
souhaitait cette réédition et que bien au contraire,
comme exemple pédagogique qu'elle soit enseignée dans
les écoles à nos jeunes.

Le
second modérateur Emile BRAMI donne la parole à Pascal
ORY. L'historien évoque Lucien Rebatet et " Les mémoires
d'un fasciste " qui n'ont pas suscité la moindre vague.
" Les Deux Etendards " est un beau texte... Il évoque
Robert Badinter qui, dans une émission animée par
Bernard Pivot avait déclaré qu'il " fallait publier en
tant que document historique. " Pascal ORY conclut : "
Réédition, oui, mais sans rien expurger. "

La
parole est au magistrat Denis SALAS, un des deux invités
opposé à la réédition. Il énumère quatre bonnes raisons
qui devraient faire obstacle à celle-ci : 1/ Le droit
moral, Céline lui-même avait refusé leurs rééditions. 2/
Les lois anti-raciales. 3/ Les risques de débordement
dans le sens d'adhésion à ces textes. 4/ La mémoire
juive qui est négligée. Le peuple de la Shoah risque de
se lever.

Régis
TETTAMANZI, l'auteur de la première édition critique des
quatre textes " polémiques " publiée au Canada par les
éditions Huit, explique comment cela a été rendu
possible tant par le fait que l'œuvre
est tombée dans le domaine public dès le 1er janvier
2012, par ses excellentes relations avec l'éditeur Rémi
Ferland, mais aussi par les bonnes relations qu'ils ont
entretenues tout deux avec les institutions juives de ce
pays.

Philippe
ROUSSIN, le chercheur au C.N.R.S., le second à être
opposé à la réédition, trouve que les pamphlets sont des
œuvres politiques,
rhétoriques et idéologiques. A séparer des romans. " Si
on republiait Drumont cela ne ferait pas réagir, tandis
que republier aujourd'hui la langue des pamphlets ne
serait pas perçu de la même manière. " Il est contre
leur republication. " La seule manière de publier ces
pamphlets serait d'en effectuer une édition
scientifique, mais ce serait leur donner une caution
exagérée. Ceux qui veulent les lire n'ont qu'à faire
comme moi, aller en bibliothèque. "
ORY intervient pour préciser que si on pense réellement
que de tels textes sont aussi efficaces et si on en a
une telle peur... Quel aveu !...
TETTAMANZI : il n'y a pas que de l'idéologie dans l'écriture de Céline. Il
parle d'autre chose.
Le modérateur BRAMI : ils ne sont pas perçus uniquement pour des textes de
combat.

Le
second modérateur, David FONTAINE, donne la parole à
Henri GODARD, qui d'emblée indique qu'il est plus que
jamais pour. Si on ne les réédite pas, on soutient que
l'on cache quelque chose. Le public doit connaître les
deux parties. La richesse c'est la confiance au lecteur.
Il reconnaît que l'on puisse éprouver une certaine
lassitude devant des longueurs ou les litanies
antisémites, les Juifs surtout, mais aussi les autres.
Il conclut en souhaitant que chacun garde son
sang-froid.

Pierre
ASSOULINE, le dernier invité est questionné à son tour.
Il est pour réimprimer tout Céline. Il se projette d'ici
deux ans : " Quand on relira Mein Kampf... on dira, et
Céline ?... et on sera alors bien obligé d'avouer :
Céline ?... c'est trop dangereux ! Quel aveu encore !...
" Et d'ajouter : " qu'il n'y a pas de dangerosité à
publier, c'est le contraire qui est vrai. On offre aux
antisémites des armes, des prétextes. Le danger c'est de
les cacher...
D'ailleurs aujourd'hui, si on lit le gros livre de Taguieff on a sous les
yeux des centaines et des centaines de lignes
antisémites. N'est-ce pas plus dangereux ?... "
Il informe la salle qu'il vient de refuser de débattre avec Serge
Klarsfeld parce qu'il a estimé que celui-ci représentait
une figure emblématique, les Juifs, les enfants et
petits-enfants de déportés et que pour lui, un tel débat
était biaisé !
Aujourd'hui, ajoute-t-il, ce ne sont pas les thèses de Céline qui tuent,
ce n'est pas l'antisémitisme de Céline qui assassine,
c'est daech, ce sont les islamistes.
Antoine GALLIMARD intervient pour une précision
d'importance : " Au moment où l'on parle, on possède
l'accord moral de la veuve, Lucette Destouches. "
Et Pierre ASSOULINE de conclure par une dernière
observation : " Paul Morand, qui est republié dans la
Pléiade est beaucoup plus mordant et cruel dans
l'antisémitisme que Céline. "
C'est
maintenant à la salle de réagir. Marc Laudelout, le
directeur du Bulletin célinien, demande après les
derniers propos de TETTAMANZI et d'ASSOULINE imaginant
d'ajouter encore un nouvel appareil critique plus une
préface du second, si le futur " Cahier Céline " ne
devrait pas être dédoublé ? Puis cite Philippe Alméras :
" Plus Céline est borné, cruel, plus il est injuste,
plus il maquille les faits et les chiffres et meilleur
il est... "
Philippe Destruel insiste sur " le racisme intégral de Céline ", qui est
d'abord un anti-noir, un anti-nègre. Il faut tout
publier, chacun se déterminera en conscience.
David FONTAINE s'adresse à Henri GODARD et lui rappelle que l'on peut
s'ennuyer certes, en lisant ces répétitions, mais que le
style sera toujours là. Et qu'il peut même faire rire
dans l'horreur.
Avant
de se séparer, et avec ce qu'ils ont entendu, il semble
que pour la plupart des invités, deux perspectives se
dessinent pour l'avenir : celle d'une
œuvre de salut public d'une
part et la date butoir de 2032 qui se profile d'autre
part.
MERCREDI 4 juillet 2018
9h30 - 12h30.
François GIBAULT et Emile BRAMI à la
tribune reçoivent l'Assemblée. Le Président déclare
ouvert le Colloque, XXII ième du nom, pour la Société
des Etudes Céliniennes, et précise qu'il s'est appuyé
fortement sur son trésorier Emile BRAMI, qui avec la
parution de la revue n° 10 des " Etudes Céliniennes
" en est devenu également l'éditeur.
Présidence < François GIBAULT
1ère
communication :
Emile BRAMI :
Une vie politique : " Vive l'Anarchie ! Mais tant
qu'il y a des lois. "
Cette phrase, extraite d'une lettre à l'anarchiste Louis
Lecoin, résume bien par les contradictions qu'elle
renferme, les divers errements de Louis Destouches puis
de Louis-Ferdinand Céline s'agissant de politique.
 Va suivre de façon chronologique une suite de faits déterminants qui vont
influencer la vie et l'œuvre
de l'écrivain. Va suivre de façon chronologique une suite de faits déterminants qui vont
influencer la vie et l'œuvre
de l'écrivain.
- Le Fort Chabrol : Jules Guérin et onze de ses hommes, agitateurs
nationalistes et antidreyfusards, qui avaient tenté un
coup d'Etat, refusent de se rendre et va se réfugier au
siège de son hebdomadaire L'Antijuif, au 51 rue
de Chabrol à Paris. Pendant 38 jours, il va tenir en
étant ravitaillé par les toits.
- Louis n'a que 5 ans, et il va entendre son père, qui avec le
Gouvernement craignait une émeute nationaliste à
l'occasion du procès en révision de Dreyfus.
- Il va très vite être classé à gauche, voire à l'extrême-gauche. Aragon
lui demande d'adhérer " malgré vos idées contre les
Juifs... "
- L'Hommage à Zola en octobre 1933.
- Mea culpa, de retour de son voyage en URSS. Il devient alors un
anarchiste de droite. Il dénonce le cosmopolitisme.
S'intéresse à Alexis Carrel.
- L'arrivée des Juifs d'Europe. Le cinéma, Hollywood tenu par les Juifs.
Le Front populaire avec Blum à sa tête.
Mais il aborde quand même des situations réelles. Il avait vu arriver la
guerre avant tout le monde. Le besoin de revitaliser le
peuple français. Devant l'apathie de Pétain, il décide
de s'engager lui-même dans le combat pour retrouver la
France qu'il souhaite. Il veut une vraie politique
raciste. Il évoque l'action de Poincaré pour l'opposer à
celle du Gouvernement, avec plusieurs citations
contradictoires. C'est un nostalgique. C'était mieux
avant.
Finalement, avec son évolution de la gauche vers la droite, la conclusion
c'est qu'il se sera mis tout le monde à dos.
Dans la discussion avec la salle, François GIBAULT ajoute au débat sa
vision toute personnelle de l'anarchisme. " L'anarchiste
de gauche veut le bonheur de tous, il obtient le
désordre. L'anarchiste de droite, lui, souhaite son
propre bonheur, c'est un homme d'ordre...
2ième
communication :
Ana-Maria ALVES :
Céline politiquement incorrect : marqueur
d'une époque.
Céline par ses propos hors normes, cherche à
heurter le conformisme, le politiquement correct qui
veut avant tout ne froisser personne, aucune
susceptibilité. Il va procéder à la peinture de la
société française dans un style qui cherche plus à faire
sentir qu'à décrire. Cet auteur corrosif, reconnu comme
marqueur de son époque, utilise son écriture comme un
acte d'irrévérence sociale. Et dès lors, ne cesse de
provoquer des polémiques encore aujourd'hui.
- Il cherche à provoquer, à choquer, à faire surgir un sentiment de
colère.
- Il veut parler vrai. Etre présent dans les faits. Il va devenir
chroniqueur.
- Ses mémoires sont des armes d'attaque.
- On ne dit pas la vérité aux gens. Lui, prétend le faire en heurtant le
politiquement correct et les idées reçues.
On trouve toutefois une bien grande différence entre ses propos et les
lettres de la correspondance où il révèle faire le pitre
et donner aux visiteurs ce qu'ils attendent et qu'ils
sont venus chercher.
3ième communication :
Angelin LEANDRI :
Céline et le juridique.
Il s'agit de rendre compte du regard porté par
Céline sur le droit dans une acception large de la
notion. En se servant des romans, mais aussi de la
correspondance, on
 voit la complexité, voire même
l'ambivalence du rapport de Céline au droit. voit la complexité, voire même
l'ambivalence du rapport de Céline au droit.
- Comment Céline voyait-il le droit ? Paradoxe entre le juridique et le
politique.
- " La loi, c'est le lupanar de la douleur. " (Voyage).
- Il possède surtout une fibre libertaire... Scepticisme d'un anarchiste
de droite.
- Constat : avant la guerre, avant 1944, Céline n'a pas connu le monde
juridique.
- C'est dans la correspondance que l'on trouve le plus de critiques, dans
ses lettres à ses avocats. " Le grand inquisiteur de la
place Vendôme. " Pour lui, le procureur n'est que le
larbin du politique.
- Il se flatte de savoir faire rire, de mettre les rieurs de son côté. Il
estime qu'il fait tout le travail au lieu et place de
ses défenseurs. C'est lui qui veut énoncer la loi, qui
dirige, qui accuse.
- " J'ai le droit... j'ai le droit. " Il utilise très souvent cette
expression. De quel droit la justice française
s'autorise-t-elle de le juger, de l'accuser ?
Par contre, dès l'amnistie, rentrant à Paris en 1951, il se fait un point
d'honneur à ne plus être un hors-la-loi. Il veut alors
faire un procès à tous. " Un procès au cul de tous ceux
qui l'emmerdent... "
Interviennent toujours les contradictions de l'anarchiste qui bute sur le
concept de droit.
14h30
-17h30
Présidence < Isabelle
BLONDIAUX
4ième communication :
Philippe ROUSSIN :
Que signifie rééditer les pamphlets antisémites de
Céline en 2018 ?

Céline
est aujourd'hui dans l'actualité. Cette actualité,
contrairement aux années 1980 lors des éditions des
romans dans la Pléiade chez Gallimard, n'est plus
d'ordre littéraire. Elle est d'ordre politique, et non
pas seulement patrimoniale ou mémorielle comme on
l'entend dire. Elle résonne avec le retour des démons
xénophobes et de l'antisémitisme en France et en Europe.
C'est bien dans ce contexte que la question de la
réédition des trois pamphlets antisémites de Céline
intervient.
Même si sa position paraît intenable ? Il est important pour ce chercheur
au CNRS de faire entendre une voix minoritaire. Pour lui
on doit considérer trois points importants : 1/ La
nature des textes. 2/ Le contexte : des textes qui
interviennent dans une certaine actualité. 3/ Le droit :
on est dans l'ordre de la rhétorique, de la politique,
de l'idéologie. L'antisémitisme n'est pas une opinion,
c'est un délit.
- D'autant plus délicat que son écriture est savante et riche, donc
influente.
- Machine de description. Qu'est-ce qui fait que des textes de bas étages,
parce qu'ils sont produits par un écrivain qui possède
ce statut, peuvent faire autant de prise, de succès ?
- Le rire, élément de séduction.
- Le prestige de la maison Gallimard compte. Le contexte politique n'est
pas favorable à une telle réédition. Le retour des
démons antisémites existe dans nos sociétés.
- La liberté d'expression individuelle existe, mais elle est limitée par
la discrimination, la haine raciale etc...
- Même si la censure demeure un risque, l'interdiction peut être une
protection contre l'ordre public.
5ième communication :
François-Xavier LAVENNE :
Les pamphlets de Céline, l'actualité vue par le prisme des
mythes.
Les pamphlets de Céline sont des textes
centrés sur le présent et habités par le désir d'agir
sur lui. Ces livres saturés par l'actualité font
cependant appel aux mythes pour enraciner la vision
politique défendue par le polémiste dans un imaginaire
partagé, afin de lui donner un écho plus profond dans
l'esprit du lecteur dans l'espoir d'emporter son
adhésion. Ainsi Céline appuie-t-il sa lecture de la
situation contemporaine de la France sur le mythe des
Quatre Ages pour imposer son obsession de la
 décadence.
Cette communication étudiera la manière dont les
pamphlets déploient une réécriture de l'Histoire centrée
sur quatre fractures qui ont écarté les " indigènes " de
plus en plus de l'Age d'or des origines pour les mener
au bord de l'Apocalypse. décadence.
Cette communication étudiera la manière dont les
pamphlets déploient une réécriture de l'Histoire centrée
sur quatre fractures qui ont écarté les " indigènes " de
plus en plus de l'Age d'or des origines pour les mener
au bord de l'Apocalypse.
La réécriture de l'Histoire sur le canevas du mythe des Quatre Ages entre
alors en résonnance avec l'imaginaire du Grand Complot
omniprésent dans la littérature antisémite. Le
pamphlétaire se préoccupe toutefois peu de la
crédibilité de son discours historique. Celui-ci, pour
les périodes les plus éloignées, est une reconstruction
assumée et teintée d'ironie dont le but est de proposer
une mise en récit subordonnée aux besoins de la
polémique.
Peu importe en somme que l'Age d'or ait réellement existé, seul importe
qu'il ait été perdu pour prouver le déclin et l'urgence
de mettre en œuvre un
programme d'action qui permette de le faire revenir : la
" révolte des indigènes ".
- Le mythe des Quatre Ages. Les Grecs, puis les Romains partageaient l'âge
de l'humanité en plusieurs périodes. Ovide en donnera
quatre : l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et
l'âge de fer (décadence de l'humanité).
- Les indigènes sont dégénérés. Ils n'ont pas compris. Ces indigènes sont
responsables de leur situation, de leur effondrement.
- Le Juif est le diable. Il dirige tout, maitrise tout. La Kabbale, le
Talmud, les marqueurs de la décadence.
- Rappel de l'histoire : Charlemagne, sabotage de l'Allemagne. Les aryens
ont vendu leur âme. Le péché a fait perdre les aryens.
- Tout est ramené au complot juif et aux indigènes responsables de leur
situation.
- La haine de la démocratie. 1793 est une date majeure pour infléchir le
destin des Français. 14-18, une nouvelle fracture, puis
la mort des Romanov finit d'achever l'âme. Le complot
est en train irrémédiablement de faire son
œuvre. 1900, l'Exposition
Universelle représente encore la domination juive.
- Céline veut racheter l'âme, dans Les Beaux draps il prône la
résurrection de la France, l'extinction de la décadence.
Il veut inverser les prophètes et devenir lui-même un
prophète. Il propose, il exhorte les indigènes, il
redevient un médecin, un chirurgien.
Il veut prévenir, protéger, augmenter la capacité de résistance des
aryens aux conséquences du complot juif. La race doit
être sauvegardée et la révolte des indigènes doit
intervenir.
6ième communication :
Johanne BENARD :
Le dialogue dans le pamphlet : subterfuge, piège ou
maladresse ?
Un feuillet recto-verso est distribué aux participants.
Y figurent 32 annotations de dialogues, en deux, trois
lignes tirées de Bagatelles pour un massacre du
volume Ecrits polémiques, Editions Huit, 2012.
J'aimerais, dans cette communication, porter mon attention sur une
modalité énonciative qui semble mineure dans le
pamphlet, le dialogue, en voyant comment elle apparaît
dans les passages les plus violents et les plus
univoquement antisémite de Bagatelles pour un
massacre.
En comparant les dialogues du pamphlet à ceux du roman, je m'intéresserai
aux moments de Bagatelles pour un massacre où le
pamphlétaire convoque des interlocuteurs fictifs (Gustin,
Gutman ou Popaul) et invente des dialogues, qui, de
prime abord apparaissent comme de vaines tentatives de
dynamiser un discours univocal et qui présentent de
réels défis aux lecteurs, perdus dans les incohérences
de la répartition des répliques.
On retrouve dans les nombreux textes où Céline prend Gutman, Popaul ou
Gustin à témoin des messages que l'écrivain distille
tout au long de ses pamphlets :
-
" Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de
danseuse en mouvant équilibre est en ligne, Gutman mon
ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu ! "
(p. 20).
- " Ils ont dit tout ça les critiques ? Je n'avais pas tout lu, je ne
reçois pas L'Argus. Ah ! Mais dis donc ils se
régalent ! Ils sont pas Juifs ? Qui c'est tes critiques
?... " (p. 22).
- " Tu te vantes comme un Juif, Ferdinand !... Mais attention ! Pas
d'ordures ! Tous les prétextes seront valables pour
t'éliminer ! Ta presse est détestable... tu es vénal...
perfide, faux, puant, retors, vulgaire, sourd et
médisant... Maintenant antisémite c'est complet ! C'est
le comble !... " (p. 24).
- " Bien sûr, ce livre va se vendre... La critique va se l'arracher...
J'ai fait les questions, les réponses... Alors ?... Je
crois bien que j'ai tout prévu... Elle pourra chier tant
qu'elle voudra, la Critique... Je l'ai conchiée bien
plus d'avance ! Ah ! je l'emmerde, c'est le cas de le
dire ! C'est la façon ! J'aurai forcément le dernier mot
! en long comme en profondeur... c'est la seule manière.
J'ai pris toutes mes précautions. Mais la critique c'est
pas grave, c'est bien accessoire... Ce qui compte c'est
le lecteur ! C'est lui qu'il faut considérer... séduire.
" (p. 296).
Johanne BENARD terminant : Je refuserai d'y voir
simplement la négligence de l'écrivain et le résultat de
l'urgence du discours pamphlétaire (écrit à la hâte)
pour explorer différentes avenues interprétatives qui
pourraient offrir à la critique un point d'entrée dans
une œuvre polémique que le
racisme risque toujours de rendre imperméable à toute
analyse littéraire.
JEUDI 5 juillet
2018
9h30 - 12h30
Présidence < Emile
BRAMI
7ième communication :
Anne BAUDARD
Céline - Coluche : les pièges de la politique.
Je souhaiterais, dans un portrait croisé de l'écrivain
des grandes guerres du XXe siècle et de l'humoriste à la
fameuse salopette qui défraya la chronique dans la
France
 des années 70-80, montrer qu'en racontant, dans
leurs histoires, leur propre histoire en la reliant
toujours à l'Histoire, ils ont pu tous deux, en grands
moralistes, dénoncer magistralement les travers de leur
époque. des années 70-80, montrer qu'en racontant, dans
leurs histoires, leur propre histoire en la reliant
toujours à l'Histoire, ils ont pu tous deux, en grands
moralistes, dénoncer magistralement les travers de leur
époque.
Leur génie de la langue, leur choix du registre populaire, propre à
rendre la force comique et l'élan vital de leurs vérités
crues, leur permettaient toutes les libertés. Mais leur
tempérament extrême les poussant à aller toujours plus
loin, à repousser toujours les limites du dicible, ils
ont finalement choisi de guerroyer frontalement dans une
arène dangereuse, celle de la Politique, où tout ne peut
pas se dire, où il faut de la diplomatie, ce dont ils
étaient tous deux totalement dépourvus : ils s'y
perdront.
-
Coluche était aussi un poète. Des êtres doubles. Le pire
comme le meilleur. L'un de gauche, l'autre anarchiste de
droite.
- Candidat bouffon en 1981.
- Talent : deux génies de la parole. Un sens aigu de la formule. Sachant
manier l'ironie avec insolence. Utilisant le second
degré pour dénoncer le mal, en exploitant la charge
émotive.
- Tempérament extrême. Se sert de valeurs retournées. Mode carnaval, fou
du roi, dans le monde de la mascarade. Valet de comédie.
Titi parisien pouvant se moquer de tout.
- Engagements politiques : sont aller trop loin. Emportés par leur génie
verbal. Ils savaient parler mais pas se taire.
En s'engageant dans l'arène politique, ils sont allés trop loin, eux qui
détestaient les politiques, ils se sont piégés
eux-mêmes. Que dire aujourd'hui d'un Donald Trump ou
d'un Beppe Grillo ?
8ième communication :
Claude HAENGGLI
Céline aveugle. La critique communiste du manque
d'engagement politique de Céline à la lumière de la
préface de l'édition russe de Voyage au bout de la
nuit.
Les soviétiques ne s'y sont pas trompés. Ils ont dès le
début considéré le Voyage au bout de la nuit
comme un livre politique, qui les a profondément déçus
lorsqu'ils ont pu le lire en russe, lorsqu'Elsa Triolet
et Louis Aragon en eurent organisé la traduction. Cette
édition est précédée d'une préface signée par le
critique Ivan Assimov, qui tenait la rubrique de
littérature française et anglaise dans Novy Mir
et Octobre. Elle est significative à cet égard et
je me propose donc de l'analyser.
En la lisant, ainsi qu'elle a paru dans le Cahier de l'Herne II, on se
rend compte que les communistes attendaient de Céline
qu'il s'engage politiquement. Il ne leur suffisait pas
que son livre soit considéré comme " de gauche " par la
critique française. Tant qu'il ne s'engageait pas
ouvertement à côté d'eux, les Soviétiques le
considéraient comme un aveugle. Il ne suffisait pas
qu'il haïsse le monde bourgeois, il aurait fallu qu'il
lutte pour un avenir meilleur, celui du communisme
universel. S'il ne le faisait pas, il restait hautement
suspect.
Céline s'est bien rendu compte de ce que les communistes attendaient de
lui. Dans sa préface à la réédition de Voyage au bout
de la nuit par Gallimard, il écrira plus tard :
Vous me direz : mais c'est pas le " Voyage " ! Vos
crimes-là que vous en crevez, c'est rien à faire ! c'est
votre malédiction vous-même votre " Bagatelles " ! vos
ignominies pataquès ! votre scélératesse imageuse,
bouffonneuse ! La justice vous arquinque ? garrotte ? Eh
foutre, que plaignez ? Zigoto ! Ah mille grâces ! mille
grâces ! Je m'enfure ! furie ! pantèle ! bomine !
Tartufes ! Salsifis ! Vous n'errerez pas ! C'est pour le
" Voyage " qu'on me cherche " ! Sous la hache, je
l'hurle ! c'est le compte entre moi et " Eux " ! au tout
profond... pas racontable... On est en pétard de
Mystique ! Quelle histoire !
Voyons en quoi consistait cette critique en détail.
-
La préface du Voyage toujours reprise à chaque
réédition est capitale. " Le compte entre moi et Eux
!... " Voilà la phrase importante. EUX, ce ne peut
être les Juifs puisqu'il n'y a rien, en 1932, dans le
Voyage, aucun antisémitisme.
- C'est donc bien la gauche, la révolution socialiste ! Trotski ne s'y
trompe pas. Et encore moins Ivan Assimov. Ils attaquent
Céline qui est simplement pour eux, un reflet de la
bourgeoisie capitaliste. Ils ne trouvent dans ses écrits
aucun espoir de social. Céline est un produit
réactionnaire.
- Céline aura besoin de se justifier. Il le fait déjà dans le discours de
Medan puis dans Mea culpa.
- L'expression " Payer ses dettes " vient des chansons à boire de
l'époque.
En conclusion, l'antisémitisme des pamphlets cache souvent une autre
haine, celle que la gauche lui vouait d'abord pour le
Voyage.



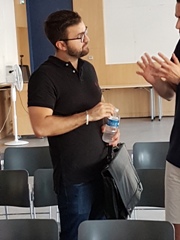

Discussions en cours tout au
long des moments de pause...
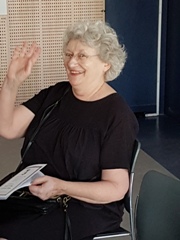

 
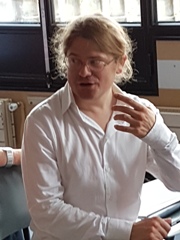
Pause.
9ième communication :
Régis TETTAMANZI
Génétique et politique dans le manuscrit de
Voyage au bout de la nuit.
Cette
communication s'inscrit dans un travail en cours sur le
manuscrit du premier roman de Céline, à partir de la
transcription réalisée récemment par mes soins
(Louis- Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit,
" seul manuscrit ", Québec, Editions Huit, 2016). Dans
l'étude des " motifs idéologiques " au sens large du
terme, il s'agit de sélectionner ici ceux qui
ressortissent au politique, en commençant par le
commencement, si l'on veut, c'est-à-dire par la
politique. Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit,
" seul manuscrit ", Québec, Editions Huit, 2016). Dans
l'étude des " motifs idéologiques " au sens large du
terme, il s'agit de sélectionner ici ceux qui
ressortissent au politique, en commençant par le
commencement, si l'on veut, c'est-à-dire par la
politique.
On proposera donc un parcours, nécessairement un peu rapide, dans les
transformations opérées entre le manuscrit initial et la
version imprimée. Un premier point consistera dans le
repérage de certains noms propres désignant ou connotant
des réalités politiques ; une seconde partie s'attachera
à l'étude des concepts politiques les plus " marqués "
comme anarchisme ou communisme - leur absence, leur
présence, leur transformation ; enfin, on tentera
d'ouvrir, à partir de là, sur des aspects plus "
sociétaux ", impliqués par le politique, comme l'image
du patron, celle des structures économiques, ou les
rapports entre riches et pauvres.
L'objectif est de se demander si l'on peut définir des constances, ou tout
au moins des récurrences dans les modifications
génétiques.
-
Les mots : travail de vérification et de comparaison
entre ceux du manuscrit et ceux de la chose imprimée.
- Différence des mots politiques dans les deux, manuscrit et roman. Il
gomme Faidherbe pour le remplacer par Poincaré. Il
remplace Tardieu par Laval à la fin du roman. Décision
de cocardier. Que recherche-t-il ?
- Notions politiques : on ne trouve jamais le mot socialisme dans
l'imprimé ; anarchisme, plus de trois fois ; américain ;
commerçant ; les riches et les pauvres ; banlieue ;
patrons.
Soit il accentue, soit il diminue ses attaques pour jouer sur les effets.
Marquer davantage ou affaiblir les termes. Pas toujours
d'ailleurs pour accentuer le politique, mais pour
adoucir dans l'esthétisme. Le manuscrit est beaucoup
plus ramassé. L'imprimé, lui, plus explicatif, plus
développé.
14h30 - 17h30
Présidence < Johanne
BENARD
10ième communication :
David FONTAINE
Céline, homme politique ? Le prophète de la
contradiction.
"
L'Article n'est point mon fort. La politique non
plus, d'ailleurs. Il y faut un tour que je ne possède
pas. " " Acte de foi ", publié dans La Gerbe, 13
février 1941.
Céline ne s'est jamais départi d'un programme politique radical qu'il a
exprimé directement dans ses pamphlets comme dans ses
textes divers publiés dans la presse de la Collaboration, mais aussi en basse continue, camouflé
sous les atours de la fiction drolatique, dans ses
romans d'après-guerre.
Collaboration, mais aussi en basse continue, camouflé
sous les atours de la fiction drolatique, dans ses
romans d'après-guerre.
En 1941, publiant son troisième pamphlet, Les Beaux draps, il
adopte la posture du prophète qui a raison trop tôt. Et
il conjure les Français attentistes à choisir leur camp
une fois pour toutes. Il prône :
- L'antisémitisme racial comme question préalable. Il propose, somme les "
rapprochistes " (collaborateurs) de faire l'union sur la
question " antijuive ", prologue à un " parti unique "
et de se prononcer clairement pour un " acte de foi "
raciste.
- L'action comme mot d'ordre expéditif. L'action, radicale, contre le
verbiage et la dialectique, au terme d'un discours
paradoxal qui prône une révolution sanglante qui ne peut
dès lors que tourner court.
- Le " communisme d'âme ". Il propose au lieu et place de mots d'ordre
négatifs " anti ", un programme " communisme Labiche ",
" L'Egalitarisme ou la mort ! ", avec " ablation du
capital individuel ", et " salaire national " unique ,
afin de guérir le corps malade national rongé par le
cancer matérialiste de l'argent.
Toujours plus avant dans son obsession, il voit le Juif, par essence
solidaire, à l'œuvre dans le
ferment de la désunion du camp collaborationniste. Il se
réfère alors à une vision tragique de l' " Histoire
Vercingétorix ", où le Gaulois, le Français, est
toujours déjà battu par l'envahisseur de l'intérieur.
C'est donc un communisme qui ne vise pas à construire l'Homme
nouveau, mais à régénérer l'homme ancien, voire à
retourner à l'enfance (fantasmée) de l'humanité.
Anti-programme. Quand Céline en appelle au dépassement du politique par la
" mystique ", ce n'est pas pour s'élever à une
spiritualité désincarnée, mais pour reconduire à la
vérité ultime enracinée dans le corps selon lui : le "
rythme émotif " du sang, la pulsion créative qui définit
" le lyrisme aryen " originaire.
11ième communication :
Sven THORSTEN KILIAN
Céline non-politique.

Quand on lit le chroniqueur de la Belle Epoque
(dans Mort à crédit), de la Première Guerre
Mondiale (dans Voyage), de l'Occupation et de l'Après-Guerre
(dans Guignol's band) et aussi et surtout
l'antisémitisme, on peut penser qu'il existe un Céline
politique. Mais le " cas " Céline n'est pas un exercice
de style de la critique et des études littéraires, mais
une préoccupation de l'opinion publique qui semble
toucher de très près le politique.
- Céline n'est pas du tout un penseur politique. Pas de projet, de
réflexion un peu soutenue.
- Les " idées " des pamphlets sont ou de caractère fantasmatique ou
invalidées par l'invective.
- Pas de propositions efficaces, raisonnables, mais des invectives. Anti
rationnel, une stratégie toute littéraire..
- Le " cas " Céline : la préoccupation de l'opinion publique.
- Le racisme biologique serait a politique...
- L'alarmisme avec des retours sur la violence fait sortir du champ
politique.
Références du communiquant au philosophe Aristote. C'est parce qu'il n'est
pas considéré comme un homme politique qu'il est lu.
12ième communication :
Isabelle BLONDIAUX
Céline et le politique. Contribution à
l'analyse de la paratopie célinienne.
J'ai proposé de nommer " paratopie " le façonnage paradoxal de l'identité énonciative de
l'artiste. Autrement dit, produit de l'œuvre
déterminant l'œuvre à
produire autan t que l'identité énonciative de l'artiste,
la construction de la paratopie, jamais figée, demeure
un travail " in progress ". t que l'identité énonciative de l'artiste,
la construction de la paratopie, jamais figée, demeure
un travail " in progress ".
Au delà d'une approche poétique, la référence platonicienne permet de
mieux appréhender l'apparente nécessité interne du
rapport polémique de l'artiste au politique. Incarnée
par la figure historique de Socrate, elle désigne comme pharmakeus, maître légitime du pharmakon, celui qui,
acceptant d'assumer en sa personne les effets de
retournement du discours, se métamorphose en figure
emblématique du pharmakos, devient bouc émissaire
(Derrida 1972).
Mais dimension pharmaco -logique de l'écriture oblige, le retournement
chez Céline n'est jamais une fois pour toutes. Aussi,
loin d'être réductible à une sorte de figure de saint
(il n'y a pas de place pour Dieu dans la " mystique "
célinienne mais plutôt pour une sorte de poïesis
dyonisiaque, qui récuserait le vin pour privilégier le
délire, la folie, la musique et la danse), la figure du
bouc émissaire célinien (Flambard-Weisbart 2017) ne
cessera de se dévoiler comme la face réversible du
persécuteur antisémite, chacune de ces figures
constituant la vérité intime de l'autre.
-
Structure complexe du premier roman. M.C. Bellosta, Yves
Pagès sont repris. " Communisme d'âge ".
- Le dialogue n'est pas tant le but de convaincre son interlocuteur, mais
de le vaincre.
- Le recours au discours politique, à sa façon dialectique lui permet de
reprendre l'argument et de rebondir : renversement
dialectique.
- Longue évocation de l'analyse des Entretiens avec le Professeur Y.
Rapprochement. L'écriture tourne vers la mort. C'est une
représentation de la force vive du langage oral.
Puissance occulte, donc suspecte.
VENDREDI 6 juillet 2018
9h30 - 12h30
Présidence < David FONTAINE
13ième communication :
Rémi WALLON
Louis Destouches en Afrique : une
politique d'emprunt ?
Dans les lettres envoyées d'Afrique à son amie Simone
Saintu entre mai 1916 et avril 1917, Louis Destouches
paraît puiser les idées qu'il expose à son amie dans des lectures nombreuses et éclectiques, puisque, comme le
rappelle François Gibault, on le voit citer " Albert
Samain, Jules Renard, Voltaire, Socrate, Pascal, le
Prince de
 Ligne, Metchnikoff, Alfred de Musset, Montluc,
Talleyrand, Urbain Gohier, Farrère, Oscar Wilde (mais au
sujet de ses mœurs
uniquement), Baldwin, Maeterlinck, Kipling, pour lequel
il éprouvait une grande admiration, Brunetière, Jules
Lemaître, Bergson et Faguet ! " Ligne, Metchnikoff, Alfred de Musset, Montluc,
Talleyrand, Urbain Gohier, Farrère, Oscar Wilde (mais au
sujet de ses mœurs
uniquement), Baldwin, Maeterlinck, Kipling, pour lequel
il éprouvait une grande admiration, Brunetière, Jules
Lemaître, Bergson et Faguet ! "
Or il se trouve que de très nombreux passages des lettres envoyées
sortent tout droit des pages de la revue Le
Correspondant : il y pille nombre de réflexions
qu'il présente comme siennes. C'est le cas par exemple
lorsqu'il discute la notion allemande de Kultur, les
idées de l'écrivain antisémite Urbain Gohier ou une
formule de Musset sur le goût du peuple pour la liberté.
Chaque fois, Louis Destouches reprend mot à mot, des
articles parus dans Le Correspondant entre 1913
et 1916.
Qu'en penser ? Peut-on encore dire comme le faisait Philippe Alméras au sujet de la guerre,
qu'il fait preuve d'une " originalité de pensée certaine
" ? Les idées qu'il expose, pour être d'emprunt,
jouent-t-elles dans sa maturation intellectuelle,
littéraire et politique un rôle moins important que
celui qu'on lui attribuait jusque-là ?
-
Il faut préciser que ses lettres se situent 2 ans après
son expérience de la guerre.
- Ces lectures lui ont permis de se constituer une culture
extraordinairement vaste et riche.
- Le Correspondant, qui paraissait tous les quinze jours, était
l'équivalent de la Revue des Deux Mondes qui le
nourrira plus tard. Destouches ne le mentionne jamais.
- Simone Saintu lui envoyait également Le cri du Peuple.
- Différences et rapprochements à la fois pour les lettres envoyées à
Simone Saintu et celles à ses parents ?... Débat.
14ième communication :
Bianca ROMANIUC-BOULARAND
Inclusion et exclusion dans Voyage au bout de la
nuit et Mort à crédit.

En français, le pronom " on " a la particularité
remarquable de pouvoir représenter par une forme unique,
une multitude de référents. Il peut viser de façon
générique les humains en général, ou de façon plus
spécifique un nombre restreint ou un ensemble délimité
de référents, dont l'existence, mais pas toujours
l'identité, est assumée. Dans ce cas, il peut inclure la
personne du locuteur et correspondre à un " nous " plus
ou moins large, ou l'exclure et correspondre à peu près
à un " ils ".
Dans Voyage au bout de la nuit, Céline joue remarquablement au
niveau stylistique de l'utilisation de ce même pronom
pour désigner des réalités hétérogènes. Ex: il peut
passer d'un " on " générique, incluant l'humanité
entière, à un " on " représentant le groupe des " miteux
" auquel il appartient.
Dans Mort à crédit, un autre pronom est utilisé " ils ", qui
désigne les autres, ennemis collectifs, sans signaler
pour autant la moindre inclusion du " je ".
-
Dans Voyage " je " montre un désir
d'appartenance, à l'humanité par rapport à la société.
- Dans Mort à crédit, le " je " est seul séparé d'autres groupes
d'individus.
- Autour de lui, les " je " et les " ils " ouvrent sur des ennemis
identifiables et peuvent amener à des conflits.

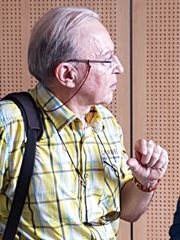


Ceux qui ne sont pas intervenus à la tribune en
profitent lors des pauses...
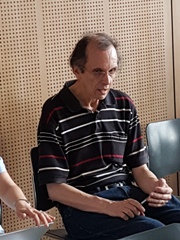



Pause
15ième communication :
Pierre-Marie MIROUX
Céline, Hommage à Zola : du politique à la politique.
Cette communication portera sur l'Hommage à
Zola, courte allocution prononcée par Céline, en
octobre 1933, à Médan et qui, à ma connaissance du
moins, n'a jamais fait l'objet d'une étude détaillée.
Invité, suite au succès de scandale de la parution de
Voyage au bout de la nuit, à prononcer la
traditionnelle allocution de Médan pour
l'anniversaire de la mort du grand écrivain, Céline n'y
parle pratiquement pas de Zola, sauf pour dire que le
peu d'optimisme qu'on pouvait encore tirer du
naturalisme est définitivement enterré.
En conséquence, reprenant les thèmes de Voyage au bout de la nuit
en encore plus noir, il annonce à ses auditeurs qu'un
nouveau grand massacre se prépare et qu'on y trouvera
peut-être encore pire qu'Hitler et ses " sous-gorilles
".
 Quant à l'antisémitisme, il n'en est pas question un
seul instant... Voilà donc un texte qui nous interroge
non seulement sur son contenu, mais aussi sur
l'évolution qui le suivra : que se passera-t-il entre
1933 et 1937, date de la publication de Bagatelles
pour un massacre, pour que ce pessimisme tourne au
pacifisme résolu, accompagné d'un antisémitisme virulent
et d'une certaine complaisance pour le régime nazi ?
Quant à l'antisémitisme, il n'en est pas question un
seul instant... Voilà donc un texte qui nous interroge
non seulement sur son contenu, mais aussi sur
l'évolution qui le suivra : que se passera-t-il entre
1933 et 1937, date de la publication de Bagatelles
pour un massacre, pour que ce pessimisme tourne au
pacifisme résolu, accompagné d'un antisémitisme virulent
et d'une certaine complaisance pour le régime nazi ?
C'est pour remercier Lucien Descaves que Céline accepta
d'aller, selon la tradition, discourir à Medan.
Il était, lui aussi, antimilitariste. Il avait écrit "
Les Sous-offs ", avec un procès de l'armée à la clef. Il
lui avait apporté son soutien au Goncourt, jusqu'à créer
même un incident parmi les membres du jury.
- Céline, pourtant, déclare ne pas aimer Zola. Il ajoute : " Je ne m'aime
pas non plus ", c'est bien difficile...
- On constate l'absence totale d'antisémitisme dans cet " Hommage ".
La ligne de facture entre les pro-sémites et les antisémites n'était pas
si nette qu'aujourd'hui à cette époque.
Deux exemples : Emmanuel Berl et André Malraux vont illustrer ce fait.
Malraux avait demandé un texte à Céline pour son ami
Emmanuel Berl, juif, et directeur de la revue de gauche
Marianne. Il parut, ce qui semble bien indiquer
que l'antisémitisme de Céline ne paraissait pas
inquiéter à l'époque.
- Plus tard, Emmanuel Berl écrira deux des premiers discours du Maréchal
Pétain en juin 1940.
- Malraux n'intégra la Résistance que bien plus tard, en 1944. Lui,
l'homme de gauche et figure antifasciste.
- A l'inverse, on a l'exemple de Daniel Cordier, antisémite, adepte de
Charles Maurras qui part à Londres et devient même, en
1942, le secrétaire de Jean Moulin.
S'il est trop facile de pratiquer le manichéisme aujourd'hui, après tant
d'évènements, il reste que les années 1932 et 1933
auront bien été deux années de fracture pour
Louis-Ferdinand Céline.
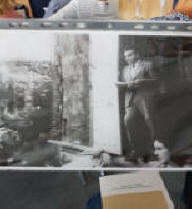
.jpg) 
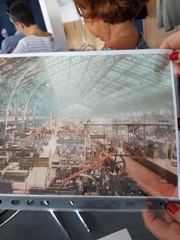
Quatre documents d'époque distribués par Pierre-Marie
MIROUX durant son intervention.
14h30 -17h30
Présidence < Sven THORSTEN KILIAN
16ième communication :
Suzanne LAFONT
Une lecture littéraire du politique : le motif de la
Vanité dans Voyage au bout de la nuit et Mea
culpa.
Dans le contexte politique récent, il me semble
utile de voir comment les littéraires abordent
la question du politique dans l'œuvre
de Céline avec leurs moyens propres différents de ceux
des historiens.

Deux exemples : Nizan et Trotski. Le premier part d'une analyse
littéraire pour opérer une lecture idéologique : le
roman débouche sur une impasse politique. Trotski, part
à l'inverse du terrain politique en prenant acte que le
roman ne porte pas à la révolte contre une société
donnée ; il situe la force révolutionnaire du roman dans
son style " anti Poincaré ".
Dans cet angle de vue, on peut montrer que le pamphlet anti soviétique
Mea culpa est peut-être moins efficace que Voyage
au bout de la nuit sur le terrain même où se situe
le pamphlet, le terrain politique.
Dans le roman, les utopies incorporées au récit en contredisent la
logique générale. Le dispositif narratif tient à
distance le nihilisme et l'absurdisme attribués au
roman. Inversement, Mea culpa, inscrit dans le
débat politique du temps, se révèle plutôt un livre
moral comportant, en contrepoint des imprécations, des
utopies sociales impraticables.
Un opérateur de lecture comme le motif de la Vanité, qui relève du
registre esthétique et moral, peut nous aider à
expliquer ces paradoxes et à mesurer les forces
relatives du pamphlet et du roman.
-
La Vanité est-elle politique ? Définition et digression.
C'est l'Art.
- Le comique de la Vanité : le pétillant. Le choix des majuscules. Passer
de l'autre côté de la vie, vers la mort.
- Mea culpa, entre politique et sermon. L'acte de confession. Son
discours s'adresse aux hommes dans une situation
politique particulière ; mais il va élargir celui-ci à
tous les hommes, à tous les pays.
- On relève des signes d'arrogance sardonique...
17ième communication :
Pascal IFRI
Céline et l'Amérique : de Voyage au
bout de la nuit à L'Ecole des cadavres.
Céline s'était rendu trois fois aux USA entre
1925 et 1937 alors qu'à cet époque un tel voyage était
considéré comme une aventure. Il connaissait donc bien
ce pays qui occupe une place particulière dans son
œuvre aussi bien romanesque
que polémique.
Dans Voyage au bout de la nuit, il en fait une description
exceptionnellement crue et réaliste de la vie en
Amérique, basée sur sa propre expérience. Alors que de
nombreux écrivains continuaient à chanter les charmes du
Nouveau Monde trois ans après le krach de Wall Street et
en pleine dépression, Céline a montré la face cachée
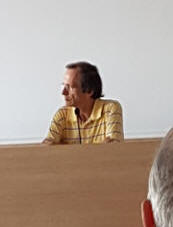 du
rêve américain. Tellement bien qu'on a cru voir en lui
un communiste en puissance. du
rêve américain. Tellement bien qu'on a cru voir en lui
un communiste en puissance.
L'épisode américain du Voyage constitue le parfait pendant de son
pamphlet Mea culpa. Désenchantement devant le
vrai visage de la Russie soviétique et les horreurs du
communisme stalinien, contre la désillusion devant la
froideur et la cruauté d'une civilisation sous l'emprise
du grand capitalisme.
Quelques années plus tard, dans L'Ecole des cadavres, Céline va
donner une image encore plus noire des USA. Si c'est
toujours le pays où l'argent, les banques et le gros
capitalisme sont rois, ces forces ont désormais un
visage, celui du Juif, qui y détient tous les pouvoirs à
commencer par la Maison Blanche où réside " Roosevelt-Rosenfeld
".
Et son combat va se radicaliser puisque l'antimilitariste, le pacifiste
est persuadé que les Juifs font tout pour qu'une guerre
contre Hitler éclate et que cette guerre soit menée par
Européens et notamment par les Français.
-
Il connaissait bien par ses divers voyages financés par
la Fondation Rockefeller et ses visites chez Ford.
- D'abord enthousiaste avec Lola. Manhattan le quartier de l'or. Les
femmes infiniment belles, les danseuses. Il est arraché
à son rêve par la faim. Se réfugie pour le rêve dans le
cinéma.
- Il va démystifier la société industrielle et ses bienfaits. Découvre la
misère de l'Amérique. Le rêve s'efface en découvrant
Detroit et l'usine, le travail à la chaîne. Les Temps
Modernes.
- Les mêmes épisodes crus et réalistes sont montrés comme dans Mea
culpa. Sociétés toutes deux contrôlées par les Juifs
qui y possèdent tous les pouvoirs.
- Il dénonce la volonté manifeste de déclarer la guerre à Hitler pour se
venger, et que ce soit les Français qui dérouillent.
S'il s'appuie toutefois sur quelques faits réels : La Guardia le maire de
New York et ses rapports avec la mafia, ils sont
excessivement exagérés.
18ième communication :
Bernabé WESLEY
" Magaule ", " La Force par la joie " et le " truc
d'incarner ". La langue écran du politique dans la
trilogie allemande.
Une page tirée D'Un château l'autre [Romans, Vol.
2, (éd. Henri Godard) Gallimard 1974], est distribuée à
la salle. Elle vient illustrer les dires du médecin de
Sigmaringen quant au " coup d'incarner " du Maréchal
Pétain. " Oh ! que vous incarnez la France monsieur le
Maréchal ! " " Le " coup d'incarner est magique
!... "
La critique célinienne fait régulièrement le constat d'une
disqualification des idéologies dans les écrits
d'après-guerre. Dans la trilogie allemande, cette
défiance à l'égard des discours prend la forme d'une
langue écran composée par des discours qui cherchent à
s'approprier le monopole symbolique de l'histoire.
Un maelstrom frénétique de sigles et d'acronymes ( " ardentes élite P.P.F.,
R.N.P. " ) égrène, sous des appellations fantaisistes,
des noms de partis ( " néos-Bucard !... néos-Cocos ! " )
et les comités ( " Comité Plauen " ) d'une " élite
tourneveste " dont les signes d'accointance et
d'appartenance sont fréquemment attaqués dans des séries
énumératrices dégradantes ( " chef-loufiat, chef
torche-chose " ).
A l'image des personnages qui dansent entre les bombes, les vocables
idéologiques sont, eux aussi, contraints de danser le
rigodon et subissent des torsions, des dérives, des
substitutions, des associations sémantiques improbables
qui font sauter les catégories politiques usuelles et
laissent émerger un sens nouveau là où le discours
cherche à circonscrire le dicible.
-
Se servir de personnages (ex : Harras), par une attitude
ambivalente et ainsi créer une figure réactionnaire
d'une situation considérée.
- Des discours transversaux pour l'effet idéologique des textes. Certains
discours sont des arbitrages, des critiques formulées.
- Ambivalence des présentations pour faire passer, à travers des
contradictions, des messages précis, prévus.
- Faire de l'histoire un élément qui, par la violence du langage, fera une
parole qui seule, finira par vaincre les
questionnements.
- Utilisation d'une langue dans la langue, invention de mots, néologismes,
violence de la langue ou des formules de politesse.
Constructions de phrases, formules figées qui donnent
l'aspect d'avoir toujours raison.
- Choix des mots pour leur phonétisme, " fifi ", " libération " en
minuscule. " La Frounze aux Français... "
- La déroute de 40 c'est le voyage des peuples. Des termes utilisés à
contre-sens pour minimiser l'effet et susciter
l'adhésion.
SAMEDI 7
juillet 2018
BIBLIOTHEQUE de l'ARSENAL
1 rue Sully, 75004 Paris

9h30 - 12h30
L'assemblée
réunie pour la dernière journée de ce XXIIe Colloque,
François GIBAULT se félicite de l'accueil qui lui est
réservé dans un lieu aussi prestigieux. Après l'avoir
chaleureusement remercié, il présente le directeur de la
Bibliothèque de l'Arsenal, Monsieur Olivier BOSC, qui,
après quelques mots de bienvenue, se propose lors de la
demi heure de pause, de nous décrire et de nous faire
découvrir les joyaux de ce monument historique.
Nous nous trouvons dans la salle " Sully ", et la première communication
de ce samedi va se dérouler sous la Présidence de Régis
TETTAMANZI :
19ième communication :
Pierre de BONNEVILLE
A l'agité du bocal : le premier Céline
d'après-guerre, un dernier pamphlet.
Depuis la rentrée 1945, Sartre n'est plus prof.
de philo à Condorcet, il a acquis une autre dimension.
Il devient le nouveau chef spirituel de la génération de
l'après-guerre qui n'a de cesse de destituer celle
d'avant-guerre. Avec la légitimité du philosophe, il a
investi peu à peu tous les domaines : cinéma, théâtre,
roman, critique, journalisme, politique.
En octobre 1945, alors que Céline est réfugié au Danemark, risquant
l'extradition et la peine de mort en cette période de
règlements de comptes, Sartre écrit dans Les Temps
Modernes, la revue qu'il vient de créer et que
finance Gallimard, un article intitulé Portrait d'un
antisémite, dans lequel il assassine Céline d'une
phrase terrible : "
 Si Céline a pu soutenir les thèses
socialistes des nazis, c'est qu'il était payé ". Une
contre-vérité qui peut coûter cher à Céline. Si Céline a pu soutenir les thèses
socialistes des nazis, c'est qu'il était payé ". Une
contre-vérité qui peut coûter cher à Céline.
Rappelons que Brasillach a été fusillé en février de cette même année,
Denoël sera assassiné en décembre. Céline est bien en
mal de se défendre, il s'est caché au Danemark, mais,
débusqué, il est arrêté et emprisonné à Copenhague fin
décembre de cette année-là. Il ne découvrira la
calomnie de Sartre que deux ans plus tard et écrira
alors, spontanément, une cinglante et ironique réponse,
qu'il enverra à Jean Paulhan pour qu'il la publie. Ce
que Jean Paulhan ne fera pas.
Finalement, ce fameux texte, A l'agité du bocal, dans lequel il
métamorphose Sartre en ténia, Céline le confiera à
Albert Paraz, qui le publiera en appendice, en novembre
1948, dans son livre Le Gala des vaches. Un
nouveau monde est né. Sartre se révèlera l'icône de
cette nouvelle époque tandis que Céline reviendra
modestement en France, en 1951, amnistié, pour passer
les dix dernières années de sa vie avec une seule
obsession : compléter son œuvre
de six nouveaux ouvrages.
-
Abécédaire : A : A l'agité du bocal. C'est le
premier écrit d'après-guerre de Céline. Sartre est
partout (l'agité). Donne des conférences partout. Crée
Les Temps Modernes. Il régente la littérature
française. C'est dans le n° 3 des Temps Modernes
qu'il a écrit son accusation. En pleine épuration, c'est
une véritable déclaration à mort.
C : cobra, il lui donne une leçon d'esthétisme.
D : délire, mais il faut délirer juste.
E : éducation, pour lui qui a été un fonctionnaire toute sa vie. E :
émotion, la critique ultime du talent.
F : flûte, il faut savoir en jouer.
G : génie de la flûte.
I : imposteur, il a délivré Paris à bicyclette.
J : J.B.S.
L : leitmotiv, J.B.S. 14 fois dans le texte.
M : mépris, musique, écriture avec l'oreille.
P : Peter Brook, poésie.
V : Villon, art de Villon, de Shakespeare.
20ième communication :
Sylvain MARTIN
Du politique au poétique, à propos des
Entretiens avec le Professeur Y.
Al !... alors !... Al !... allons-y ! monsieur !... mais
pas de politique surtout !... pas de politique !... -
Ayez pas peur !... oh, aucune crainte ! la politique
c'est la colère !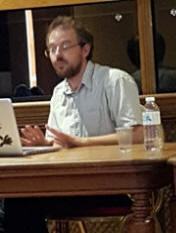 ... et la colère, professeur Y, est un
péché capital ! oubliez pas ! celui qu'est en colère
déconne ! ... et la colère, professeur Y, est un
péché capital ! oubliez pas ! celui qu'est en colère
déconne !
A partir de cet extrait, situé dans les
premières pages des Entretiens avec le professeur Y,
nous tâcherons de déterminer le positionnement de Céline
vis-à-vis de la question du politique suite à son retour
d'exil. Derrière le mot " politique ", apparaissant dans
notre extrait, se cache notamment une allusion aux
prises de position de Céline avant et après la guerre,
via la rédaction des trois pamphlets.
Paradoxalement, si Céline tâchera de ne plus revenir sur la question juive
dans la décennie qui suivra, se positionnant comme
l'homme du style face aux idées, opposant
systématiquement le poétique au politique, il n'aura de
cesse de développer de " formidââââbles idéââs ",
celles-là même qu'il dénigre dans les Entretiens avec
le professeur Y, et d'envoyer à chaque interviews et
interventions de multiples " messâââges ", multipliant
ainsi les prises de position.
-
Devant l'insuccès de Féerie, poussé par
Gallimard, Céline décide de se défendre.
- Réséda : une couleur, mais aussi une plante qui calme les nerfs.
- Le professeur Y, le colonel Réséda c'est le lecteur.
- Maladie de ne pas parler de politique. Portrait affreux de Mauriac et de
Claudel en mante religieuse.
- Le portrait des girouettes portées par les foules.
- " On les aura !... on les aura !... " " Les Mouches joué
par Sartre sous la botte.
- Le " Chella " est évoqué, habilement utilisé pour l'image du naufrage.
Pause




Le directeur Mr. Olivier BOSC nous fait
découvrir et admirer les salons.
Le directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal
revient et propose aux participants de le suivre pour
une visite guidée.
" L'arsenal, fut d'abord un couvent, celui des Célestins, puis il est
devenu une place militaire fonderie de canons qui fit
place ensuite à une zone de plaisance entre la Seine et
la Bastille. Construit en 1512 pour entreposer des
poudres, l'Arsenal deviendra l'hôtel prestigieux du
grand maître de l'artillerie. En 1788, il sera détruit
après la démolition de la Bastille pour le creusement du
bassin de l'Arsenal, relié au canal Saint-Martin, puis
deviendra en 1983 un port de plaisance.
C'est Louis XII qui décida en 1512 la construction du bâtiment. L'Arsenal
se modernise sous Henri II mais connaît son grand éclat
au moment où le duc de Sully, ministre d'Henri IV, nommé
grand maître de l'Artillerie s'y installe en 1599.
De grands noms : Charles Nodier, le bibliothécaire au
XIXe siècle avec le Cénacle ; José-Maria de Heredia qui
l'orienta vers la littérature et le théâtre ; Paul
Cattin ; en 1925 elle accueille la riche collection
Rondel dédiée aux arts de la scène et du cinéma. En 1977
elle devient un département de la Bibliothèque
nationale. Bibliothèque nationale de France depuis 1994.
Aujourd'hui l'Arsenal possède plus d'un million de documents, 15 000
manuscrits, 100 000 estampes. Elle pratique une
politique d'acquisitions qui concerne essentiellement la
littérature française du XVIe au XIXe siècle. Elle a été
classée monument historique en 2003. "
21ième communication :
Anne SEBA
Céline à bord du Kong Hamsun avec Knut et les
autres...
Céline, appartenait-il à la catégorie des soi-disant "
Artistes de la Faim ", termes employés par Claude Vigée
pour désigner ces écrivains dont la vie créatrice (et
 personnelle) est définie par un refus du monde ? Cet
état d'esprit provient d'un " sens de la culpabilité
(qui) hante nos lettres depuis le romantisme. " Qui
plus est, cette " obsession du péché s'accompagne d'une
soif de renoncement aux choses terrestres, d'un désir de
libération des liens humains, entachés de souillures aux
yeux sévères du juge intérieur ". personnelle) est définie par un refus du monde ? Cet
état d'esprit provient d'un " sens de la culpabilité
(qui) hante nos lettres depuis le romantisme. " Qui
plus est, cette " obsession du péché s'accompagne d'une
soif de renoncement aux choses terrestres, d'un désir de
libération des liens humains, entachés de souillures aux
yeux sévères du juge intérieur ".
Cependant, Céline était hanté par certains péchés, comme l'abandon des
êtres qui avaient joué un rôle important dans sa vie. Un
tel état d'esprit, voire un tel désir de se débarrasser
de la " souillure " d'un péché suite aux maux qu'il
avait infligés aux autres - son public ainsi qu'à ses
proches - pourraient, mener à un penchant ascétique,
comme c'était le cas de " Baudelaire, Lautréamont,
Flaubert, Mallarmé, Kafka ou T S Eliot ".
-
" Les Artistes de la faim " ? Céline appartenait à
ceux-là.
- Renoncement aux choses terrestres. Céline avait lu Hamsun, de son vrai
nom Pedersen. Céline utilise le prénom de Knut au lieu
de Kong.
- Le navire sur lequel il embarque représente la liberté.
- L'évocation à la fin du Voyage, l'écluse et qu'on n'en parle
plus... est évoquée par le bateau ; Hamsun évoque sa
souffrance.
- Céline reprend son chagrin avec la mort de sa mère : " Elle était
innocente ma mère, comme moi. "
- Culture mélancolique. Fantasme de l'origine. Mystique chez Céline.
Avant le déjeuner, le Président de la S.E.C. propose de
terminer l'Assemblée Générale qui avait été déjà
partiellement entamée. En effet, le lieu du prochain
Colloque qui devrait avoir lieu dans deux ans, a été
choisi, ce sera Bruxelles. Et Marc LAUDELOUT est en
contact pour un cadre renommé dans la capitale belge.
Attendons confirmation...
François GIBAULT remercie à nouveau Emile BRAMI, le trésorier, ainsi que
la secrétaire Isabelle BLONDIAUX pour leurs activités
respectives. Celle-ci indique que le mérite en revient
également aux membres actifs du Comité de direction des
Etudes céliniennes, et précise les améliorations qui
doivent encore être apportées : respect des délais
d'envoi des contributions, ajustement sur les mêmes
polices, site amélioré par Sven THORSTEN etc...
Dans la foulée et en conclusion, le rapport financier et le rapport moral
sont adoptés à l'unanimité.
14h30
Présidence <
Régis Tettamanzi
22ième communication :
Philippe DESTRUEL
Casse-tête ou casse-pipe ?...
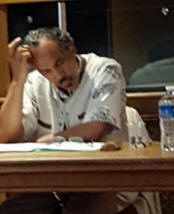
Les séquences qui nous restent aujourd'hui de
Casse-pipe nous offrent des pages prodigieuses qui
sont à ranger aux côtés des grands chefs-d'œuvre
de Céline. On s'accorde en général à résumer ce texte
ainsi : cette histoire de régiment relate la recherche
d'un mot de passe oublié. Pourtant, force est de
constater que les critiques qui se sont penchés sur ce
texte sont loin d'avoir accordé la priorité à la
thématique du souvenir, et à la question de la mémoire.
Ces aspects textuels majeurs, selon nous, méritent attention. Nous
assistons aux premiers pas d'un jeune soldat dans la vie
de garnison, comme tout petit d'homme frappé d'amnésie à
la naissance, marqué par le refoulement inconscient,
cependant voué à grandir et à agir à l'aide de sa
mémoire, pratique, tourné vers l'avenir.
C'est donc à la nécessité du souvenir, à sa neuro-anatomie littéraire,
que nous voudrions consacrer notre communication tant
Céline a su lier le sens de la mémoire (pour reprendre
le titre d'un essai bien connu) à l'imaginaire matériel
du sujet encaserné.
- Le mot de passe. Comment chercher. La seule question que pose Céline : "
le pire de tout c'est d'oublier ! "
- Tout le manège, toutes les interrogations pour tenter de retrouver la
mémoire, le mot.
- Chacun faisant retomber sur le subalterne la faute et l'importance de
l'oubli.
- Les péripéties à tiroir pour matérialiser cette mémoire. Le rire
communicatif.
Ce XXIIe Colloque touche à sa fin. En effet, les
vingt-deux interventions sont maintenant terminées. Pour
clôturer cette dernière journée, le Président François
GIBAULT propose à l'assemblée de visionner un film de
Delphine de BLIC réalisé en 2016, sur deux grands écrans
d'ordinateur. Ce film s'intitule " Le caillou dans la
chaussure. "
Le compositeur de musique Bernard CAVANNA et Delphine de BLIC, sont
présents dans la salle. Ils vont à tour de rôle évoquer
les conditions d'une telle réalisation et dialoguer avec
les participants.
Bernard CAVANNA, compositeur aux multiples facettes, autodidacte
provocateur s'est servi du pamphlet de Céline, dont
vient de nous entretenir Pierre de BONNEVILLE ce matin,
" A l'agité du bocal ", pour en faire, nous dit-il,
" un
oratorio ".

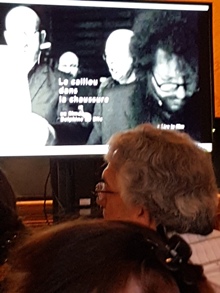

Bernard CAVANNA et Delphine de BLIC
présentent " Le caillou dans la chaussure "
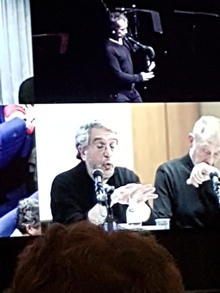
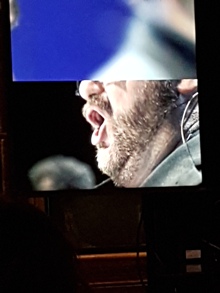
La réalisatrice explique : " Cette pièce de musique est
audacieuse et sale. Les mots y sont jetés, crachés,
vomis. Des insultes à Sartre. Des insultes à Céline. Des
insultes à Cavanna. Au-delà du bruit, reste la beauté de
la musique. Celle que Cavanna nous assène à coups
d'orgue de barbarie, de cymbalum et de cornemuses, et à
coup de ténors qui gueulent et éructent. " (Delphine
de Blic, 2016).
Bernard
CAVANNA, lui, nous explique que c'est un texte qui
projette Céline par la musique. Tous les rythmes, toutes
les musiques sont présents. Ce concert a été donné
plusieurs fois, composé de " 3 ténors dépareillés " et
18 musiciens en tout, et qu'il a donné lieu à beaucoup
de polémiques lors des dernières représentations.
Méditation sur notre état d'être humain : " L'homme trônant sur ses 10
000 ans de civilisation agissant en réflexe de
paramécie. "
Pas
de polémiques, pas d'insultes, mais les commentaires
dans la salle sont allés bon train, notamment quand le
compositeur, tout à la fin de son exposé, lyrique,
déclare qu'il aurait bien envisagé une fin différente ;
avec par exemple, un " défilé des troupes allemandes de
la wehrmacht ou des images d'Oradour "...
************
XXIème Colloque
International
Louis-Ferdinand CELINE
VARSOVIE 30 juin, 1er et 2 juillet 2016
Le thème choisi pour cette année :
" CELINE, masculin féminin ".
Ce XXIème colloque se déroule dans les locaux de
l'Institut Culturel Français de la capitale polonaise aimablement prêtés, pour l'occasion, par Mr
Stanislas PIERRET, son sympathique
directeur.
Situé dans le cœur
de Varsovie, à une dizaine de minutes, tout près des
grands hôtels il offre sur deux étages de très nombreux
livres, revues et disques à une population avide
d'ouverture sur le monde français des arts, de la
littérature ou de la musique.
C'est justement, au
premier étage, dans la grande salle de la " Médiathèque
" que Maître GIBAULT, le président de la Société des
Etudes Céliniennes, après avoir accueilli
chaleureusement la trentaine de participants, déclare
ouvert ce XXIème Colloque International.
Dans ses paroles de
bienvenue, Mr Stanislas PIERRET évoque avec passion le
rôle essentiel de l'Institut Français, sa mission et le
lien important qu'il assure entre chercheurs notamment
sur la littérature.


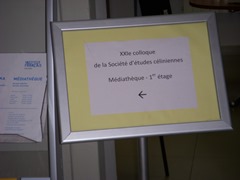


Salle Médiathèque
Mrs PIERRET et GIBAULT
Jeudi 30 juin 2016 , 9h30 :
La première intervention peut maintenant inaugurer ce
XXIème colloque polonais...
Présidence François GIBAULT
1ère communication :
Anne BAUDART
: CELINE le masculin et le féminin.
C'est
dans Semmelweis, la thèse de médecine de L-F
Céline et dans Les derniers jours de Semmelweis,
où il revient sur l'histoire du médecin hongrois qui
découvrit avant Pasteur la cause de l'infection dans la
fièvre puerpérale, que j'ai cherché à comprendre
l'ambiguïté de l'écriture d'un écrivain au pseudonyme
étrangement féminin :
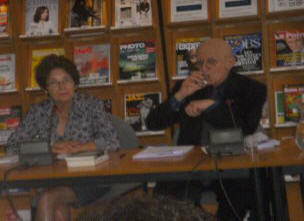 Céline. Céline.
Le choix de ce prénom, ne s'explique pas seulement par son attachement à
sa grand-mère ou à sa mère ! A Rome un citoyen avait
trois noms, le surnom désignait le trait de caractère...
Cette part de féminin révèle ce qui est sa manière
d'écrire, sa magie, son enthousiasme poétique.
Quand il commence son Voyage, il a déjà perdu, après la traversée
de 14, toute confiance dans les valeurs attribuées à la
guerre, à la virilité, au pouvoir. C'est dans l'histoire
de la vie de Semmelweis qu'il va trouver la vérité, son
échec dû à sa trop grande sensibilité pour faire aboutir
le résultat de ses recherches. Il refuse de reconnaître
cette injustice et la folie destructrice des mâles
auquel il oppose la douce patience et l'intelligence des
femmes.
Mais il
constate que Semmelweis n'a pas eu " la force de son
génie "... Et qu'il a manqué de courage et de
détermination virile cause en grande partie de sa
tragédie. Alors que la virilité masculine détruit,
Semmelweis veut sauver, construire. " Les femmes nous
amènent sur un autre chemin... "
Après avoir dénoncé les horreurs de la guerre, Céline va choisir de
hurler avec les loups dans ses pamphlets
espérant, en dénonçant le pouvoir imaginaire des Juifs,
trouver les solutions radicales d'un homme fort.
Tiraillé entre sa
violence " masculine " et sa douceur " féminine ", entre
recherche d'harmonie et explosions de haine, son style
hérissé par l'hystérie, reste le lieu où s'est déroulé,
de livre en livre, ce conflit, jusqu'au bout impossible
à dépasser.
2ième communication :
Ana Maria ALVES
: Marie CANAVAGGIA fidèle collaboratrice de Céline ou
" Colomba jalouse " ? Dévouement féminin/soupçon
masculin.
Approche de la relation de Louis-Ferdinand Céline avec
Marie Canavaggia qui en parallèle avec sa carrière de
traductrice assure la fonction de secrétaire de
l'écrivain. Le terme de secrétaire doit se comprendre plus
exactement comme " assistante " ou bien encore comme "
Double ".
terme de secrétaire doit se comprendre plus
exactement comme " assistante " ou bien encore comme "
Double ".
" Une gazelle dangereuse écrit-il à Nimier ". Qui, proche, surveille,
collectionne.
A l'heure des soupçons il confie à Paraz pressentir avoir à ses côtés une
" Colomba jalouse ". Elle devra recréer les liens
distendus pendant son absence au Danemark. Depuis
Mort à crédit, elle reconnait en lui un écrivain
tout à fait exceptionnel avec le privilège de l'avoir vu
au travail. " On a une dette envers lui... "
Et pour Céline, elle
a un vrai statut difficile, " son admirable amie "... La
fierté, la loyauté, le talent, sa femme de confiance...
Elle prend livraison des manuscrits, les lit, les note.
Elle surveille et corrige les épreuves d'imprimerie,
elle collectionne les articles de critique avant de les
lui faire parvenir.
Quand elle lui
déclare ses sentiments, il la remet en place sèchement.
Elle devient lassante, ennuyeuse, " Colomba
emmerdante... " Mais les doutes qui pouvaient intervenir
durant ses sept années d'exil ne pourront pas détruire
des années de dévouement.
PAUSE... lieu de retrouvailles, plaisir
d'échanges et de mises en commun...


On compare les lieux, les
capitales des derniers colloques, Paris, Berlin, Varsovie...


Mais l'énergumène revient toujours au cœur
des conversations...
3ième communication :
Véronique ROBERT : CELINE et FLAUBERT
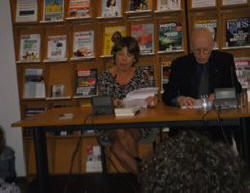
Les deux écrivains étaient tous les deux
d'origine normande. On trouve chez eux une même
passion... un même mysticisme.
Une même haine de la campagne... Et un amour commun des
perroquets...
Ils vont à leurs tours vivre la guerre. Flaubert va
subir celle de 1870 contre les prussiens. " Quelle haine
cette guerre ! "
Céline, celle de 14-18... Nous avons là deux furieux
solitaires...
Jeudi
30 juin 2016, 14h15 :
Présidence Christine SAUTERMEISTER
4ième communication :
Pascal IFRI : La conception de la femme chez Céline :
un parallèle entre les romans et la correspondance.
Dans les romans de Céline, la femme apparaît bien
différente selon que le héros/narrateur considère son
apparence physique ou sa personnalité. Dans le premier
cas, il fait souvent preuve d'un enthousiasme débordant
devant les plaisirs que promet ou que donne le corps de
la femme. C'est l'attitude de Bardamu devant Lola,
Musyne et Sophie dans Voyage au bout de la nuit, de
Ferdinand devant Nora dans Mort à crédit, et du
Ferdinand plus âgé devant la jeune Virginia dans Le
Pont de Londres.
Sophie dans Voyage au bout de la nuit, de
Ferdinand devant Nora dans Mort à crédit, et du
Ferdinand plus âgé devant la jeune Virginia dans Le
Pont de Londres.
Cependant, à mesure qu'il apprend à connaître ces
femmes, son engouement ne dure pas et laisse la place à
un désenchantement aussi extrême qu'avait été son
enthousiasme. Céline ne croit pas au vocabulaire sur
l'amour. L'image de la femme apparaît le plus souvent
différente selon ses interlocuteurs.
Leurs actions trompeuses, imbéciles ou même méchantes le
hérisse et sa conception se renforce en considérant de
façon définitive qu'elles sont traitresse ou idiote. "
Sorcière ou fée... "
Il va magnifier la perfection du corps féminin, la danseuse. C'est
l'hymne à la danseuse. Jouisseur, ivre des muscles, des
cuisses, " des versants musculaires... " Alors beauté et
vice sont inséparables...
Cette communication va s'efforcer de vérifier si dans la
correspondance, cette dichotomie, cette double image de
la femme, se retrouve et notamment dans les nombreuses
lettres que Céline a écrites à ses " amies "
particulièrement au cours des années trente.
5ième communication :
Tonia TINSLEY : Le féminin dans l'œuvre
de Céline : sur les traces d'une synthèse essentielle.
Le thème choisi représente l'ensemble des recherches
de l'intervenante ce qui va lui permettre d'analyser la
complexité et l'équivoque de la question chez Céline.
Par rapport au point de vue global de toute l'œuvre,
ce thème va montrer le positionnement essentiel du
féminin dans le développement du style célinien.
 Ce féminin se trouve au
centre d'une synthèse artistique vitale à la fois au
rythme langagier et au jeu imagier d'un Céline qui
cherche à créer dans " l'intimité des choses, dans la
fibre, le nerf, l'émotion des choses... en tension
poétique constante, en vie interne. " Ce féminin se trouve au
centre d'une synthèse artistique vitale à la fois au
rythme langagier et au jeu imagier d'un Céline qui
cherche à créer dans " l'intimité des choses, dans la
fibre, le nerf, l'émotion des choses... en tension
poétique constante, en vie interne. "
Cette présence
féminine qu'elle soit de nature concrète ou suggérée à
l'œuvre de Céline, permet de
transposer au texte la cadence du vivant et du vécu
éphémères et secrets.
On voit le
positionnement ambiguë d'un personnage masculin décrit
en femme. Mme des Pereires comparée à un homme, et
Courtial enclin à un féminisme grossissant... Parallèle
où Mme des Pereires gronde, jupe retroussée... Dans
Mort à crédit, Mireille possède le vice de tous les
hommes...
Tantôt l'écrivain
féminise ses personnages masculins, tantôt il impose des
caractéristiques masculins à ses personnages féminins,
allant parfois jusqu'au travesti. Cette pratique prête
néanmoins une survaleur au féminin, puisqu'elle permet
la reprise continuelle d'un langage et d'un lieu communs
entre le féminin et l'écriture, et amène Céline à une
synthèse substantielle signalée la plupart du temps par
le même trio de personnages : l'écrivain, la femme, et
l'artiste, autrement dit, Céline féminin masculin.
PAUSE :
Le président propose à l'assistance d'avancer l'Assemblée
générale prévue dimanche matin et de choisir le lieu du
prochain colloque ainsi que le thème qui y sera
développé. Pour aider le choix du lieu, il propose
Le Havre, et pour Paris, la Fondation Dubuffet, Sciences
Politiques ou la Fondation Singer-Polignac.
A la suite de propositions riches d'intérêt, on semble se diriger vers
Paris pour le choix de la ville et Sciences Politiques
pour le lieu. Quant au thème il y en a trois qui ont été
retenus, dans l'ordre de préférence : " Céline et la
politique ", " Céline et l'argent ", et " Céline et
Paris ".

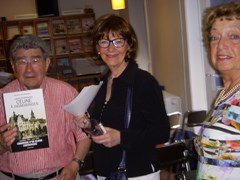
Les anciens, les habitués des
colloques... Les nouveaux adhérents, ravis...


Tous se côtoient, échangent...
heureux d'appartenir à une même famille.
6ième
communication :
Pierre de BONNEVILLE : Céline et les femmes.
L'intervention se déroule sous un écran où figure le jeune
Céline entouré de son père et de sa mère. Pierre de
BONNEVILLE va se servir d'images qui défileront sur
l'écran pour illustrer, au fur et à mesure, la justesse
de son argumentation. Ainsi nous verrons successivement
Marie-Karen Jensen, Lucienne Delforge, Drena Beach,
Eliane Bonabel, Elizabeth Craig, Lucie Porquerol, Marie
Canavaggia, Lucette Almanzor...
Mis en nourrice
trois jours après sa naissance, il a longtemps manqué de
protection et il n'a trouvé celle-ci que très tard avec
Lucette qui allait partager sa vie jusqu'au bout. Avec
un homme comme Céline, les femmes n'ont pas le beau
rôle. Toujours dans le besoin affectif, toujours en
difficulté dans la gestion de ses émotions.
Voyeur et
fétichiste, Céline a une admiration éperdue pour le
corps féminin : " Son corps était pour moi une joie qui
n'en finissait pas. Je n'en avais jamais assez de le
parcourir, ce corps américain "... Son fétiche ? La
cuisse de la danseuse. Le fétiche est une
métonymie. L'objet-fétiche quel qu'il soit, est le
prolongement du corps maternel.
Toujours besoin d'une
canne, besoin de se nourrir de complicité. Et que ces
complicités le nourrissent. Complicités féminines et
masculines. Si la cuisse est son fétiche, son icône est
bien la rousse américaine de 26 ans rencontrée à Genève.
Déterminante pour son écriture, " l'Impératrice "
devient la dédicataire de son Voyage au bout de la
nuit.
Dominateur, avide
de possession, il crée lui-même les conditions de
l'instabilité en provoquant les ruptures tout en les
redoutant. Cette tendance à idéaliser puis à dévaloriser
l'autre : " Tu es formidable... tu es une ordure ". Et
il s'arrange pour que ses liaisons
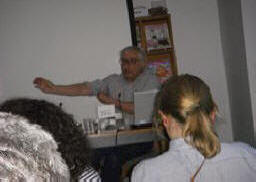 soient
distantes géographiquement. Ses " femmes " sont
dispersées à Londres, à Genève, en Bretagne, à Anvers, à
Vienne, à New York, au Danemark... soient
distantes géographiquement. Ses " femmes " sont
dispersées à Londres, à Genève, en Bretagne, à Anvers, à
Vienne, à New York, au Danemark...
Son credo : jouir,
profiter de la vie, sans entrave, sans interdit, sans
servitude, sans assujettissement. En 1925, à Blanchette
Fermon, il recommande : " A vous Blanchette de ne plus
perdre une seconde... A cheval ! Lance en main à
l'assaut de tout ce que les hommes contiennent encore de
poétiques et fructueux désirs ! [...] farce mélancolique
la vie, croyez-moi. Farce sinistre si on abandonne les
quelques fleurs qu'on peut cueillir dans le jardin de sa
jeunesse. [...] Laissez votre cœur
tranquille. Vous ne savez pas vous en servir... "
La médecine et
l'écriture l'ont en partie sauvés, lui offrant le double
statut gratifiant de " docteur " et " auteur ". Le
cerveau étant premier organe sexuel de l'homme,
l'écriture se substitue à la libido, lui permettant de
revivre les sensations et les émotions, de prolonger, de
vivre et revivre les réalités et les illusions
amoureuses, érotiques, sentimentales : " superposer les
noms des femmes aimées jusqu'à ce qu'elles forment un
cercle enchanté qui peut-être était à l'abri des ravages
du temps. Lucette s'amalgamait avec Lili (Elizabeth) et
Arlette (Arletty) ; la dernière et la première se
joignaient dans une ronde sans fin. " (Erika Ostrovski,
Céline, le voyeur voyant).
L'avenir de Céline
n' était pas la femme, mais la feuille de papier.
Ainsi, se termine la première journée de ce XXIe
Colloque International. Avant de regagner les chambres
d'hôtel ou de commencer à découvrir les grandes artères
du centre de la capitale, tous se retrouvent invités à
un " pot de bienvenue " aimablement offert par
l'Institut et son directeur.
Un verre à la main est toujours un facteur de convivialité et de
rapprochements.





VENDREDI 1er
JUILLET 2016, 9h30 :
Présidence : Johanne BENARD
7ième communication :
Anne SEBA-COLLETT : L'Arène de Saba : L'histoire de
Céline chez la Reine de Saba et sa sœur
Lilith.
La métaphore de l'arène de Saba est un espace
hautement propice à la création des
œuvres de Céline. Il est en effet peuplé de
figures à l'image double de la Reine de Saba et de sa sœur
homologue et androgyne Lilith.
Lilith, elle a
deux rôles, un envers les femmes et un envers les
hommes. Pour les femmes c'est elle qui fait mourir les
accouchées et les nouveau-nés. Pour les hommes Lilith
les séduit, car elle se nourrit de leur semence. Chaque
fois que la semence d'un homme tombe sur la terre, il la
féconde et engendre un démon.
Elle aurait régné
comme Reine de Saba et elle serait le démon qui aurait
tué les fils de Job, elle serait apparue devant Salomon
déguisée en prostituée de Jérusalem. Sous diverses
apparences elle plane à travers les rêves des hommes ; à
la fois séductrice et envoûtante, vampire ou succube.
Avec une imagerie très variée, qui éclaire son caractère
de démon, sous les traits d'une superbe femme nue, parée
d'une longue chevelure ondoyante, une vulve se dessine
sur son front, ses jambes prennent la forme de serpents
et pour couronner sa majesté deux ailes lui confèrent un
aspect prodigieux.
Les écrivains,
Flaubert, Anatole France, Nerval ou Nodier, devanciers
littéraires de Céline, dans plusieurs romans du XIXe
siècle, avaient déjà utilisé ces figures romanesques.
Il y avait dans
cette attitude de solidarité féminine une seule femme
qui rayonnait de la bonté et de la beauté - la Molly du
Voyage ; celle qui " devait avoir un petit ciel
rien que pour elle, près du Bon Dieu. "
Ajoutons Elizabeth
Craig, le grand amour de Céline, qui a littéralement
pris des ailes comme une Lilith en s'envolant vers les
Etats-Unis pour, de surcroît, se marier avec un juif, ce
qui à son tour, a attisé l'antisémitisme latent de
l'écrivain.
8ième communication :
François-Xavier LAVENNE : Le cannibalisme sexuel
célinien ou le rapt des ondes de vie.
Cosmologie imaginaire. Des vibrations subtiles dans
l'atmosphère. " Des dentelles d'ondes... " Dans la scène
du viol de Virginie, durant de longues minutes, le
personnage célinien se transforme. On voit un
balancement permanent entre la vie (la danseuse, la
lumière), et la mort (la bidoche).

Chez Céline, l'acte sexuel est un acte violent,
potentiellement destructeur, sous-tendu par le désir de
posséder totalement l'autre au risque de l'anéantir.
Dans Mort à crédit,
Ferdinand commence par être la victime des appétits
sexuels de femmes qui le réduisent à l'état d'objet
avant que la situation ne s'inverse lors du viol de
Virginie.
L'analyse des
champs lexicaux dans cette scène montre que l'acte
sexuel s'apparente à une forme de cannibalisme dont le
but est de voler à l'autre une part de son énergie
vitale. Pris dans un accès frénétique de gloutonnerie
amoureuse, Ferdinand tente de s'approprier un peu de la
jeunesse de Virginie, d'approcher le secret de son âme,
de lui dérober son trésor de vie et de grâce.
Cette
communication s'attache à mettre en évidence les
substrats imaginaires qui sous-tendent la représentation
célinienne de l'acte sexuel. Celle-ci s'inscrit en effet
dans une conception magico-religieuse de la vie comme un
jeu d'ondes.
Le voyeurisme, qui
permet la jouissance dans la distance, apparaît alors
comme un mécanisme de défense de l'individu vis-à-vis du
danger potentiel que représentent tant les pulsions de
l'autre que les siennes.
Ce voyeurisme
érotique se mue en rituel mystique dans le culte de la
danseuse. Dans l'œuvre de
Céline, la danseuse transcende la chair et la
spiritualise. Elle rayonne d'énergie vitale et initie
les hommes à une nouvelle manière de cultiver et de
partager les ondes émotives.
9ième communication :
Rémi WALLON : Une drôle de dame : Céline et la
féminité d'Elie Faure.
Au moment de la publication de Voyage au bout de
la nuit, Céline fait parvenir à Elie Faure un
exemplaire de son roman. Cet envoi est suivi, quelques
semaines plus tard, d'une lettre dans laquelle, en
réponse à un premier jugement très favorable, l'écrivain
exprime à l'historien de l'art son admiration : " Vous
avez reçu mon livre parce que depuis toujours je lis les
vôtres, tous les vôtres et avec quelle joie ! Quelle
passion même ! Je suis depuis toujours loin de l'Art et
des Artistes - sauf votre livre, je n'ai jamais eu aucun
contact avec eux - C'est ma bible. "

Ces premiers échanges enthousiastes, dans lesquels Céline se présente à
Elie Faure comme un ardent lecteur de son
œuvre foisonnante - au
sommet de laquelle il semble placer l'Histoire de
l'art - conduisent les deux hommes, médecin l'un et
l'autre, à prendre l'habitude de se rencontrer
régulièrement.
Cette amitié
naissante incite Elie Faure à publier en juillet 1933
une étude de plusieurs pages consacrées à Voyage au
bout de la nuit : il y présente le roman comme une
œuvre sans commune mesure
avec la production littéraire de son temps, tant il lui
semble que " l'homme actuel est pareil au langage de
Céline ".
Dans les années
qui mènent Céline de cette prise de contact amicale à la
publication des pamphlets puis à celle de Guignol's
Band I, sa fréquentation des écrits d'Elie Faure
semble ne jamais se démentir. Les désaccords esthétiques
et politiques entre les deux hommes sont cependant de
plus en plus manifestes, et le ton employé par Céline
dans ses lettres se durcit progressivement.
Au mois d'août
1935, l'écrivain fait ainsi simultanément grief à
l'historien de l'art de sa langue et de ses idées : dans
ces deux domaines, il l'accuse violemment de manquer de
virilité : " Mais bien sûr que j'ai raison, dix mille
fois raison ! " L'amour " n'est pas un propos d'homme,
c'est une formule niaise pour gonzesse ! L'Homme va au
fond des choses, y reste, s'installe, y crève. Vous
n'avez pas un langage d'ouvrier, vous êtes emmenés par
les femmes, vous parlez femme et midi. En avant la
barcarolle ! "
Il s'agira ainsi
d'étudier dans cette communication ce reproche de
féminité adressé par Céline à Elie Faure - dans la
pensée de qui l'amour, ce sentiment " dégueulasse
" dont Robinson faisait le mensonge par excellence dans
les dernières pages de Voyage au bout de la nuit,
joue en effet un rôle de premier plan.
14h15
: Présidence : Pierre-Marie MIROUX
10ème communication :
David FONTAINE : " Je suis gratuite, je suis femme du
monde " : Céline " Pas putain pour un sou " ?
Pourquoi
Céline se définit-il régulièrement, voire réplique-t-il,
comme une femme, lorsqu'il veut défendre le caractère
désintéressé de son engagement ? Pourquoi réagit-il si
vivement à l'accusation de Sartre d'avoir été " payé par
les nazis " dans le libelle " A l'agité du bocal ",
comme sous la brûlure de l'accusation infâmante entre
toutes ?
Il s'agira dans
cette communication de s'interroger sur la nature de "
l'engagement " au sens célinien (et partant antisartrien).
Engagement volontaire, des deux guerres : engagement au
sens d'abord militaire et indissolublement pacifiste,
avant d'être un acte de foi patriotique. Céline se
définit comme un croisé belliqueux se sacrifiant pour
 préserver
la paix de ses compatriotes : une Jeanne d'Arc moderne
cherchant à sauvegarder la France. préserver
la paix de ses compatriotes : une Jeanne d'Arc moderne
cherchant à sauvegarder la France.
Dans tous les
domaines, Céline semble mesurer la justesse de
l'engagement à la gratuité sans tache d'un idéal. C'est
de façon récurrente la comparaison sous-jacente avec la
prostitution qui permet de l'exprimer. Ainsi dans
l'entretien avec le journaliste suisse Albert Zbinden
(1957) : " Mais absolument je suis femme du monde et non
pas putain, n'est-ce pas. Par conséquent j'ai des
faiblesses pour qui je veux. "
Afin de témoigner
de son indépendance " d'affranchi ", l'écrivain - qui
s'est choisi délibérément un pseudonyme féminin - se
présente en femme libre, tombant amoureuse (d'une cause)
pour son compte. Cela fait écho à son art poétique : "
Au commencement était l'émotion ", qui n'a pas de prix ;
d'où découle ensuite naturellement le Verbe, qui épouse
le rythme émotif.
Or ce paradigme "
femme du monde " vs. " putain " s'articule avec d'autres
paradigmes récurrents : " voyeur " vs. " exhibitionniste
" ; " maquereau " vs. " client " ; " écrivain " vs. "
médecin " ; " style " contre les " idées "... En se
combinant, ces paires se compliquent en une dialectique.
" Je pavoise
d'être gratuit... n'importe comment et dans n'importe
quelle condition... je suis pas putain pour un sou !...
" Malgré la gratuité revendiquée sur tous les plans, y
compris sa pratique de médecin qui ne se fait pas payer,
Céline explique de manière contradictoire s'être lancé
dans la médecine ou la littérature pour des raisons "
économiques ".
L'élan lyrique de
l'engagement semble rejoint par le prosaïsme de la
vocation. Inversement, cette revendication de gratuité
renverse tout soupçon d'être " vendu " : Céline, se
posant en bouc-émissaire, explique inlassablement avoir
" payé cher " pour les autres, et avoir " mis sa peau
sur la table " au plan littéraire.
11ème communication :
Sven Thorsten KILIAN : " Je suis une femme du monde
et non pas putain, n'est-ce pas. " Le genre ambigu du
sujet-parlant célinien.
En
1957, dans l'entretien radiophonique avec Albert Zbinden
Céline se déclare " femme du monde " se référant, tout
d'abord, à ses alliances - réelles ou idéologiques -
compromettantes de l'avant-guerre. La métaphore féminine
a donc un premier sens politique qui est
l'incorruptibilité. Mais la signification de
l'auto-attribution féminine est, à commencer par le
pseudonyme féminin, plus large.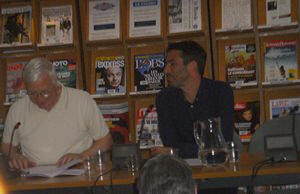
Souvent, et avec
plus d'insistance dans Guignol's band et
Féerie pour une autre fois, l'écriture célinienne
brouille la distinction féminin/masculin, non seulement
au niveau strictement grammatical mais aussi par rapport
à l'imaginaire qu'elle met en scène.
La fascination
pour le corps féminin dépasse l'enthousiasme érotique
pour un objet de désir. La féminité (la danseuse) ou
l'androgynéité (le vampire) ont plutôt la fonction d'un
masque que le sujet-parlant revêt en transgressant les
limites du discours habituel.
Dans Guignol's
band, par exemple, le délire de presque tous les
personnages masculins semble instigué par des
personnages féminins qui peuvent être lus, par
conséquent, comme allégorie de l'extase et de
l'emportement en général. Puisque ce roman, dans le
fond, parle de la Seconde Guerre mondiale autant que de
la Première, l'emportement du masculin par le féminin
est une figure originale et éclairante de la séduction
fasciste. La première partie de Féerie pour une autre
fois, par contre, parcourt le corps émasculé du
prisonnier. La perte du phallus (l'opprobre, la fuite,
l'arrestation) fait place à une obsession pour les
orifices (voire la préoccupation principale de Ferdinand
dans sa cellule).
La communication
cherche à analyser, à partir d'une lecture approfondie
de quelques extraits des textes des années 1936-1952,
ces procédés rhétoriques et discursifs et de les mettre
en relation avec l'univers idéologique du Céline des
années de guerre.
On voit que même
si l'idéologie semble le contredire, un courant
sous-jacent de son écriture permet d'associer Céline au
gender trouble théorisé bien après la mort de
l'auteur.
PAUSE :



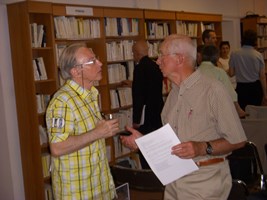


12ème communication :
Johanne BENARD : Shakespeare au Touit-Touit Club.
Cette communication se présente comme la deuxième
partie de ma communication présentée au dernier colloque
de Paris. Si j'ai montré alors que les rapports
intertextuels de Guignol's band à La Tempête
de Shakespeare passaient par les thèmes de
l'enfance, de la féerie et de la légèreté, (liés aux
personnages de Miranda et
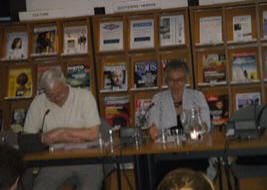 d'Ariel),
je voudrais proposer maintenant que ce roman évoque
également le personnage de Caliban, du côté de la mort,
des tropismes et de la lourdeur. d'Ariel),
je voudrais proposer maintenant que ce roman évoque
également le personnage de Caliban, du côté de la mort,
des tropismes et de la lourdeur.
Partant de
l'hypothèse que la tentative de viol de Miranda par
Caliban chez Shakespeare pourrait trouver son écho dans
l'épisode du Touit-Touit Club (lieu " calibanesque "
s'il en est un), où Ferdinand, à la fin d'une nuit
orgiaque, finira par violer Virginie, je proposerai que
la pièce de Shakespeare permet de donner sens à l'une
des scènes les plus énigmatiques du roman célinien.
De même, en
continuant de montrer comment les intertextes de la
pièce de Macbeth et de La Tempête
s'entrelacent dans ce roman, je verrai comment le
personnage de Mille-Pattes, " aux relents âcres ",
pourrait être tout autant le fantôme de Banquo,
apparaissant à Macbeth lors d'un banquet, que la
créature de Caliban, qui " dégage une très rance et
poisseuse odeur ".
Jusqu'où aller
dans l'interprétation de ce jeu intertextuel qui nous
balance entre deux pièces de Shakespeare comme entre la
faute (de Macbeth) et le rachat (de Prospéro) et,
puisque le thème de ce colloque nous invite à le faire,
entre le masculin et le féminin ?
Du meurtre au
viol, sommes-nous toujours dans le même imaginaire de la
faute et de la culpabilité ? Entre le personnage de
Delphine, complice du meurtre de Van Claben, et le
personnage de Virginie, jeune vierge qui deviendra la
victime de l'agression de Ferdinand, est-ce le féminin
qui s'est perdu ou le masculin, indomptable Caliban, qui
s'est empêtré dans les interdits ?
Après cette sixième intervention, la seconde journée de
ce XXIème Colloque International se termine et Maître
GIBAULT donne rendez-vous à tous les participants à
demain matin samedi 2 juillet, 9h30.
SAMEDI 2 juillet 2016, 9h30 :
Présidence : David FONTAINE
13ème communication :
Bianca ROMANIUC-BOULARAND : Mort à crédit ou
l'histoire de la construction identitaire.
Sur le chemin vers la sortie de l'enfance, Ferdinand dans
Mort à crédit subit l'influence de plusieurs
adultes. Mis à part la grand-mère et l'oncle Edouard, il
s'agit s urtout de couples (la mère et le père, Nora et
son mari, Irène et Courtial de Pereire).
Ce sont autant
d'influences féminines et masculines, auxquelles
l'enfant s'oppose ou adhère. A quelques rares exceptions
(Nora par exemple), les femmes semblent se placer sous
le signe d'un réalisme utilitaire, étant des obstacles à
l'accomplissement du rêve, de la " légende ".
L'image
allégorique de la " Cliente " apparaissant dans le
délire de Ferdinand, qui survole Paris en portant sous
ses jupes tout un monde, est emblématique dans ce sens.
Les hommes, eux, tout au contraire, tentent de
s'extraire de la réalité, de la fuir et de s'enfoncer
dans le rêve par le biais de la parole mythomane.
Il nous semble que
ce roman met en scène l'histoire de la création de
l'identité de Ferdinand, se construisant par un
balancement entre les deux pôles, masculin et féminin.
Loin d'une
structuration identitaire nette, ce trajet semble
témoigner de l'aboutissement vers un état ambivalent,
réconciliant les contraires, à l'instar de l'image
symbolique d'Irène de Pereire, qui bascule dans
l'hétérogénie identitaire en se parant de traits
masculins.
A travers
l'analyse de cette structure identitaire, il sera aussi
question de surprendre en filigrane la création d'une
identité littéraire, oscillant entre une parole plutôt
féminine, utile et fonctionnelle, et une autre, plutôt
masculine, migrant vers un vide de la signification.
14ème communication :
Odile ROYNETTE : Guerres et dévirilisation chez
Louis-Ferdinand Céline.
Comme l'avait fait Pierre de Bonneville, cette
communication va s'appuyer sur des photos, images
montrées à l'écran. Elles représentent Céline avec deux
compagnons blessés lors de son séjour au Val de Grace et
vont servir à illustrer la démonstration à venir.
 La nostalgie du masculin à la fin de Semmelweis.
La catastrophe du choc de la Grande Guerre va modifier
les valeurs des genres masculin/féminin. On voit sur ces
deux photos les blessés, Millon et Destouches, se tenir
bien droit, malgré les béquilles pour l'un et un gros
pansement pour l'autre. Ils essaient de retrouver une
virilité dans leur verticalité. La médaille militaire
est fièrement arborée.
La nostalgie du masculin à la fin de Semmelweis.
La catastrophe du choc de la Grande Guerre va modifier
les valeurs des genres masculin/féminin. On voit sur ces
deux photos les blessés, Millon et Destouches, se tenir
bien droit, malgré les béquilles pour l'un et un gros
pansement pour l'autre. Ils essaient de retrouver une
virilité dans leur verticalité. La médaille militaire
est fièrement arborée.
A partir de son
expérience africaine, Céline va exprimer sa violente
hostilité à la guerre, à son non-sens, son absurdité,
objet de sacrifice qui n'avait rien du don de soi. Il
retourne ce cliché pour mieux le détruire. La
féminisation est prédite, après la guerre par Céline. La
" fleur d'une époque fut hachée menue... "
Cette communication
se propose d'explorer le rôle central de la guerre, et
tout particulièrement de la Première Guerre mondiale,
dans la radicalisation intellectuelle de l'homme
Destouches et de l'écrivain Céline, amené à lire la
Grande Guerre puis la Seconde Guerre mondiale et en
premier lieu la défaite de juin 1940, comme le symptôme
d'un effondrement viril de la vieille Europe.
Envisagée très
tôt, dès 1916, par le combattant réformé comme une
sinistre comédie, la Grande Guerre sert de pivot à
l'exacerbation d'un pessimisme radical dont les thèmes
principaux - la mort du courage guerrier, la haine des
femmes et la détestation de la démocratie - participent
de la formation d'un ressentiment qui va structurer les
choix idéologiques et littéraires de l'écrivain dès les
années 20.
En d'autres
termes, cette contribution se propose de déconstruire la
question quelque peu rebattue du pacifisme célinien pour
mieux percevoir la complexité des enjeux que celle-ci
dissimule.
Les sources
utilisées sont puisées non seulement dans l'œuvre,
mais aussi dans la correspondance et dans les archives
concernant le parcours militaire de Destouches.
PAUSE :


15ème communication :
Pierre-Marie MIROUX :
Hommes et femmes en Progrès.
On trouve dans Progrès 4 tableaux qui
préfigurent déjà les thèmes de Voyage au bout de la
nuit. Figures masculines, figures féminines... Le
gaz est présent dans Progrès, comme dans
Guignol's Band ou le Passage Choiseul
véritable cloche à gaz. Les moqueries sur l'Ancien monde
d'avant guerre. Avec la représentation des thèmes
féminins et celle des thèmes masculins, Céline va
re-figurer des transcriptions qui vont se retrouver dans
l'œuvre.
Progrès est
déjà dans une écriture célinienne. La similitude des
bruits du tambour " broum , broum, broum " que l'on
retrouve dans Nord. Il y une danseuse américaine
qui vient au boston et qui visite l'après-midi. Déjà les
muscles, le corps de la danseuse. Le voyeurisme est la
sexualité originelle de Céline.
Si la première
pièce de Céline, L'Eglise (1926), est surtout
annonciatrice de Voyage au bout de la nuit, par
ses scènes qui se passent en Afrique, en Amérique ou
dans la banlieue parisienne, sa seconde pièce,
Progrès (1927), va beaucoup plus loin et profile des
thèmes essentiels que l'on retrouvera, non seulement
dans Mort à crédit, mais aussi dans Guignol's
Band et jusque dans Nord.
Parmi ces thèmes,
celui du corps, musclé ou avachi, de la danse et de sa
contrepartie, la boiterie, celui de la réalité,
vulgaire, généralement masculine, habitée de " forces
occultes ", et, à l'inverse, du rêve d'un monde que Dieu
- un Dieu tout célinien - régénèrerait par la beauté
féminine : autant de points essentiels contenus dans
cette petite œuvre, sans
doute la moins étudiée de Céline.
Par sa simplicité,
voire sa naïveté, qui lui permet d'exposer tout cela de
façon très directe, elle nous a paru propice à l'étude
des figures féminines et masculines - thème de ce
colloque - et de leur rapport : ici, un voyeurisme qui
permet de ne toucher au sexe dangereux que du bout des
yeux.
16ème communication :
François GIBAULT : Louis-Ferdinand, Emile, et
Jean-Jacques et quelques autres.
Rabelais, Léon Bloy, les affinités avec Céline sont
évidentes, d'un autre ordre que les admirations avouées,
Ramuz, Marcel Aymé, Barbusse, la Marquise de Sévigné,
Paul
 Morand,
Roger Nimier par amitié. Morand,
Roger Nimier par amitié.
Elie Faure pendant
un temps, quelques rares autres, le plus souvent avec
des réserves assassines. Les liens avec Emile Zola, déjà
remarquablement traités en 1997 par Nicole Debrie, dans
Quand la mort est en colère - L'enjeu esthétique des
pamphlets céliniens, méritent d'être rappelés, mais
ceux entre Céline et Jean-Jacques Rousseau semblent
n'avoir jamais été mis en avant.
Cavalier seul
comme le fut Céline à bien des égards, solitaire parmi
tous les écrivains de son temps, méprisé par beaucoup
d'entre eux à commencer par Voltaire, qui fut injuste
avec lui, Jean-Jacques, qui était hanté par l'enfance, a
écrit des pages qui annoncent certains passages des
Beaux Draps, sans parler de son délire paranoïaque.
De ce point de
vue, écrivain maudit et persécuté, son statut revendiqué
est comparable à celui de Céline, poursuivi par la
meute, seul contre tous, victime d'une " Affaire Dreyfus
à l'envers ".
Peu présent dans
la correspondance de Céline, il y est plusieurs fois
moqué pour sa fausse candeur, son innocence feinte, son
amour de la nature (que Céline détestait), sa croyance
en la bonté de l'homme, en bref son " rousseauisme ".
14h15 :
Le président réuni son Conseil
d'Administration pour en terminer avec
l'Assemblée Générale. Le rapport financier
est rapidement voté à mains levées. Le
rapport moral l'est également dans la foulée.
Le Président tient alors à préciser qu'il n'est pas démissionnaire mais,
s'il restera à son poste jusqu'à Paris, il le sera
certainement en 2018. Il serait bon que d'ici là tous
réfléchissent à lui trouver un successeur.
Il est proposé alors à l'Assemblée l'élection de François-Xavier Lavenne
au Conseil d'Administration. Celle-ci est votée à la
majorité.
Les discussions vont une nouvelle fois bon train sur le lieu et le thème
du prochain colloque. Le 31 octobre 2016 sera la date
limite pour présenter ses propres contributions.
17ème communication :
Présidence : Sven Thorsten KILIAN
 Isabelle BLONDIAUX : Figure de l'hystérie chez
Céline.
Isabelle BLONDIAUX : Figure de l'hystérie chez
Céline.
Code fondateur
de la psychanalyse. Angoisse de l'homme face au monde
moderne. Le malaise dans la société moderne, mal-être,
mal-vivre.
Crise
individuelle, crise de l'identité.
Le romantisme et le féminin dégénéré. L'hystérie, course à la tendresse
chez la femme. Fanatisme d'un braillage hystérique.
L'Amérique
représente le contraire du progrès, vitesse, hâte
hystérique, qui tue toute création et toute espèce de
poésie.
Le monde moderne,
c'est la vitesse et la brutalité, l'hystérie juive...
Le Juif devient
l'hystérie, le féminin, la rage, le dénominateur.
16h :
Lecture interprétative :
" LE MONSTRE DE MONTMARTRE " : Anne
-Catherine DUTOIT et Véronique FLAMBARD-WEISBART.
Combinant
le thème du présent colloque " Céline, masculin-féminin
" avec la commémoration récente du soixante-dixième
anniversaire de la Libération de Paris par les forces
alliées, il nous semble à propos de revisiter
aujourd'hui un texte de Louis-Ferdinand Céline qui tient
lieu de ces thèmes et évènements : Féerie pour une
autre fois, publié chez Gallimard en 1952.
Dans ce texte,
Céline retrace l'expérience historique de la Libération
de Paris à travers l'anecdote personnelle de la visite
de Clémence, qui vient faire signer ses textes à
l'auteur, " le monstre de Montmartre ", avant que les
sympathisants gaullistes le " désossent " et/ou le "
pendent ".
Notre lecture
interprétative en duo présentera non seulement un
exemple du " style émotif " célinien faisant partager
son émotion toujours à vif, mais offrira également une
certaine vision de Céline sur un ménage et sa
progéniture.
Elle s'inscrira
aussi dans le contexte de la performativité de l'œuvre
célinienne dans son ensemble, et comportera un élément
audiovisuel.


A
les entendre on aurait pu facilement voir Clémence et
son fils Pierre... Elle assise, là, devant sa table, son
fils resté debout...
C'est sur ces
belles scènes de théâtre que prend fin le XXIe Colloque
International de Varsovie. Et tous, en se quittant,
espéraient bien se retrouver dans deux ans à Paris.
************
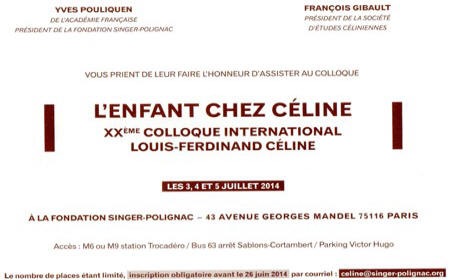 
C'est
dans un cadre prestigieux, la Fondation Singer-Polignac,
que le 20 ième Colloque International Louis-Ferdinand
Céline s'est déroulé du 3 au 5 juillet 2014. Son
président Yves POULIQUEN de l'Académie française et
François GIBAULT le président de la S.E.C. avaient
parfaitement orchestré ce bel évènement en invitant près
d'une vingtaine d'intervenants à proposer des
communications sur le thème choisi : " L'enfant
chez Céline "



Entrée 43 Avenue Georges Mandel 75 116 Paris.
Les deux présidents devisent.
La Fondation Singer-Polignac tient son existence à
la décision de Winnaretta Singer, princesse Edmond de
Polignac, de donner une forme juridique à l'action de
mécénat qu'elle entretenait depuis très longtemps, qui
en marqua, en 1928, définitivement la naissance, mais il
est plus juste d'y retrouver l'ultime conséquence de la
passion que la princesse entretenait depuis son
adolescence avec la peinture et la musique.
[...] Mais il y eut aussi l'attrait de Paris, d'où sa mère était
originaire et où il n'était guère possible d'être
célèbre, pour un artiste, sans y être reçu en ses
salons. Il y eut enfin la rencontre avec le prince
Edmond de Polignac, ce fin compositeur avec lequel elle
partagea, tant qu'il vécut, le goût immodéré qu'elle
avait pour la musique. Il y eut enfin ce désir de
construire ce bel hôtel particulier, sur les traces de
l'ancien, afin qu'il devînt l'un des lieux les plus
attrayants de la capitale.
Il le fut au-delà de ce qu'elle espérait, pour les
musiciens tout d'abord, qui y exprimèrent souvent en
première audition des œuvres
que la princesse leur avait commandées, Fauré, Chabrier,
Ravel, Datie, de Falla et Stravinski en sont les phares
connus. Pour les amis de la princesse, en second lieu,
qui les conviait à ces concerts dont la presse faisait
écho, parmi lesquels Marcel Proust, Colette, etc. ne
furent pas les moins célèbres.
Mais il fut aussi le lieu de rencontre que Winnaretta
Singer-Polignac offrit à tous ceux qui pensaient qu'elle
pourrait les aider dans leur vocation ou leur mission,
sculpteurs, peintres, hommes de sciences, architectes ou
responsables d'œuvres
charitables. Ainsi se définissait l'étendue du domaine
solidaire qu'elle avait créé, enclos en cet écrin
superbe, ce magnifique hôtel qu'à sa mort à Londres, en
novembre 1943, elle nous laisserait afin que survive la
mission qu'elle seule avait initiée.
(Avant-propos par le professeur Yves Pouliquen).


Winnaretta, princesse de Polignac et Colette dans le
jardin de l'hôtel.
Le professeur Yves Pouliquen élu à l'Académie française
en 2001.
Après cette présentation des lieux, revenons au colloque
lui-même, ce jeudi 3 juillet 2014, 14 heures. Son
ouverture, comme il se doit fut l'œuvre
du président de la S.E.C. Maître François Gibault qui,
après avoir présenté en quelques mots l'historique de
celle-ci, donna la parole à la première des
intervenantes.
1ère
communication :
Johanne
BÉNARD (Queen's
University, Kingston, Canada) - LIRE SHAKESPEARE
DANS GUIGNOL'S BAND : UN JEU D'ENFANTS ?
La
première intervenante va se servir du thème du colloque
pour poursuivre sa recherche sur l'intertexte
shakespearien de Guignol's band. Elle veut
rapprocher Virginie et Miranda (La Tempête). Puis
Prospero et Prospero Jim. Elle rappelle les propos de
Céline dans l'interview accordée à Pierre Dumayet où il
insiste sur la lourdeur et le poids des hommes en
invoquant, in fine, Ariel et Caliban les deux enfants de
Prospero.
L'enfant, chez Céline, est un être pur à rapprocher du chant d'Ariel dans
La Tempête. Elle va se servir de citations où
Céline joue subtilement des comparaisons de descriptions
des docks londoniens qui évoquent ceux de Shakespeare
dans La Tempête. Il faut aller vérifier Prospero
chez Shakespeare et Prospero Jim chez Céline. Mais
encore la tentative de viol de Caliban sur Miranda
comparée à celle de Ferdinand sur Virginie.
En conclusion, on peut s'imaginer : La Tempête a influencé Céline
dans Guignol's band mais aussi dans Féerie
pour une autre fois où sont bien évoqués le bien et
le mal, Ariel et Caliban.
2ième
communication :
Anne
SEBA-COLLETT (Université du Cap, Afrique du Sud)
- CELINE : D'UNE ENFANCE ABJECTE VERS UNE POESIE DU
DEPOUILLEMENT
 " Elle a tout fait (sa mère),
pour que je vive, c'est naître qu'il aurait pas fallu. "
(Mort à crédit). Une enfance mélancolique
parsemée de cette alchimie qui transforme la pulsion de
mort en sursaut de vie ; voila qui sera étudié :
l'aspect créatif d'une poésie dépouillée en parallèle
avec le pouvoir transformatif de la transgression.
" Elle a tout fait (sa mère),
pour que je vive, c'est naître qu'il aurait pas fallu. "
(Mort à crédit). Une enfance mélancolique
parsemée de cette alchimie qui transforme la pulsion de
mort en sursaut de vie ; voila qui sera étudié :
l'aspect créatif d'une poésie dépouillée en parallèle
avec le pouvoir transformatif de la transgression.
Anne SEBA-COLLETT va reprendre l'enfance de Céline, l'affaire Dreyfus, sa
position sociale marquée par Courbevoie où le temps n'a
pas encore démarré, l'influence de sa grand-mère dont il
va reprendre le prénom.
L'accouchement est l'objet essentiel de l'écriture. Il sera envoyé en
nourrice quelque temps après sa naissance. La fin de
l'enfance marquée par la scène de la machine à écrire
avec son père.
Par la tendance à la transposition, la vérité de son
enfance se situe certainement quelque part dans
l'entre-deux des mondes vérifiables et romanesques.
Ainsi l'écriture de Céline, pour conjurer la mélancolie
qui remplissait le foyer de son enfance.
3ième communication :
Anne BAUDART (Professeur de Lettres certifiée,
professeur de français et de latin) - CELINE - FELLINI : L'ENFANCE
DES VISIONNAIRES
Quel rapport entre ces deux auteurs ? Le pamphlétaire
du Voyage, hanté par le mal et la mort et le cinéaste italien de
La Dolce vita, né en 1920 ? Au début, pour les deux on retrouve le même registre populiste. Céline dans le Voyage,
privilégie l'argot pour mettre en scène les gens du peuple. Fellini
participe au mouvement néo-réaliste qui explore la même veine : la
misère italienne.
deux on retrouve le même registre populiste. Céline dans le Voyage,
privilégie l'argot pour mettre en scène les gens du peuple. Fellini
participe au mouvement néo-réaliste qui explore la même veine : la
misère italienne.
Céline et Fellini ont parlé de l'enfance avec la même tendresse et ont
remis en scène leur propre enfance dans leurs œuvres
(Céline dans Mort à crédit, Fellini dans Huit et demi et
Amarcord). C'est à partir d'elle qu'a pu se développer ensuite
librement, dans les deux cas, la féerie, le fabuleux imaginaire qui a
fait d'eux les deux grands visionnaires du XXe siècle.
Anne BAUDART parlera ensuite de l'enfance chez ces deux génies, de ce
qu'ils en ont dit, de la manière dont ils l'ont réinterprétée dans leurs
œuvres, de l'importance des premiers
spectacles auxquels ils ont assisté dans l'enfance, de leur propension
au rêve, de leur goût démesuré pour le mystère, le jeu, la fête, la
provocation, de leur incapacité à prendre la vie au sérieux et de leur
pouvoir de " miraginer "...
Ils nous ont entraînés en musique, chacun à sa manière, dans un " métro
émotif ", train pour Céline, toboggan magique chez Fellini. Ils ont
gardé tous deux intacts les pouvoirs de l'enfance, le propre des grands
artistes.
4ième communication :
Isabelle BLONDIAUX (Docteur en littérature
française et comparée, philosophe, psychiatre,) - LA DANSE DES
MOTS OU L'ETRANGE MALADIE DE FERDINAND
La
scène fantastique et euphorique qu'est la maladie étrange dont souffre
Ferdinand lors de son entrée à l'école communale (Mort à crédit),
va servir de support à
 l'intervention d'Isabelle BLONDIAUX. Elle succède
à une autre scène, celle du guéridon et de la partie de cartes qui au
colloque de Milan (2008) avait été reprise par Suzanne LAFONT. l'intervention d'Isabelle BLONDIAUX. Elle succède
à une autre scène, celle du guéridon et de la partie de cartes qui au
colloque de Milan (2008) avait été reprise par Suzanne LAFONT.
Ces deux séquences montrent avec quel art Céline sait faire revenir
l'esprit des morts aussi bien que celui des mots : " C'est pas
gratuit de crever ! C'est un beau suaire brodé d'histoires qu'il faut
présenter à la Dame. C'est exigeant le dernier soupir. " Cette
maladie commence par des vomissements, une forte fièvre (mécanisme
imaginatif). Des fantaisies, des " humeurs dans le cassis ", la maladie
empire et finit par des boutons. Le regard traduit les yeux du voyant,
du visionnaire (état d'hallucination). Cet état est un mécanisme
d'exploration de l'imaginaire et du fantastique. C'est l'effet
littéraire recherché d'un état hallucinatoire, que Baudelaire a utilisé
dans Les Fleurs du Mal.
Ses propres hallucinations entraînent l'imagination, la création,
l'influence. " Je ne pouvais plus bander... " La fièvre était une
fièvre initiatique. L'étrange maladie de Ferdinand est créative... On y
voit un embrasement créatif, un peintre créateur. Un mélange de doutes
et de délires, procédés qui donnent à voir et à vivre. Comme des
réparations de l'enfance. Mémoires créatives composées de perceptions et
de visions, processus d'incorporation... Le sexe à la base de
l'écriture...
Fin de cette première journée.
VENDREDI 4 JUILLET
:
9h30, ouverture de la seconde journée de ce XXe
colloque International :
5ième
communication :
Anna Maria ALVES (Enseignante au Département
de Langues Etrangères de Bragança, Portugal) - SOUVENIR D'ENFANCE
DANS MORT A CREDIT : LE DECES DE LA GRAND-MERE
" Elle a voulu me dire quelque chose...
Ça lui râpait la gorge, ça finissait pas...
Tout de même elle y est arrivée... le plus doucement qu'elle a pu... "
Travaille bien mon
 petit
Ferdinand ! " qu'elle a chuchoté... " petit
Ferdinand ! " qu'elle a chuchoté... "
Par le biais du regard d'enfant,
Ferdinand va raconter dans Mort à crédit, la mort de sa
grand-mère Caroline. Elle a énormément contribué à son éducation et on
va sentir par les témoignages qu'il apporte quel attachement et quelle
reconnaissance il lui doit. " Dans la journée j'avais grand-mère,
elle m'apprenait un peu à lire, elle-même savait pas très bien, elle
avait appris très tard, ayant déjà des enfants. " Plus même, c'est
une véritable complicité qui s'installe entre eux deux : " Elle se
rendait bien compte que j'avais besoin de m'amuser, que c'était pas sain
de rester toujours dans la boutique. D'entendre mon père l'énergumène
beugler ses sottises, ça lui donnait mal au cœur.
"
Cette relation privilégiée, avec la douceur, l'affection de sa
grand-mère va contraster avec la façon dont le père conçoit son
éducation. Contrairement à lui, grand-mère Caroline ne l'a jamais giflé,
lui achetait des magazines, l'emmenait voir le magicien Robert Houdin ou
bien au cinéma où ils pouvaient revoir jusqu'à trois fois le même film.
Elle lui laissait la possibilité de découvrir lui-même, de s'épanouir.
Le décès de Caroline va marquer fortement l'enfant qui va sentir là, pour
la première fois l'expérience de la mort. Ce sera son premier choc
émotionnel. Dans le roman le narrateur va se servir des réactions de
l'entourage qui vont lui permettre de renforcer encore son attachement,
son affection et son chagrin. Il y a aussi un sentiment de culpabilité
de l'enfant, mais aussi de tous les autres. Céline va jouer sur deux
oppositions, deux aspects : la violence et l'affection.
6ième communication :
 Véronique FLAMBARD-WEISBART (Loyola Marymount University, Los
Angeles, U.S.A.) - DE L'EDUCATION DE FERDINAND ET DE SES TRACES
DANS L'OEUVRE
Véronique FLAMBARD-WEISBART (Loyola Marymount University, Los
Angeles, U.S.A.) - DE L'EDUCATION DE FERDINAND ET DE SES TRACES
DANS L'OEUVRE
Fils d'une réparatrice de dentelles
anciennes, ayant vécu toute son enfance dans un milieu de commerçants
petit-bourgeois, pour Céline le travail artisanal est prépondérant sur
l'intellectuel. Véronique FLAMBARD va jusqu'à rapprocher l'antisémitisme
que son père lui aurait inculqué dans sa jeunesse et dans lequel il
aurait très tôt baigné entouré de petits commerçants, avec le statut des
Juifs au Moyen-Âge qui les empêche de
pratiquer toutes activités matérielles et manuelles. Leur resterait donc
que les professions libérales ou financières.
Adulte, venant à l'écriture Céline va adopter nombre de valeurs de son
milieu. Il se dit " artisan-styliste ". Il considère le style
émotif non pas comme un objet d'art, mais plutôt comme un objet de
fabrication artisanale dont la vente lui permet " de tirer un honnête
bénéfice pour se payer un appartement. " Le 25 juillet 1957,
interrogé par Louis-Albert Zbinden il dira l'écriture " ça paye
".
L'intervenante va montrer la difficulté de l'écriture, le labeur, avec
la valeur à négocier, le travail réussi de l'artisan. L'écriture, au
lieu d'être considérée comme un travail libéral est au contraire
considérée comme un labeur, une somme à négocier, à vendre. A rapprocher
ici de la vente du manuscrit et des relations tendues avec son éditeur
Gallimard... L'écriture est soumise au droit du travail ; cinq ans de
boulot doit être négocié.
Cette reconnaissance est obsessionnelle à la fin de sa vie, traduite par
ses plaintes incessantes pour la parution dans la Pléiade. Il veut être
lu, faire connaître son œuvre, son travail,
son labeur.
7ième communication :
Pierre-Marie MIROUX (Docteur ès lettres,
agrégé de lettres modernes ) - " BÉBERT
ET BÉBERT "
Comparaison entre Bébert, l'enfant du
Voyage au bout de la nuit de 1932, et le chat de Robert Le Vigan
laissé et adopté par Lucette et Céline en 1942, renommé par eux Bébert.
Ce chat qui deviendra le plus célèbre de la littérature française de
part sa participation à l'épopée de la trilogie allemande, s'éteindra
après son retour du Danemark en 1952 à Meudon.
Danemark en 1952 à Meudon.
Pierre-Marie MIROUX va diviser son intervention en cinq grandes parties
pour cerner les traits communs à l'enfant et l'animal, deux êtres
féériques dont la mort fait à jamais de gentils fantômes de "
l'outre-là ", le chat du roman mourant " agile et gracieux ",
tandis que l'enfant Bébert, ressuscité dans la " cavalcade des morts
" de Voyage, adresse un dernier signe au médecin qui l'a
accompagné jusqu'au bout de sa courte existence de misère.
- L'innocence : les deux, menacés dans ce monde de mort, le chat
sous les bombardements, et la lumière apportée par l'enfant " une
gaieté pour l'univers... "
- Les vadrouilleurs : l'enfant prend l'air, part en promenades,
va " vadrouiller " dans un cimetière. Le chat aussi se promène le
soir, si on lui cause. " Il était un vadrouilleur de nuit. "
- Le narrateur : l'enfant et le chat : " Les hommes ne me
donneraient pas l'infini... "
- La mort des deux.
- Céline et les deux Bébert : avec l'enfant : il propose un sirop
pour éviter " qu'il se touche "comme lui avec sa propre mère dans
Guignol's band II. Avec le chat, celui-ci rumine comme lui.
Transposé, comme la danseuse qui saute et qui s'élève...
8ième communication :
François-Xavier LAVENNE (Université
catholique de Louvain, Belgique) - L'ENFANCE, NOTRE SEUL SALUT :
LES UTOPIES CONTRE-EDUCATIVES CELINIENNES

Dans
Mort à crédit, Céline dresse un tableau critique
de l'institution scolaire qu'il apparente à
l'institution carcérale. Elle n'a d'autre but que de
saccager les possibilités de l'enfance pour produire des
adultes prêts à se couler dans le moule social et y
remplir leur fonction sans plus réfléchir. L'homme
contraint de s'écraser sous le poids, l'école
contraignante étouffe.
Elle forme des vieillards à l'âge de 12 ans. L'école
évoque un désastre des féeries. L'apprentissage scolaire
s'oppose à l'initiative, à la naissance de la fantaisie.
François-Xavier LAVENNE parle de la violence du monde des adultes
qui hiérarchise et normalise... Elle est déformatrice et
crée des monstres. A cette éducation-stérilisation
s'oppose l'utopie scolaire de Courtial du Familistère
Rénové de la Race Nouvelle. Une utopie de rénovation "
une race nouvelle " qui va très vite tomber dans
le burlesque et les petits pionniers qui vivent de
rapines, loin d'être des hommes nouveaux deviennent de
petits voyous et la seule race que Courtial créera sera
celle d'asticots prêts à dévorer la terre entière.
Alors il faudra bien opposer à ces idées fantaisistes et anarchistes des
utopies réalistes et sérieuses. Ce sera le but de Céline
dans Les Beaux draps où la race doit être
affinée, améliorée et sauvegardée contre tous les
métissages culturels et biologistes.
La France, si elle doit être nettoyer des Juifs, il faut que " les
Aryens s'épurent d'abord ".
C'est alors l'enfance qui apparaît comme le recours, le seul salut. Il
faut mener une politique de recréation en partant de
l'enfance, retrouver la fantaisie, la spontanéité
perdues.
L'enfance cesse alors d'être considérée comme un passé pour
apparaître comme ce qui pourrait réensemencer l'espoir
de l'avenir.
Pause : 12h


Tous les nombreux participants, comme les
intervenants surent apprécier à sa juste valeur la qualité du magnifique
buffet offert par la Fondation Singer-Polignac et son président Yves
POULIQUEN.
9ième communication :
Emile BRAMI (Libraire, écrivain, biographe,
réalisateur de théâtre) - L'ENFANT COMME ENJEU POLITIQUE DANS LES
BEAUX DRAPS DE L.-F. CELINE
 Ecrit
à chaud après la défaite de juin 1940, publié fin février 1941, Les
Beaux draps n'est pas seulement, même s'il reste aussi cela, le
troisième pamphlet antisémite de Céline : il est son seul ouvrage
politique. Céline avait annoncé qu'une guerre contre l'Allemagne
tournerait à la catastrophe. Sa prophétie se réalisera très au-delà de
ses prévisions : la France connaîtra la plus grande déroute militaire de
son histoire. Ecrit
à chaud après la défaite de juin 1940, publié fin février 1941, Les
Beaux draps n'est pas seulement, même s'il reste aussi cela, le
troisième pamphlet antisémite de Céline : il est son seul ouvrage
politique. Céline avait annoncé qu'une guerre contre l'Allemagne
tournerait à la catastrophe. Sa prophétie se réalisera très au-delà de
ses prévisions : la France connaîtra la plus grande déroute militaire de
son histoire.
Ne faisant confiance en rien en L'Etat Français qui a succédé à ce
désastre, parce qu'il le considère toujours autant enjuivé, Céline va
proposer à ce pays qui vient de toucher le fond, des reconstructions
toutes personnelles et particulières. Il intitulera l'ensemble : " le
communisme Labiche "...
Et ce sera en préservant l'avenir et la construction pérenne,
c'est-à-dire tournée et basée sur les enfants. Au préalable, un racisme
total, absolu. Embrigader et éduquer les enfants. " Tout recommencer par
l'enfant, pour l'enfant ". Les enfants aryens et les barrières
s'effaceront.
L'éducation ne doit plus être un lieu de tortures, un endroit de
sottises, c'est le plus grand crime d'enfermer des enfants pendant 5 ou
6 longues années. Il faut recréer l'école, sens
dessus-dessous. Favoriser partout le développement artistique, instaurer
la discipline du bonheur, trouver le salut par les Beaux Arts.
Emile BRAMI en conclusion, montre comment se dessine, dans Les Beaux
draps, une image rousseauiste de l'enfant qui naîtrait artiste et
des principes éducatifs qu'il conviendrait d'adapter afin que subsiste
chez l'adulte cette fragile aspiration à l'harmonie et à la beauté qui
conduirait à une France régénérée.
10ième communication :
Pascal IFRI (Washington University, Saint
Louis, U.S.A) - L'ECOLE DANS L'OEUVRE DE CELINE : DE MORT A CREDIT
AUX BEAUX DRAPS
Céline a été très marqué par son enfance et son adolescence
et a ressenti toute sa vie une profonde nostalgie pour cette période.
Ces années de son existence, restées incrustées dans sa mémoire, ont nourri Mort à crédit où
apparaissent, romancés, personnages, paysages et évènements de sa
jeunesse.
incrustées dans sa mémoire, ont nourri Mort à crédit où
apparaissent, romancés, personnages, paysages et évènements de sa
jeunesse.
Quoique l'école constitue d'habitude une partie importante de l'enfance,
elle occupe une place très secondaire dans le deuxième roman de Céline,
même si on prend en compte le fameux épisode du Meanwell College.
Pourtant, les rares remarques du héros-narrateur dans les quelques pages
qui la mentionnent impliquent de sa part un rejet radical de l'éducation
scolaire telle qu'elle existe et des idées bien arrêtées sur le sujet
qui laissent toutefois le lecteur sur sa faim.
Il faut en effet attendre l'Occupation et la parution des Beaux
draps pour comprendre ce que Céline, à travers son alter ego,
reproche à l'école. Parmi les institutions françaises qu'il attaque avec
virulence, figure en effet en bonne place celle-ci qu'il juge
responsable " du sabotage de l'enthousiasme, des joies primitives
créatrices, par l'empesé déclamatoire, la cartonnerie moralistique
".
Il propose lui, la gaieté, la danse. L'âme doit rejaillir de l'école et
laisser la place à l'émotion. Il préconise en priorité l'épanouissement
de l'enfant, tout en inscrivant ces idées dans sa vision du monde de
l'époque.
11ième communication :
Florence DE MÈREDIEU
(Ecrivain, Maître de Conférences honoraire, Université de Paris I)
- ARTAUD/CELINE. DESTINS CROISES : " LA GUERRE CONTINUEE "
Antonin Artaud (1896-1948) et
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) appartiennent à la même génération :
celle qui aborde ses 20 ans en 1914-1916. A deux ans
 d'intervalles,
ils auraient pu se croiser sur ces champs de bataille des Flandres et de
la Somme auxquels ils furent confrontés de manière brève mais intense. d'intervalles,
ils auraient pu se croiser sur ces champs de bataille des Flandres et de
la Somme auxquels ils furent confrontés de manière brève mais intense.
Tous deux furent marqués de manière indélébile par cette guerre. Leurs
parcours, leurs œuvres respectives ne
cesseront de véhiculer les impressions, les fantasmes et les
monstruosités de ce conflit qu'ils vécurent comme une mise à l'épreuve
de leurs nerfs et qui constitua ensuite le trauma récurrent de leurs
existences chaotiques.
En 1936, ils se rencontrent à un dîner chez leur éditeur commun Robert
Denoël et Steele. Rapportés par l'écrivain et scénariste Carlo Rim, les
quelques propos qu'ils y échangèrent sont tout ce que l'on connaît
de la relation des deux hommes.
Au-delà des divergences, politiques, culturelles et esthétiques qui les
animent, ils se retrouvent sur quelques points fondamentaux, dont
l'importance accordée à ce conflit de 14-18.
Pour l'un comme pour l'autre, cette guerre ne s'achève pas avec la
signature de l'armistice. Elle se prolonge et se perpétue dans la
société civile, sous la forme de ce que Michel Foucault, retournant une
célèbre proposition de Carl van Clausewitz, nommait un processus de "
guerre continuée ".
L'entre-deux guerre (1919-1939) n'apparaît, dans cette perspective,
que comme la lente et méthodique préparation de la Deuxième Guerre
mondiale. La guerre - l'état guerrier, la guerre comme état de fait
permanent - constitue le creuset qui sous-entend, alimente et entretient
les façons d'être au monde d'Antonin Artaud et de Louis-Ferdinand
Céline. Les principales lignes de force seront analysées ici.
Fin de la deuxième journée.
SAMEDI 5 JUILLET :
9h30 : troisième et dernière journée de ce XXe
colloque International :
12ième communication :
David FONTAINE (Journaliste au Canard
Enchaîné, agrégé de philosophie) - CELINE ET LE CONTE POUR ENFANTS
Ça a débuté comme
ça... A l'occasion du centenaire de sa naissance, Paris-Match
publie le 31 mars 1994 un conte pour enfant intitulé L'histoire du
Petit Mouk. Ce conte avait été fait pour sa fille Colette. Interviewée par l'hebdomadaire,
Colette Turpin-Destouches, âgée de 73 ans à qui on
demandait quel premier souvenir conservait-elle de son père répondait :
avait été fait pour sa fille Colette. Interviewée par l'hebdomadaire,
Colette Turpin-Destouches, âgée de 73 ans à qui on
demandait quel premier souvenir conservait-elle de son père répondait :
- " J'avais 3 ans, à Rennes, en l'absence de mes parents j'avais joué
à des déguisements toute la journée avec les robes de maman. Plusieurs
en étaient déchirées. En rentrant mon père m'a dit : - Tu n'as jamais eu
de fessée tu vas voir... - Et j'ai reçu la plus mémorable des fessées. A
la même époque, j'avais été éblouie par la lecture du premier livre de
mon père, un conte intitulé L'histoire du Petit Mouk, que ma mère avait
illustré.
Il est un pari incertain qui consiste à croire que ce conte est le
premier livre écrit par Céline. Car s'il est bien l'auteur de
l'histoire, rien du point de vue du style ne porte sa marque. On peut
penser que ce texte a pu être repris et improvisé oralement par Céline.
Il est repris à l'identique du conte de l'allemand Wilhelm Hauff qui
porte d'ailleurs le même titre Les aventures du Petit Mouk. Un
prince arabe dans le désert, des jolies dames aux seins nus, des palais,
des intrigues, avec comme thème central : le personnage du roi et la
vengeance des courtisans...
David FONTAINE va alors comparer plutôt ce conte avec le synopsis de
dessein animé Scandale aux abysses (1944) et les arguments de
ballets qui s'adressent en un sens à la part d'enfance de tout un
chacun. Recroisée avec certains contes classiques, cette lecture permet
de montrer des permanences thématiques, telle la jalousie féminine comme
moteur de l'intrigue, la mélancolie du héros nostalgique, l'appel de la
mer, des sirènes, du fond des océans qui ouvrent justement une
échappatoire.
Céline semble revisiter certains mythes et légendes, en les façonnant à
sa manière, en les subvertissant de l'intérieur même, pour mieux
transmettre sous les atours de la fable certaines de ses préoccupations
du moment, si ce n'est encore ses obsessions cruciales.
13ième communication :
Sven Thorsten KILIAN (Freie Universität,
Berlin, Allemagne) - UN IMAGINAIRE DU DEBUT DU SIECLE : LA LEGENDE DU
ROI KROGOLD ET L'HOMME-ORCHESTRE

Toutes les œuvres de
Céline, notamment Mort à crédit sont largement imbibées d'un
imaginaire d'enfance. L'intervenant va analyser l'origine de la
transformation romanesque et pamphlétaire de cet imaginaire.
On voit que La Légende du roi Krogold et des
personnages des films d'enfance réapparaissent chez Céline comme des
drogues ou des rêves censés remédier à la " manie " d'écrire de
l'auteur.
C'est avec le cinéma de Georges Mélies et les lectures des Belles
images que le petit Louis découvre son inspiration pour La
Légende du roi Krogold. Henri Godard le confirme également, La
Légende du roi Krogold est bien le reflet des lectures des Belles
images comme des films, souvenirs d'enfance avec sa grand-mère
Caroline. " On y restait 3 séances... " Cela datait des années
1902, 1906 et 1907.
Les traditions chevaleresques (Bagatelles pour un massacre)
et les personnages fabuleux d'une certaine historiographie française
font partie de cet imaginaire. Sven Thorsten KILIAN, précise en
conclusion qu'on peut détecter et analyser une stratégie d'auto-mystification
de la genèse des textes de Céline à travers les citations et les
micro-récits intercalés dans la narration.
14ième communication :
Christine SAUTERMEISTER (Université de
Hambourg, Allemagne) - ENTRE APOCALYPSE ET UTOPIE : LES SCENES
D'ENFANT DANS LA TRILOGIE ALLEMANDE
Dans l'épopée de ce que l'on appelle la
trilogie allemande, les trois derniers romans de Céline, la débâcle est
parsemée de scènes d'enfants qui représentent des moments de répits, de
détente et surtout des moments d'espoir.
A côté de Sigmaringen: des enfants, ce sont des nourrissons, une
trentaine est décédée, pour Céline c'est un meurtre. Il va évoquer dans
diverses situations les enfants. Sans abri, au milieu de troupes qui
arrivent de partout, rien à bouffer. Des " mômes ", dans le
train, des ministres de Vichy crèvent de faim et de froid et les wagons
sont pris d'assaut par les enfants qui les piétinent.
Des scènes très drôles, c'est la pagaille, les gosses se jettent sur les
ministres pour les dépouiller : les enfants ont pris le pouvoir. Plus
loin, une femme enceinte devient la priorité : l'enfant c'est l'avenir.
Dans Nord, un village où des protestants français ont trouvé
refuge. Des bombardements se préparent. La foule les envahit avec des
enfants. On découvre un petit polonais avec un jouet, une poupée au bras
cassé qui veut jouer avec Bébert.
Rigodon montre l'Allemagne où le train est pris d'assaut par les
enfants. Ils sont au moins 15, ils s'installent, ils hurlent, les mômes
jouent et crient, c'est l'anarchie. Un tout petit,
emmailloté, laissé là par une mère, prend la place d'un maréchal
allemand. Il pue, personne n'a rien pour le changer, il rit, il est
sain. C'est avec des chemises du maréchal qu'on va changer le bébé. Ces
scènes d'enfant représentent l'énergie, elles défient la destruction et
la mort, elles font ressortir l'absurdité. Handicapés, ce sont des
victimes qui fuient la mort. Fonctions, réparatrice du régime allemand
partisan de l'eugénisme ou de la sélection naturelle, et salvatrice qui
sauve des enfants pour se sauver lui-même.
Avec leur énergie et leur joyeuse vitalité, les enfants se jouent de la
catastrophe, ils suscitent l'étonnement et l'admiration du
médecin-narrateur. En observant les petits mongoliens confiés à ses
soins, celui-ci va même jusqu'à leur donner, malgré l'apocalypse et un
pessimisme grandissant, une perspective d'avenir : " des vioques rien
à espérer n'est-ce pas ? mais des mômes, tout... "
15ième communication :
Alice STASKOVA (Freie Universität de Berlin,
Allemagne) - LA POETIQUE DU GESTE DANS NORD ET LA QUESTION DE LA
THEATRALITE
Le succès considérable des
mises en scène réalisées par Frank Castorf (Nord, Volksbühne
Berlin et Voyage au bout de la nuit, Residenztheater Munich,
2013-2014) pose de nouveau la question, souvent traitée par la recherche
célinienne, de la théâtralité des œuvres du
romancier.
Alice STASKOVA dans sa communication propose d'étudier le gestuel dans
Nord, en le comparant avec les œuvres de
Frank Kafka et de Jaroslav Hasek qui aussi se trouvent souvent
transformées en pièces de théâtre.
Son hypothèse part du fait que les œuvres en
question ne disposent pas d'un caractère " dramatique ". Leurs
théâtralité relève donc d'un registre différent : le genre narré et
narratif les rend particulièrement intéressantes pour les formes du
théâtre expérimental, plus précisément, en l'occurrence pour celui de
Castorf, d'un théâtre " post-dramatique ".
13h -14h : BUFFET - DEJEUNER


Les tables étaient excellentes, et les appétits aiguisés...
16ième communication :
Bianca ROMANIUC-BOULARAND (Stanford
University, U.S.A.) - JEUX DE CACHE-CACHE AU PIED DE LA LETTRE
DANS VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
En employant certains mots dans leur sens
étymologique alors que la langue n'utilise couramment que le sens plus
lointain, plus impropre, plus détourné, Céline invite le
lecteur de Voyage à une constante mise en tension ludique, et le
convie à un parcours interprétatif qui souvent relève d'un jeu de
cache-cache : certains sens ne se cachent que pour mieux se montrer.
Deux effets relevant du fonctionnement poétique dans ce contexte seront
particulièrement mis en valeur : l'ambivalence sémantique, qui joue sur
l'activation du sens étymologique et du sens de la langue tout aussi
pertinents, et sur un effet de recomposition de ces sens, et l'ambiguïté
allusive, qui se construit sur un jeu de disjonction entre le sens
étymologique et le sens de la langue, entre le sens allusif et le sens
dénotatif.
Seront impliqués dans ces jeux non seulement des mots qui présentent une
racine commune, mais également, et de manière surprenante, des
homonymes. Mais le ludique n'est chez Céline qu'une façon de rejoindre
le poétique.
Le besoin constant de raviver des sens originaires, de jouer avec des
sens possibles ou tout simplement oubliés, est en quelque sorte le
symbole de l'idéal poétique, qui cherche à créer une autre langue, une
langue qui révèle la vérité du mot, une langue plus proche des essences.
Grâce à ces " mots coupés à la racine ", qui placent le texte "
à même la langue ", comme l'exprime Roland Barthes, le texte
célinien prend immanquablement les allures d'une écriture poétique.
17ième communication :
François GIBAULT (Avocat, biographe, président
de la S.E.C.) - CELINE DANS LA CORRESPONDANCE MORAND - CHARDONNE
La première partie de la correspondance
entre Paul Morand et Jacques Chardonne, qui vient d'être
publiée chez Gallimard, couvre la période de 1949 à 1960, comprenant peu
de lettres pendant les premières années, mais qui se multiplient à
partir de 1955 et 1956.
C'est une époque charnière de l'Histoire de France, le passage de la 4e à
la 5e République, alors que les remous de l'épuration ne sont pas
achevés. Beaucoup de lettres, surtout celles de Morand, contiennent du
reste des relents de vichysme et d'antisémitisme.
On y découvre l'apparition d'une nouvelle génération d'écrivains, Bernard
Frank, Michel Déon, Kléber Haedens, Antoine Blondin, Stephen Hecquet,
Roger Nimier, Françoise Sagan, et les difficultés qu'éprouvent les
écrivains de l'entre-deux-guerres à rebondir.
Les deux hommes portent des jugements sévères sur leurs contemporains,
Gide, Montherlant, Mauriac, Aragon et beaucoup d'autres et réservent un
sort particulier à Céline, revenu en France en 1951, et sur le devant de
la scène littéraire, après la publication, en 1957, de D'un château
l'autre, roman apprécié différemment par Morand et par Chardonne.
Cette correspondance, balayant toute la vie littéraire française de
l'après-guerre, justifie l'étude de la place très particulière qu'y
tient Céline aux yeux de ces deux grands écrivains.
Débat entre Pierre ASSOULINE et Christine
SAUTERMEISTER animé par François GIBAULT sur le thème de SIGMARINGEN :
Avant de clôturer ce colloque International,
Maître GIBAULT propose à l'assemblée " une confrontation amicale
" entre deux auteurs qui ont écrit tous deux sur Sigmaringen.
Christine SAUTERMEISTER qui intervient la première, " honneur au
sexe faible ", dixit le président de la S.E.C. (quelques
toussotements dans la salle...), précise qu'elle n'est pas historienne
et que son intérêt pour Céline se situe au niveau du style et de son
vocabulaire. Pour préciser une conférence sur D'un château l'autre,
elle s'est rendue à Sigmaringen pour y effectuer des recherches. Elle y
a rencontré le directeur des archives du château qui a écrit lui-même
sur les divers personnages de Sigmaringen. Elle pu avoir accès au
journal des collaborateurs qui paraissait La France, et aussi et
surtout au " Journal " de Marcel Déat.
Elle s'est vu pressée alors d'écrire un livre. Après avoir relu plusieurs
livres d'Histoire, notamment celui d'Henri Rousso et bien sûr à nouveau
D'un château l'autre, " Céline à Sigmaringen " est paru.
Pierre ASSOULINE est historien et écrivain. Il a
écrit plus d'une vingtaine de livres, notamment Le Fleuve Combelle
où Céline est largement évoqué, il est membre de l'Académie
Goncourt. Il vient de publier un roman qui se situe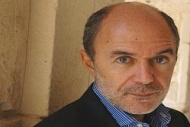 actuellement parmi les meilleures ventes de librairie : Sigmaringen.
actuellement parmi les meilleures ventes de librairie : Sigmaringen.
Il indique, dès son intervention, que contrairement à Christine
SAUTERMEISTER qui a apporté dans son livre des regards sur les
personnages ayant existés, le sien est celui d'un historien certes, mais
celui aussi et surtout celui d'un romancier.
Passionné par cet époque, ce n'est ni Céline, ni Sigmaringen qui
l'a motivé, mais le point de vue sur le phénomène de huis-clos...
Comment, des gens qui se détestaient, tous Français, qui avaient choisi
le mauvais camp, ont-ils pu vivre pendant 8 mois en champ clos ?... Il
n'a pas voulu travailler en historien mais en romancier, estimant que
travailler sur des archives a des limites : " Il arrive un moment où
on ne peut aller plus loin, cela dépasse l'état des archives, les
documents ".
Autre fait déterminant : le constat que les Français ne connaissaient pas
l'histoire de Sigmaringen, alors qu'ils sont pourtant passionnés par
l'Occupation, Vichy et la Deuxième Guerre mondiale. La plupart croit que
la fin de la guerre coïncide avec la Libération de la France ! Non, il
faudra attendre encore 8 mois.
Le personnage principal, le majordome, a été trouvé à travers des films
revus, " La règle du jeu " de Jean Renoir (8 fois...), " Le
vestige du jour " où deux niveaux de société coexistent, les maîtres
et les serviteurs, avec le comte et son majordome, et également des
vieilles séries anglaises de la B.B.C.
L'idée ce sera donc l'histoire racontée par un majordome, et un majordome
allemand...




Après cet ultime débat qui
clôtura un 20 ième Colloque Louis-Ferdinand Céline parfaitement riche et
passionnant, tous les participants eurent bien du mal à se quitter et
les conversations allaient, j'en suis sûr, toutes dans ce sens...
***********
19ième colloque
International
Louis-Ferdinand CELINE
BERLIN 6-8 juillet 2012.
La Société d'études céliniennes et
son président François GIBAULT ont choisi, pour leur dix-neuvième
colloque, la ville de BERLIN avec
comme thème : CELINE et l'ALLEMAGNE.
C'est ainsi que dans la magnifique
bâtisse du Frankreich-Zentrum, dans un quartier résidentiel où se
succèdent parcs et splendides sous-bois, intervenants et participants
furent accueillis de façon exceptionnelle par l'équipe aguerrie de
Madame Margarete ZIMMERMANN, grande responsable du Frankreich-Zentrum
der Freien Universität Berlin.
- " Ce colloque fait partie
du programme qui a démarré à l'automne 2010 et qui est intitulé "
Histoire et littérature ". Il se propose de mettre en lumière les points
d'articulation entre ces disciplines dans les champs universitaires français et allemand
", nous expliqua-t-elle.
C'est à 10h15, le vendredi 6
juillet que débuta le colloque, ouvert par François GIBAULT.
Dans sa présentation celui-ci tint à préciser que l'Ambassade de France
refusa de prêter son concours et de cautionner cette initiative, que
cela était bel et bien une première pour les responsables de la SEC, et
que l'on se devait de le déplorer.
1ère communication :
Ana Maria ALVES (Instituto Politécnico de Bragança, Portugal) - CELINE et les RAPPORTS FRANCO-ALLEMANDS.
Elle se proposa de
démontrer que contrairement aux propos céliniens, l'auteur eut plusieurs
rapports avec l'occupant, Abetz, Achenbach, Klarsen, Bickler ou Schleier.
Elle indiqua que Céline fut reçu à trois ou quatre reprises par des
représentants allemands, à sa demande. Il reçut Abetz à son domicile et
l'ambassadeur éprouvait beaucoup d'admiration pour l'écrivain. indiqua que Céline fut reçu à trois ou quatre reprises par des
représentants allemands, à sa demande. Il reçut Abetz à son domicile et
l'ambassadeur éprouvait beaucoup d'admiration pour l'écrivain.
Il fut reçu par lui à l'ambassade où
la question de son or planqué à Copenhague fut certainement évoquée.
Elle signala de nombreuses fréquentations à l'Institut allemand pour
rendre visite à Epting. Céline intervint pour d'autres auteurs français,
notamment pour " Les Mouches " de Sartre.
Elle mit l'accent sur le sentiment de
dépréciation ressenti envers l'auteur pour son style hystérique,
ordurier ou vulgaire et son délire antisémite d'une part, et d'autre
part le sentiment partagé lui, entre nausée et admiration pour sa verve,
" sa création hallucinante d'un monde dominé par les forces destructives
de la mort et de la folie. "
2ième communication :
Christine SAUTERMEISTER (Université de Hambourg, Allemagne) -
D'UN CAFE
L'AUTRE : CELINE et MARCEL DEAT à SIGMARINGEN.
 Puisant dans un " Journal de guerre " laissé par Marcel
Déat, écrit presque au jour le jour et qui se termine à la fin de son
séjour en Allemagne, avant sa fuite en Italie, l'intervenante montra de
nombreuses allusions comiques répertoriées dans Nord et D'un
château l'autre. (Les propos de Mme de Brinon qui était juive, sur
son mari, lui, antisémite, et sur la politique souhaitée véritablement
par Doriot). Puisant dans un " Journal de guerre " laissé par Marcel
Déat, écrit presque au jour le jour et qui se termine à la fin de son
séjour en Allemagne, avant sa fuite en Italie, l'intervenante montra de
nombreuses allusions comiques répertoriées dans Nord et D'un
château l'autre. (Les propos de Mme de Brinon qui était juive, sur
son mari, lui, antisémite, et sur la politique souhaitée véritablement
par Doriot).
On y retrouve certains noms connus
dans la trilogie : le Dr Haubold, Hermann Bickler, le Dr Knapp ou un
certain professeur Göring de Berlin.
Les rapports de Céline avec Déat se
révèlent dans ce " Journal " cordiaux au-delà des rapports de
travail.
Si le Dr Destouches dîne un soir au
château avec ses collègues médecins et pharmaciens pour une réunion de
spécialistes, il vient par ailleurs plusieurs fois avec Lucette prendre
le café chez les Déat...
3ième communication :
Pascal IFRI (Washington
University, Etats-Unis) - L'ALLEMAGNE et les ALLEMANDS dans la
CORRESPONDANCE de CELINE (1907-1939).
Les rapports de Céline avec
l'Allemagne sont particulièrement complexes. Il y a effectué des séjours
linguistiques durant son enfance, un an environ entre Diepholz et Karlsruhe.
Karlsruhe.
Il semble avoir soutenu le régime
nazi et défendu certaines thèses durant la Seconde guerre mondiale, mais
il a été un héros de la Première sous l'uniforme français.
Il n'a jamais rejoint la
Collaboration pendant la période de l'Occupation et a souvent affiché
son mépris pour les collaborateurs comme envers les nazis. Il est
difficile de se faire une idée avec les propos quelquefois
contradictoires de l'écrivain.
Une lecture attentive de sa
correspondance, notamment à des juives allemandes avec lesquelles il
correspond entre 1932 et 1935, - Cillie Ambor, Annie Reich et Anny Angel
- montre qu'il pressentait la catastrophe à venir et qu'il n'éprouvait
que dégoût pour le nazisme.
4ième communication :
Margarete ZIMMERMANN (Freie
Universität de Berlin, Allemagne) - REPRESENTATIONS de BERLIN dans
NORD.
Elle
énuméra pour commencer les multiples citations d'écrivains sur Berlin et
notamment celle, devenue célèbre, de Céline : " Pluie, soleil, ou
neige Berlin a jamais fait rire, personne ! " Ceux-ci, depuis la
chute du Mur, que ce soit Christian Prigent (Berlin deux temps trois
mouvements), Jean-Yves Cendrey (Honecker 21), ou Julien
Santoni (Berlin trafic), prirent la capitale allemande pour le
point de chute de nomades modernes en mal de crise identitaire.
Ce dernier livre, paru chez Grasset,
décrit les errances à travers Berlin, la mort, la drogue, la
prostitution et rappelle étrangement Guignol's band.
L'intervenante évoqua ensuite le
Berlin des voyageurs, le Berlin fantômatique de l'été 44. Les quartiers
dont Céline parle lors de ses déplacements avec Lucette et le chat
Bébert : la villa de Haubold-Harras en 1940.
Les errances de ses personnages dans
cette ville mourante, à travers cet univers urbain en dissolution
renvoient alors à une poétique du mouvement tout à fait particulière.
5ième communication :
David FONTAINE (journaliste au
Canard enchaîné) - Le BERLIN de CELINE.
Céline dans Berlin, après ses premiers
séjours tout jeune et ses voyages pour travaux médicaux financés par la
SDN en 1929 et 1932.
A la fin de l'été 44, il n'est resté
que huit jours dans cette capitale, mais la transposition saisissante
qu'il en donne dans Nord
occupe près d'un cinquième du volume. Et là, on le suit comme " touriste
" du désastre. Sont cités des lieux magiques comme la Porte de
Brandebourg, La Chancellerie, la station de métro Tiergarten, Unter den Linden avec aussi des hôtels aux noms savamment modifiés.
Linden avec aussi des hôtels aux noms savamment modifiés.
Dans cette ville amputée et saignée à
blanc, Berlin n'apparaît plus que comme un " décor ", avec des tas de
petites maisons dans les rues. L'hôtel Zénith, réduit à deux
étages suspendus entre deux trous de bombe, devient l'emblème de cette
ville désolée.
On découvre que certains de ces
traits du Berlin célinien préexistent à l'écriture du roman, notamment
dans ses lettres écrites en 1946, du fond de sa prison danoise.
L'intervenant fit ressortir de façon
pointue et avertie, le parallèle que Céline fait entre sa perte
d'équilibre - il ne peut plus marcher droit, ce qui nécessite l'achat de
deux cannes - et sa " titubation " narrative, sa façon de raconter " de
bric et de broc ". Images en " zigzag ", celles de sa technique
romanesque...
Il conclut en précisant que l'aura de
cette ville dans l'œuvre doit sûrement aux précédents séjours qu'il y
avait faits, évoqués au tout début de son intervention.
6ième communication :
André DERVAL (IMEC) -
ALLEMANDS et ANGLAIS entre MUSIQUE et CHARABIA.
 Il est évoqué les séjours
linguistiques du jeune Destouches en Allemagne (1907-1908) puis en
Angleterre (1909). Il est évoqué les séjours
linguistiques du jeune Destouches en Allemagne (1907-1908) puis en
Angleterre (1909).
L'intervenant
relève les très nombreuses références à la musique de la langue dans les
premiers écrits. Si l'on peut considérer que le " Journal de Diepholz "
écrit en français, est la première marque d'écriture littéraire chez
Céline, celle-ci est bien moindre que la place réservée à l'Angleterre
ou au monde anglophone. La lecture de Voyage au bout de la nuit, Mort
à crédit et bien sûr Guignol's band permet de le vérifier
aisément.
Il est recensé les diverses
appréciations dans l'œuvre. Négatives, lorsqu'il s'agit de qualifier
l'allemand : langue détestable, tapageuse, grondante, de commandement,
et beaucoup plus nuancées pour l'anglais, notamment le " snappy " du
théâtre, du jazz, du ragtime à la musicalité recherchée.
Cette opposition se retrouve dans le
bruit des avions de guerre avec les innombrables onomatopées qui se
succèdent.
En conclusion, Céline rejette les "
types " anglais et allemand dans une même détestation mais s'intéressera
et puisera dans leurs littératures : Shakespeare, Defoe, Chamisso,
Fontane...
7ième communication :
Anne SEBA COLLET (Journaliste,
Le Cap, Afrique du Sud) - CELINE en BATAILLE avec... la GUERRE :
l'ALLEMAGNE : CATALYSEUR d'un PACIFISME.
Céline en bataille avec la guerre.
L'intervenante rentre dans les origines des conflits, les dangers, les
risques.
La lutte double de Céline pour la
réconciliation de son pacifisme s'est déroulée sur deux fronts.
L'externe, avec la volonté de réunir une grande armée franco-allemande
qui évitera la deuxième guerre mondiale qui se dessinait. Puis celle,
intime, pour réconcilier les deux parties rivales de son " Moi " suite
aux traumatismes subies à Poelkapelle dans les Flandres en 1914.
Sont évoqués les conflits en
remontant au Traité de Verdun de 843, le Sedan de 1870 et plus près de
nous, celui de Verdun de 1916.
Avec la Seconde guerre mondiale,
Céline avait perdu sa bataille externe. Mais par la création de sa prose
poétique, féerique même, par le truchement des figures du Double dans
son œuvre, combien a-t-il réussi dans sa seconde bataille !...
Et c'est bien nous, les lecteurs, qui
goûtons cette réussite et ces chefs-d'œuvre en accédant à cette prose
célinienne qui nous ouvre la porte de cet autre-là, pierre de
touche de l'œuvre.
Samedi 7 juillet , deuxième
journée de ce 19ième colloque International.
... et 8ième communication :
Bianca ROMANIUC-BOULARAND - Un
PHENOMENE STYLISTIQUE CELINIEN : La RECURRENCE FORMELLE et SEMANTIQUE.
C'est Voyage au bout
de la nuit qui est analysé ici. Le texte est traversé d'un bout à
l'autre d'un bruissement sonore incessant, par des " échos " phoniques,
denses et permanents.
 L'effet de rappels sémantiques exploité par Céline crée des doubles
d'une grande richesse. La répétition créée par la multiplicité de
signifiés autour d'un signifiant engendre un effet poétique inégalé,
exploité merveilleusement par l'écrivain.
L'effet de rappels sémantiques exploité par Céline crée des doubles
d'une grande richesse. La répétition créée par la multiplicité de
signifiés autour d'un signifiant engendre un effet poétique inégalé,
exploité merveilleusement par l'écrivain.
Cette musique joue également dans
l'harmonie avec des effets comme l'équivoque, le calembour, la
paronomase, la figure dérivative.
L'auteur fabrique, en utilisant un
même signifiant dans un sens concret, puis dans un sens abstrait, des
constructions personnelles... Les compléments se répondent en échos...
L'argot aussi, est utilisé, comme le
régime familier et populaire, qui lui permet d'élargir la gamme
sémantique, où un même signifiant peut vouloir dire des choses
différentes.
Ce travail met en avant l'antanaclase,
pour faire résonner dans le texte, la multiplicité des acceptions
polysémiques d'un mot ou bien les sens totalement différents de ce même
signifiant par le pur hasard de l'homonymie.
Pour conclure, ce n'est pas le
moindre talent de l'intervenante, qui a donné à l'assistance des séries
d'exemples, tous plus riches, plus amusants et des plus cocasses dans le
Voyage...
9ième communication :
Alice STASKOVA (Freie
Universität de Berlin, Allemagne) - FIGURE et ESPACE ENTRE la "
TRILOGIE ALLEMANDE " et FEERIE pour une AUTRE FOIS I.
Il s'agit ici d'analyser comment les
figures (tropes) participent à la constitution de l'espace représenté,
et comment celles-ci font avancer le récit.
L'intervenante montra que dans les
trois romans de la trilogie, D'un château l'autre, Nord et Rigodon, les
personnages se mouvant à travers l'Allemagne, privilégient les tropes au
sens horizontal et qu'on pourrait ainsi les nommer figures de transfert.
Par contre, dans Féerie pour une
autre fois I, elles jouent mais cette fois dans la verticalité ; c'est
l'espace clos de la prison danoise qui apporte cet effet.
L'utilisation soutenue de la
métalepse, figure par laquelle on attribue à l'auteur le pouvoir
d'entrer lui-même dans l'univers de sa fiction, est longuement
développée ici. Le récit, alors, dépasse ses propres seuils.
On pourrait la rapprocher, en
poursuivant la comparaison, en narratologie, où l'écrivain stoppe son
récit pour mettre le lecteur ou lui-même sur le devant de la scène.
Elle conclut en expliquant qu'une
analyse des relations entre tropes et espaces met en relief des aspects
essentiels de la poétique de Céline, et permet en outre, des variations
dans le développement de son style.
10ième communication :
Suzanne LAFONT (Université de
Montpellier) - Des COLLABOS aux BALUBAS : Le MIROIR SONORE de
l'HISTOIRE dans la TRILOGIE ALLEMANDE (l'exemple de D'un château
l'autre).
Une bien amusante contribution nous est donnée là.
Dans D'un château l'autre, on compte une abondance d'exclamations
et d'onomatopées en langue française, comme en langue étrangère, bien
que le récit soit de narration plus classique si on le compare aux
romans précédents comme Féerie.
 De
façon plus étonnante on constate la fréquence de mots à redoublements :
fifis, froufrou, glouglou, cache-cache, coupe coupe, et d'autres à "
échos " : méli-mélo, queue leu leu, Lili, Bébert... De
façon plus étonnante on constate la fréquence de mots à redoublements :
fifis, froufrou, glouglou, cache-cache, coupe coupe, et d'autres à "
échos " : méli-mélo, queue leu leu, Lili, Bébert...
Ce ne sont pas des accidents ou des procédés de
style pour dynamiser les normes de l'écrit, mais de la matrice même de
l'écriture célinienne. L'auteur compose une langue où s'entend un babil
d'avant l'emprise du sens, une langue " babélisée " peuplée d'idiomes
étrangers, qu'il qualifie de " petit nègre "
Reviennent dans son dispositif, les échos et
rumeurs, faisant des retours sur l'histoire dans un " bric à brac " où
se mêlent les souvenirs de sa petite enfance, ses apprentissages
linguistiques, ses séjours africains, avec des évènements pressentis,
oubliés ou en gestation.
Céline ne se contente pas de " blablater " sur un
passé en passe de devenir ancien, il fait " miraginer ", grâce au miroir
sonore disposé par son écriture, les potentialités de l'histoire
présente et future.
Les années 50 rentrent en résonnance avec la Seconde
guerre mondiale, elle-même hantée par celle de 1914 et les guerres
coloniales.
Il n'y a pas si loin des collabos à la fin du Reich
en Allemagne aux balubas du Congo. D'ailleurs, conclut-elle, Céline
n'avait-il pas, dès L'Eglise, confié sa succession au petit noir
Gologolo ?
11ième communication :
Véronique FLAMBARD-WEISBART (Loyola Marymount,
Etats-Unis) - La TRAVERSEE de l'ALLEMAGNE en TRAIN.
En s'appuyant sur le métro magique et les rails "
tout à fait spéciaux " décrits dans Entretiens avec le Professeur Y,
l'intervenante va les rapprocher des manifestations littérales et
figurées du voyage à travers l'Allemagne.
C'est le transport magique qui intervient, celui qui
mène au féerique où sont exposés les épisodes de la locomotive à
l'envers dans les nuages : " ... une locomotive à l'envers... perchée...
et pas une petite je vous dis, une à douze roues !... en l'air et à
l'envers... sur le dos ! soufflée ! au sommet !... "
Il nous est montré alors comment cette métaphore de
la locomotive, comme celle du métro émotif, entrainent le lecteur vers
le transport des sens selon les règles de sa " petite musique "
polyphonique, car " Pas d'air grandiose sans contrepoint !... "
Les pauses méridiennes permettent de
sustenter les participants, mais aussi de créer des contacts impromptus,
évocateurs et souvent chaleureux...


Quelques uns de ces moments... où les discussions
varient, mais ne s'éloignent jamais très loin de l'ermite de Meudon.


12ième communication :
François-Xavier LAVENNE -
ORPHEE en ALLEMAGNE :
La TRILOGIE à TRAVERS les ENFERS et QUÊTE de
l'ECRITURE.
La fuite dans l'Allemagne en feu, l'exil et
l'incarnation au Danemark constituent des évènements qui bouleversent la
posture célinienne.
 La gestion de l'identité de l'écrivain passe alors
par la narration, et plus particulièrement par la reprise de canevas
mythiques... Ceux-ci, utilisés en contrepoint, permettent à l'exilé de
donner une portée métaphysique au traumatisme de son expérience vécue. La gestion de l'identité de l'écrivain passe alors
par la narration, et plus particulièrement par la reprise de canevas
mythiques... Ceux-ci, utilisés en contrepoint, permettent à l'exilé de
donner une portée métaphysique au traumatisme de son expérience vécue.
Dans Féerie pour une autre fois, le lieu de vie (son appartement
au-dessus de Paris), s'oppose à la prison, lieu de mort, enfouie, lui,
sous la terre. L'écrivain est le damné ; c'est Sisyphe envoyé aux
Enfers. C'est Adam chassé du paradis.
Plus atténué est la posture du " Pline de l'ère
atomique ", l'explorateur curieux mais imprudent.
Mais c'est avec le mythe d'Orphée, que l'auteur
utilise comme matrice signifiante illustrant son parcours, que
l'intervenant va ravir l'assistance. On sait comment l'aède de Thrace
descendit aux Enfers pour en ramener Eurydice son épouse. Il ne devait
la regarder qu'à sortir du royaume des Morts... Ne résistant pas, il
provoqua pour elle une seconde mort...
La descente aux Enfers, le parcours de l'écrivain, a
pour but d'éviter la mort promise à Paris. Cette descente, pour lui, en
trois étapes, s'accompagne de la transformation physique de l'auteur
devenant mi-mort, mi-vivant.
Ce sont les châteaux, Sigmaringen, le Brenner et
Zornhof qui traduisent cette plongée.
L'intervenant ajoute ici, une nouvelle scène pour
renforcer encore cette identification à la descente aux Enfers. Celle du
début d'Un château l'autre où Céline descend vers la Seine qu'il
voit en Styx. Là, il fait la rencontre de Caron et sa barque. Il ramène
le passé en revenant dans sa villa, ce passé arraché à la mort, que doit
ressusciter l'écriture.
Et la conclusion s'impose alors. Le motif du tombeau
d'Orphée introduit en effet la conception du texte comme le lieu de
survie spectrale de l'auteur dont chaque lecture réanime la voix.
13ième communication :
Sven Thorsten KILLIAN (Université de Potsdam,
Allemagne) -
L'ALLEMAGNE, ce MONSTRE.
En 1938, Céline attribue à l'Allemagne, dans une
fausse citation, l'épithète de " monstrum ".
Vingt ans plus tard, son voyage forcé à travers
celle-ci est évoqué en termes mythologiques qui font imaginer une vision
cauchemardesque de l'Europe centrale.
L'intervenant, jeune chercheur ayant préparé sa thèse
de doctorat après avoir vécu de longues années à Paris, va analyser le
mode fantastique et la fonction pragmatique de cette stratégie
textuelle.
Car, l'écrivain, ne s'est-il pas lui-même mis en
scène comme monstre dans ses romans, et avec ses apparitions publiques
des années 50 ? Et dans la prison danoise, quand il parlait allemand aux
détenus de la dérive nazie, pour cyniquement leur remonter le moral ?
Il explique alors, froidement, que les textes
montrent dans leur réalité télévisuelle un jeu de doubles et de masques
rempli de sous -entendus.
Pour lui, l'Allemagne de Céline est plus qu'un
référent historique et culturel. Le schéma du pays monstrueux sert ici,
à travestir les modes d'énonciation, à simuler et à dissimuler l'affect,
et à provoquer de manière " psychapersuasive " une réaction publique
convulsive.
Le monstre Céline a décrit la monstruosité de
l'Allemagne à travers ses propres écrits. Déconstruction de la
construction d'un monstre...
14ième communication :
Anne BAUDART - CELINE et l'ALLEMAGNE.
Céline écrira à son amie Evelyne Pollet
qu'il va aller voir à Anvers, en 1933 : " Moi-même flamand par mon père
et bien breughelien
d'instinct, j'aurais du mal à ne pas délirer entièrement du côté du Nord
" et en 1937, dans une autre lettre : " Vous serez gentille de me donner
quand je vous verrai quelques renseignements sur la vie de
 Jérôme Bosch.
Juste quelques idées. " Jérôme Bosch.
Juste quelques idées. "
Céline s'intéresse à la peinture et il est, lui-même
un grand peintre de l'apocalypse, dans la lignée de Bosch, de Breughel,
de Goya.
Il dira à son ami Elie Faure, parlant de la hideur
du genre humain :
" Il faut se placer délibérément en état de cauchemar
pour approcher du ton véritable. "
En témoignent ses tableaux de la guerre dans le
Voyage et dans la Trilogie Allemande, sa vision inouïe des
bas-fonds, des prostituées dans Guignol's band, la fulgurance de
couleurs de son tableau du bombardements de Paris dans Féerie pour
une autre fois.
L'intervenante, après avoir distribué à l'assistance
des photocopies de tableaux illustrant son développement, rapprochera l'œuvre
picturale et le parcours de Céline de ceux d'un autre rescapé de 1914,
de l'autre côté du Rhin celui-là, l'expressionniste allemand Otto Dix...
Lui aussi a peint " la hideur du genre humain " avec le même
pessimisme. Il a abordé les mêmes thèmes : l'horreur de la guerre,
l'univers glauque des prostituées pour les opposer à l'harmonie de la
musique et de la danse...
15ième communication :
Johanne BENARD (Queens's University, Canada)
-
Le THEATRE dans la TRILOGIE ALLEMANDE : l'ENVERS du DECOR.
Notre intervenante commença par la distribution
de trois feuillets qui aideront l'assistance à suivre son exposé avec
des citations sur les différents thèmes concernant
les auteurs de théâtre.
En se servant du débat bien connu, sur la question
de la théâtralité dans les derniers romans, entre Robert Llambias et
Philip Watts, Johanne BENARD, sans trancher celui-ci, expliquera que le
théâtre de Céline, et notamment dans les scènes évoquées dans la
Trilogie allemande, lui permet de se moquer de l'Histoire (avec un grand
h).
Le discours célinien va au-delà de l'inconscient, de
l'affect... c'est son théâtre. Son utilisation lui permet d'éviter
l'histoire, de s'en démarquer et de ne pas endosser les responsabilités
qui pourraient être les siennes.
Alors la guerre et l'histoire sont des spectacles.
Son récit est la passerelle qui permet de passer aisément de l'histoire
au spectacle.
Et pour conclure, de citer Watts, qui rapproche les
scènes shakespeariennes de Guignol's band où le théâtre, se confondant
avec le rêve, nous ramène justement au réel et à l'histoire.
La seconde journée de ce colloque se
termina donc sur cette intervention, toute tournée vers le théâtre.
Mais les participants étaient loin d'en avoir
terminé avec ce thème, puisqu'ils allaient être conviés à devenir, à
leur tour, des véritables acteurs de l'épopée célinienne...
Ici, sur place, à Berlin, à une demi heure de là,
invités au théâtre, à visiter l'Histoire... celle de la Trilogie
allemande... celle de Nord.
Grâce au talent très apprécié de notre hôte, Madame Margarete ZIMMERMANN, la visite d'un lieu mythique fut négociée avec
leurs propriétaires, et c'est ainsi qu'une vingtaine de céliniens
allaient, soixante-cinq ans après Céline, Lucette, Le Vigan et Bébert,
fouler le sol du domaine du Professeur HARRAS...
Ils avaient laissé derrière eux le " Zenith Hotel "
et une seule obsession Grünwald ! arriver à Grünwald !...
" ... nous suivons... c'est d'abord un très grand
jardin, même plutôt un parc... plein de décombres, ici, là... d'autres
villas, sans doute ?... ce qu'il en reste ! et des morceaux de stèles et
statues... et couvertes de ronces et de barbelés... ah, une très haute
serre, mais plus une vitre... on passe dedans... l'officier avance tout
doucement... peut-être est-ce miné ?... je lui demanderais bien... "
Et puis, la grenade ? trouvera-t-il un endroit pour
s'en débarrasser ?
" ... je voyais bel et bien ma poche, grenade et
goupille nous envoyer plus haut que les arbres ! Il se doutait, l'S.S...
? lui qui faisait si attention à ce qu'on s'écarte pas du petit
chemin... sûr, il avait peur des mines... mais ma poche moi, un petit
peu ?... ce parc était immense, rocailles, futaies... presque tous les
arbres ébranchés... je cherchais voir, droite, gauche, un endroit
d'eau... je pourrais envoyer mon afur !... j'avais vu plusieurs mares,
bien bourbeuses, herbues, vaseuses... mais bien trop loin de ce sentier
! " (...) Pendant que l'S.S. nous explique combien ces bains sont
toniques, qu'il en prend lui-même, etc. etc. j'extirpe ma foutue grenade
du fond de ma vague et je la pose sur le rebord du trou, qu'elle glisse
à pic... je la pousse ... tout doucement... vlof ! elle plonge ! "
 
Voilà ce qu'est devenu le domaine du Professeur HARRAS... après de multiples ventes et reconstructions ... Une
superbe maison de maître appartenant aux propriétaires des porcelaines
MEISSEN, parmi les plus belles et chères au monde...


Nous
n'avons pas trouvé la grenade, ni vu des souterrains, bien évidemment,
mais un certain frisson est passé parmi nous, en contemplant ce parc,
derrière la somptueuse bâtisse...
Dimanche 8 juillet 2012, troisième et
dernière journée.
16ième communication :
Pierre-Marie MIROUX
- Le NORD CHEZ CELINE : Des
RACINES et des AILES.
 " Mon père est Flamand ma mère est Bretonne... "
" Mon père est Flamand ma mère est Bretonne... "
L'intervenant, partant du principe qu'il n'apparaît
que quelques notes éparses et succinctes sur les origines de
Louis-Ferdinand Destouches - dans la biographie de François Gibault et
de Gaël Richard dans l'Année Céline 2007 - va étudier dans le moindre
détail la généalogie de sa famille.
Il découvrit que l'arrière grand-père paternel de
Céline s'appelait François Joseph Delhaye et sa grand-mère : Hermense
Destouches, née Delhaye.
Puis, dans un deuxième temps, il montrera comment
dans la Trilogie allemande notamment, il existe véritablement une sorte
d'aimantation vers le nord comme lieu de féerie.
Le Danemark, alors lieu si cruel, où il renaîtrait
en fantômes dans un monde qui serait aussi celui des origines d'avant la
naissance, car dans ce monde construit de misères et de catastrophes,
rappelons-le, conclut-il " c'est naître qu'il aurait pas fallu ! "
17ième communication
:
Marie-Pierre LITAUDON
- GUIGNOL'S
BAND... AU PASSAGE.
Guignol's band, c'est le séjour londonien du
héros Ferdinand. L'histoire est introduite dans les quatre
premiers chapitres, par le bombardement du pont d'Orléans en juin 40, et se prolonge par une
série de " pronostications " à l'adresse des lecteurs.
le bombardement du pont d'Orléans en juin 40, et se prolonge par une
série de " pronostications " à l'adresse des lecteurs.
Ce " prologue narratif ", en marge de l'histoire mais
qui introduit le roman, procédé reproduit dans Mort à crédit et
d'autres romans, joue bien le rôle d'un sas mémoriel.
Dès lors que le bombardement d'Orléans opère en
prolepse narrative, l'histoire rapportée s'inscrit dans une durée
nouvelle, celle d'entre-deux-guerres, avec un creux de vingt-deux années
de paix, réduites au silence.
Cette contraction confère une force programmatique
au premier chapitre, véritable Apocalypse signant la fin des temps.
L'anticipation devient prémisse du récit à venir, piégeant la vie de
Ferdinand dans un cycle de malédictions voué à la géhenne.
Mais cet entre-deux-guerres et ses catastrophes
s'appréhendent aussi comme un lieu de passage entre deux " mondes ",
espace volitif d'un franchissement problématique.
18ième communication :
Louis BURKARD
- Les PAMPHLETS de CELINE
et leur INTRODUCTION en DROIT.
 Le futur avocat précisa d'entrée la volonté de Céline de faire
rééditer ses pamphlets pendant toute la guerre. En 1951, quand il
renégocie ses droits, il récupère ses droits d'édition (un an sans
parution).
Le futur avocat précisa d'entrée la volonté de Céline de faire
rééditer ses pamphlets pendant toute la guerre. En 1951, quand il
renégocie ses droits, il récupère ses droits d'édition (un an sans
parution).
Dès son retour d'exil, devant la délicate question de
l'interdiction en droit des pamphlets antisémites, Céline a bien
montré sa volonté de ne pas voir ces trois livres réédités. Celle-ci est
catégoriquement prolongée par sa veuve.
Qu'elle s'appuie sur les droits patrimoniaux plutôt
que sur le droit moral, elle n'en reste pas moins fondée sur le droit
d'auteur. Ce sera jusqu'à 70 ans après la mort de l'écrivain, soit
jusqu'au 1er janvier 2032.
Et là donc, dès lors qu'un tribunal les jugera digne
d'un intérêt historique et documentaire, dûment accompagnés de préfaces
et de postfaces, ils pourraient éviter les sanctions prévues dans le
cadre d'appel à la haine raciale.
Diverses questions permirent de conclure cette
intervention, en évoquant principalement la particularité de Mea
culpa, qui échappe à cette interdiction, de par le " laisser faire "
de Lucette et la réédition " à l'étranger " ?...
19ième communication
:
Isabelle BLONDIAUX
-
POURQUOI LIRE CELINE ?
 La dernière intervenante de ces trois
jours de colloque, va expliquer à l'auditoire que la lecture attentive
de l'œuvre célinienne invite à questionner la manière dont lecture naïve et lecture
critique peuvent coexister et s'articuler. La dernière intervenante de ces trois
jours de colloque, va expliquer à l'auditoire que la lecture attentive
de l'œuvre célinienne invite à questionner la manière dont lecture naïve et lecture
critique peuvent coexister et s'articuler.
Céline, même réprouvé, est bel et bien devenu un
classique.
Lecture naïve ou lecture critique ? Derrière cette
question, elle montra tous les enjeux idéologiques engendrés...
Ainsi, le lecteur, s'il sait résister à la
fascination, perdra très vite son innocence. Il se trouvera dès lors,
confronté à la nécessité d'une lecture critique.
Lire donne à penser, et la lecture thérapeutique
proposera une pensée de la lecture qui peut faire modifier l'être.
Elle conclut en distinguant deux fonctions dans la
lecture critique : pour apprendre à lire et là, ne pas succomber à la
seule séduction, et pour apprendre à écrire et l'on rejoint la question
" qu'est-ce qu'un artiste ?, à laquelle elle a déjà tenté de répondre
dans Portrait de l'artiste en psychiatre, qui est l'autre volet
de la question " pourquoi écrivez-vous ? "
Ainsi se terminait le 19ième colloque International de Berlin,
organisé par la S.E.C.
Le président, François GIBAULT réunit aussitôt son
Assemblée générale statutaire pour esquisser, entre autres, le prochain
lieu où se déroulera en 2014, le 20ième ... Des bruits circulaient : la
Sorbonne, le Couvent des Récollets, la Fondation Dubuffet, la Fondation
Singer-Polignac...
Mais avant de se quitter et de rejoindre, qui son
hôtel, qui son avion... TOUS souhaitaient remercier le plus
chaleureusement qu'il soit, celle, sans qui ce colloque n'aurait pas été
ce qu'il fut : un grand moment culturel, de convivialité et d'émotion,
Madame Margarete ZIMMERMANN.


Remerciements. La Freie Universitäte de Berlin
***********
4-5 février 2011.
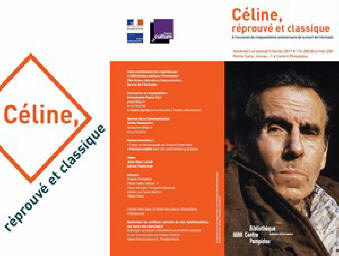
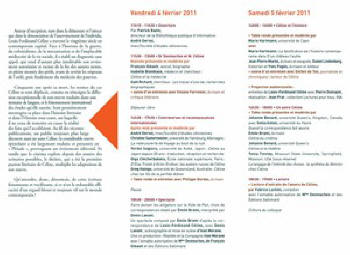



Ouverture 11h15 - 11h30.
Patrick Bazin absent, André Derval
ouvre le colloque avec le biographe François Gibault.
11h30 - 13h00. Dr Destouches et M. Céline.
Isabelle Blondiaux, médecin et chercheur ; Céline
et la médecine.
Gaël Richard, chercheur ; Les traces d'une vie,
recherches biographiques.
François Gibault meuble en évoquant l'absence
de Viviane Forrester. PAUSE.

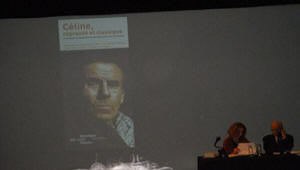
I. Blondiaux, F. Gibault, G. Richard
14h30 - 17h30. Controverses et reconnaissances
internationales.
André
Derval va présenter successivement :
Christine
Sautermeister, Université d'Hambourg ; La
redécouverte de Voyage au bout de la nuit.
Yoriko
SUGIURA, Université de Kobé ;
Céline au Japon depuis 50 ans : traduction réception et
recherche.
Olga
Chtcherbakova, Ecole nationale supérieure, Paris
; D'Elsa Triolet à Victor Erofeev : les avatars
russes de Céline.
Greg
Hainge, Université Queensland ; Céline chez les
fils de la perfide Albion.


André Derval
Johanne Benard
" Faurisson apparaît, passe inaperçu, prend la
parole. Se dit Ecossais. Cite un passage sur son pays
(Applaudissement candide d'un public en manque
d'exaltation. " (alainzanini.com).
Entretien
avec Philippe Bordas, écrivain. PAUSE.
18h30 -20h00. Spectacle. Faire danser les
alligators sur la flûte de Pan. Choix de la
correspondance établi par Emile Brami, interprété
par Denis Lavant.


Denis Lavant.
Très apprécié du public.
SAMEDI 5 février.
14h - 16h00. Céline et l'histoire.
Patrick Bazin revient, s'excuse car il a dû défendre
l'intérêt des bibliothécaires dans une assemblée...
Marie Hartmann, Université de Caen ; La
falsification de l'histoire contemporaine dans D'un
château l'autre.
N'a pas l'air de porter Céline dans son cœur.
Parle de l'antisémitisme de Céline. Il falsifie
l'histoire. Le lecteur ne peut pas s'identifier à lui.
Reparle de son racisme.
Daniel Lindenberg, historien.
Il
admet qu'il n'est pas très célinien, moins que le public
ici présent. Parle aussi de l'antisémitisme, du
révisionnisme. Il regrette que les écrivains-collabos
soient plus étudiés que d'autres. Marie Hartmann vient
l'aider : " Comme Sartre, qui lui, a résisté... "
(le public se réveille).
- Marie Hartmann : " Chut !... Chut !... " (le
public se réveille encore).
- Marie Hartmann : " Mais taisez-vous !... "
Jean-Pierre
Martin, écrivain, essayiste.
Il
commence par un petit texte de fiction écrit pour nous.
Parle de non réhabilitation de Céline, de son
aveuglement politique, de son antisémitisme. Evoque le Y
du professeur, qui signifierait Youtre ou Youpin. Il
indique que les céliniens sont une " bande d'aveuglés "
et va citer un homme qu'il aime bien Doubrovsky : "
Que vouliez-vous que je fasse, moi, juif, d'un écrivain
qui voulait mon extermination ? Si je n'ai pas été gazé à
Auschwitz, c'est malgré Céline. " (le public est
réveillé et commence à tousser...)
Yves Pagès, écrivain, éditeur.
De
mieux en mieux. Pour lui, il enseigne à ses élèves qu'on
aime le texte et non pas l'auteur. Les pamphlets sont
une chose abjecte, il n'a pu finir la lecture de
L'Ecole des cadavres. (Dans le public, quelqu'un : "
Moi, si !... " ). Si Céline a écrit Bagatelles
c'est pour hurler avec les loups en 1937, parce qu'il
n'avait plus rien à dire. Après 1941, il a peur et il
s'arrête. Il a bien été collabo, fasciste et a vendu son
âme. Plus tard il s'est constitué un personnage de
clochard irresponsable.
Puis le public est autorisé à poser quelques questions,
courtes...
Marie
Hartmann veut s'entretenir avec Delfeil de Ton,
le journaliste-célinien quand Faurisson demande le
micro, intervient en se plaignant d'avoir été quelques
instants plus tôt privé de parole (C'est lui,
l'Ecossais...).
- Faurisson Robert, moqueur : " Ai-je le droit de
poser une seule question ? (Silence à la tribune...)
" Que veux dire Bagatelles pour un massacre ?
Massacre de qui ? "
- Hartmann : " C'est moi qui vais répondre. "
- Delfeil de Ton : " C'est le massacre qui se
prépare. "
- Hartmann : " Voilà, bien sûr. "
- Faurisson : " C'est le massacre de la prochaine
guerre qu'il veut éviter. Céline est furieux, il voit
autour de lui des organisations juives, françaises,
américaines et autres qui poussent à la guerre contre
Hitler. "
- Hartmann : " Non, non, non. "
- Yves Pagès : " Maintenant c'est FINI... Stop. "
(Le micro est repris).
- Faurisson, sans micro : " CENSURE !... CENSURE
!... "
- Yves Pagès : " Dire que les juifs poussent au
crime, c'est insupportable !... "
Marie Hartmann termine avec Delfeil de Ton. Celui-ci
indique qu'il aime bien Céline, qu'il a tout lu de lui,
pamphlets compris.
PAUSE.
Au sous-sol, on assiste à un regroupement animé où on
devine Philippe Alméras en conversation avec Robert
Faurisson.
16h00. Projection : entretien audiovisuel de
Céline avec Pierre Dumayet pour la sortie de D'un
château l'autre. Réalisation : Jean Prat, collection
: Lecture pour tous, INA.
16h30
-18h00. Un autre Céline.
Sonia Anton, Université du Havre ; Quand la
correspondance fait œuvre.
Elle
évoque la correspondance de Céline. Elle y note son
humour et aussi des outrances.
Emile Brami, écrivain ; Céline au cinéma.
Il
insiste sur la volonté de mettre en scène le Voyage
de Céline. Liste tous les projets avortés. Ceux de
Michel Audiard, de Pialat, de Sergio Léone, de Stévenin...
Il se rit de Yann Moix qui souhaitait placer Bardamu
sous les tours du World Trade Center. François Gibault
intervient pour évoquer les références à Céline dans le
cinéma que Brami connaissait.

Sonia Anton.
Tonia Tinsley, Springfield (USA) ; Le langage de
l'intimité des choses : la synthèse du féminin chez
Céline.
Johanne Bernard, Université Queen's Canada ;
Céline au théâtre.
Elle
précise pourquoi Céline appréciait Molière et
Shakespeare. Evoque les nombreux projets d'adaptations
théâtrales de l'œuvre
célinienne. PAUSE.
18h30 - 19h00. Lecture d'extraits par Fabrice Luchini.
La
salle salive déjà pour le clou de la journée mais aussi
du colloque de deux jours. On éteint les portables
(recommandations...). Le public frémit du premier au
dernier rang dans une salle comble.
Il arrive par derrière. Il paraît s'étonner du peu de chaleur qui émane de
la salle. Il la trouve apathique.
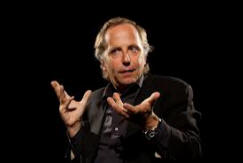
- " Je suis bien en présence d'admirateurs de Céline
? "
Il va s'énerver encore contre des gens en retard puis contre un gars
qui tousse. Il précise :
- " C'est toujours comme çà lorsque c'est gratuit...
et qu'il a fait fissa pour arriver car il récitait du Philippe Muray
tout l'après-midi !.. "
La salle est interdite et ne sait comment réagir...
Puis, insensiblement, un, puis deux, puis trois
applaudissements crépitent alors,
et soudain, deux cents
personnes tapent dans leurs mains, vibrent avec l'artiste.
Son numéro est réussi.
Il sourit, pose sa veste, la remet, la repose, la remet. Et Ferdinand est
devant nous, là, sur la scène c'est bien lui.
Quarante minutes de communion...
* * *
Le colloque " Céline, réprouvé et classique " fut
une réussite. Durant deux jours, la " petite salle "
(158 places) du Centre Pompidou était comble et les
organisateurs peuvent se targuer d'avoir obtenu, en
guise d'heureux épilogue, la participation (gracieuse !)
de Fabrice Luchini.
La veille, le spectacle conçu par Emile Brami et magistralement
interprété par Denis Lavant, remporta un égal succès.
Bémol : à la différence des colloques organisés par la
seule Société des Etudes céliniennes, quasi aucun apport
nouveau ne fut délivré dans les diverses communications,
les orateurs ayant puisé la teneur de celles-ci dans
leurs contributions antérieures (parues en livre ou en
revue). Une faiblesse de l'organisation - rien n'était
prévu le samedi matin - contraignit certains orateurs à
condenser leur texte au moment même où ils le lisaient.
Ce fut parfois dommage...
L'originalité de ce colloque fut de donner la parole à
des anti-céliniens patentés : Jean-Pierre Martin, qui
signa naguère un mémorable Contre Céline (1997),
et Daniel Lindenberg, auteur d'une belle contrevérité :
" Sous l'Occupation, Céline alla jusqu'à poser très
sérieusement [sic] sa candidature au Commissariat
général aux questions juives "1.
Ces deux universitaires ont
comme point commun d'avoir communié jadis dans la même
ferveur maoïste. L'un à la GP (Gauche prolétarienne),
l'autre à l'UJCML (Union des jeunesses communistes
marxistes-léninistes). Cette expérience militante leur
permet assurément de juger avec acuité la dérive
totalitaire de romanciers ayant été aussi des écrivains
de combat.
La nouveauté consiste à relier Céline à Auschwitz.
Ainsi, J.-P. Martin cita, pour l'approuver, Serge
Doubrovsky : " Que vouliez-vous que moi, juif, je
fasse d'un écrivain qui voulait mon extermination ? Si
je n'ai pas été gazé à Auschwitz, c'est malgré Céline
2. "
Jamais auparavant de tels
propos ne furent tenus dans un colloque consacré à
l'écrivain. Les céliniens qui font autorité ont écrit
exactement le contraire : " Céline, mieux que tout
autre, savait qu'il n'avait pas voulu l'holocauste et
qu'il n'en avait pas même été l'involontaire instrument
3.
" Dixit François Gibault. Quant à Henri Godard, il a
toujours considéré que, si l'antisémitisme de Céline fut
virulent, il ne fut pas meurtrier
4. " Et Serge Klarsfeld
lui-même tint ce propos lors d'une soutenance de thèse
consacrée précisément aux pamphlets : " Malgré leur
outrance insupportable, ils ne contiennent pas
directement d'intention homicide
5. "
En cette année du cinquantenaire, une étape a donc été
franchie. Il s'agit de faire d'un antisémite
incontestable un partisan des camps de la mort. En
décembre 1941, lors d'une réunion politique, Céline se
rallia à un programme préconisant la " régénération
de la France par le racisme ". Il précisait ceci : "
Aucune haine contre le Juif, simplement la volonté de
l'éliminer de la vie française
6.
Il suffira désormais de supprimer ces
quatre derniers mots pour faire de Céline un partisan du
meurtre de masse.
M.L.
1/Daniel Lindenberg, " Le
national-socialisme aux couleurs de la France. II.
Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, Esprit,
mars-avril 1993, p.209.
2/Michel Contat, " Serge Doubrovsky au stade ultime de
l'autofiction ", Le Monde, 3 février 2011.
3/François Gibault, Préface à Lettres de prison à
Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen, Gallimard
1998.
4/Henri Godard, " Louis-Ferdinand Céline " in
Célébrations nationales 2011, Ministère de la
Culture, 2010.
5/Propos tenus le 16 octobre 1993 à l'Université Paris
VII lors de la soutenance de thèse de Régis Tettamanzi (Les
pamphlets de Louis-Ferdinand Céline et l'extrême-droite
des années 30. Mise en contexte et analyse du discours).
6/Céline et l'actualité, 1933-1961 (Les Cahiers de
la Nrf) (Gallimard 2003, réed.) p.143-146.
(BC. n° 328 mars 2011).
* * *
Lors du colloque Céline qui s'est tenu au Centre
Pompidou en février dernier, il s'est produit un
incident pittoresque. Se présentant à la fois comme
membre de la Ligue des Droits de l'Homme et de la
Société des Etudes céliniennes depuis des décennies, un
auditeur s'est dit accablé par les réquisitoires dont
Céline était l'objet, ne reconnaissant pas l'écrivain
(dont il est un lecteur assidu) dans le portrait
totalement à charge qu'on faisait de lui.
Il faut dire que Martin, Lindenberg, Hartmann et Cie ne firent pas dans
la dentelle, présentant Céline comme le chantre des
camps de la mort. Assertion que même un Henri Godard,
peu suspect de complaisance envers Céline, a toujours
récusée : " Il n'y a, dans les textes,
correspondances ou propos mis au jour jusqu'à présent
aucune attestation d'une connaissance de la réalité du
processus de solution finale. "
(Notice de Guignol's
band dans Romans III, Gallimard, coll. Bibliothèque de
la Pléiade, 1988, p.945, in BC n°330, mai 2011).
SUR UN
COLLOQUE OUBLIE
Plusieurs céliniens rêvent d'un colloque sur Céline qui
serait organisé au Danemark. Savent-ils que les 14 et 15
septembre 1984 un tel colloque se tint à Klarskovgaard,
sur les lieux mêmes où Céline vécut en exil ?
Ce
colloque, " Influence de l'exil danois sur l'œuvre de
L.-F. Céline ", était organisé par les services
culturels de l'ambassade de France au Danemark
1. Etrange retour des choses si
l'on se souvient du zèle de l'ambassadeur Guy Girard de
Charbonnières à faire extrader Céline...
Malheureusement les actes de ce colloque n'ont jamais été publiés et
l'enregistrement des communications, réalisé par une
équipe technique de France Culture, a apparemment
disparu. Pour en conserver la trace, nous en donnons ici
les intitulés : " La vie de Céline au Danemark "
(François Gibault), " Céline et Helga Pedersen "
(François Marchetti), " L'exil linguistique de L.-F.
Céline " (Jacques Cellard), " La Volonté d'exil chez
Céline " (Marie-Christine Bellosta), " La Belle ouvrage
". Montages sonores sur la voix de Céline " (Claude
Duneton), " Ecrits intimes et écrits publics " (Jean
Guenot) et " Le Danemark dans les premières versions de
Féerie pour une autre fois " (Henri Godard)
2.
Rendant
compte de ce colloque dans le quotidien Politiken
(19 septembre 1984), Michel Olsen, professeur émérite à
l'Université de Roskilde (île de Seeland), relevait que
" les participants au colloque avaient pu s'assurer
de visu que les choses n'étaient pas aussi
pitoyables que Céline avait bien voulu les rapporter. "
Et d'ajouter : " Restait à essayer de comprendre la
description que Céline avait donnée du Danemark telle
qu'elle apparaissait dans Féerie pour une autre fois
et D'un château l'autre. Pour commencer, l'avocat
Thomas Federspiel fit visiter aux congressistes les
lieux où Céline avait vécu si longtemps. Puis la vie de
Céline au Danemark fut évoquée par le biographe de
l'écrivain, François Gibault, après quoi les raisons qui
poussèrent Helga Pedersen à écrire son livre furent
expliquées par le traducteur français, François
Marchetti. Mais l'accent allait dès lors être mis sur
les rapports de l'artiste avec le langage. Le parler
populaire que Céline utilise dans ses romans fut
analysé, à l'aide d'enregistrements, par le spécialiste
de l'argot, Claude Duneton. Marie-Christine Bellosta et
Jacques Cellard (ce dernier tenant la rubrique " Langage
" au journal Le Monde), analysèrent le rôle de
l'exil. Jean Guenot (spécialiste de la communication et
lui-même auteur) se pencha sur le vaste registre
stylistique de l'écrivain, tandis que, pour terminer,
l'éditeur des œuvres de Céline, Henri Godard, traitait
des ébauches des romans de Céline en montrant que cet
auteur ne se met vraiment à composer (et à déformer) que
lorsqu'il a pris ses distances d'avec la matière : tant
que Céline resta incarcéré à Vestre Faengsel, il ne
parla de sa situation qu'en termes brefs et sobres. "
Jacques
Cellard (1920-2004) et Claude Duneton (1935-2012) nous
ont quittés depuis. Ce dernier était également présent
pour réaliser une émission, " Céline au Danemark ", qui
sera diffusée l'année suivante sur France-Culture. Il
interviewa diverses personnalités dont le journaliste
communiste Samuelson (qui fit pression sur Charbonnières
pour que Céline soit extradé) 3
et Denise Thomassen, née Wever, qui tenait une librairie
française à Copenhague. La personnalité de Thorvald
Mikkelsen fut souvent évoquée, d'autant que ce colloque
était co-organisé par la Fondation Paule Mikkelsen. Deux
ans avant sa mort, l'avocat danois avait évoqué son
célèbre client dans une interview accordée au quotidien
danois Berlingske Tidende (20 février 1960).
Parlant de Klarskovgaard, il confia qu'il en avait tiré beaucoup de joie :
" Quand je pense à tous ceux qui sont venus là ! Mes
amis et, après la guerre des alliés. Et l'écrivain
français Céline, mon ami, mon ennemi. Père de la "
littérature noire ". Pas un talent : un génie. Il a été
accusé de trahison pendant la guerre, a fui ici, a été
arrêté, emprisonné, et a écrit ses souvenirs avec haine
contre le Danemark, mais le résultat se son séjour se
reflète néanmoins le mieux dans la dédicace d'un de ses
derniers livres : " Aux malades, aux animaux et aux
prisonniers ". Quand il mourra, il deviendra un
classique français. "
M.L.
1. Ce
colloque était organisé par Pierre Chantefort,
conseiller culturel à l'Ambassade de France au Danemark,
d'une part, et par Thomas Federspiel, administrateur de
la Fondation Paule Mikkelsen, d'autre part.
2. Julia Kristeva avait été pressentie pour participer à
ce colloque mais déclina l'invitation. Diverses
personnalités danoises déclinèrent également cette
invitation : Hans Boll Johansen (Université de
Copenhague), Ole Michelsen (producteur à la radio
danoise), Einar Tassing (Université de Copenhague) et
Ole Vinding (journaliste et écrivain).
3. Après avoir été correspondant de l'A.F.P. à
Copenhague, Samuelson travailla pour le quotidien
communiste Franc-Tireur.
Merci à François Marchetti qui a traduit les articles parus dans la presse
danoise et qui nous a fourni la documentation relative à
ce colloque.
(Bulletin célinien n° 419, juin 2019).
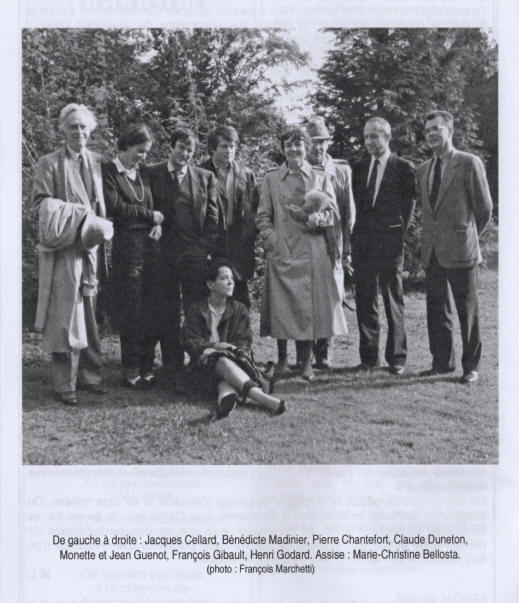
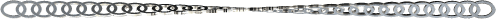

|